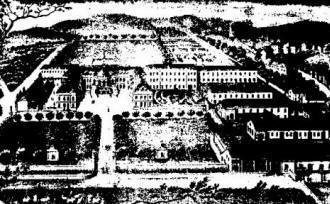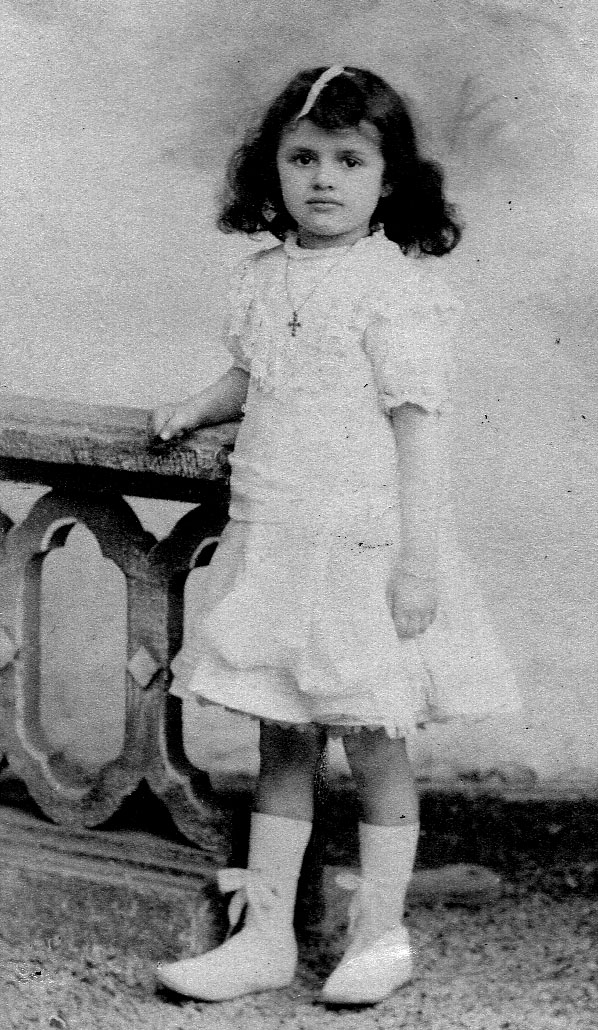|
1er cahier
La jeunesse
et l'adolescence 1890 à1904 Il me souviens avoir vu aux mains de mon père, lorsque j’étais enfant, un modeste cahier vert, qu’avec un sourire tant attendri qu’ironique il me présenta comme étant l’histoire de notre famille, remontant à plus d’un siècle et demi. A cet âge on s’embarrasse peu de souvenirs, l’esprit est tout tendu vers l’avenir, mais quand les années heureuses ou lourdes parfois de peines ont ciselé notre âme, elles aiment à se reporter en arrière et à revivre les jours à jamais enfuis. Ce cahier qui n’avait pas su tenter ma curiosité enfantine est tombé à nouveau sous mes yeux à une heure douloureuse de ma vie, à la mort de ma chère maman. Combien de fois nous avait-elle dit : « Vous en trouverez des choses après ma mort ». Elle avait en effet le culte des souvenirs et se débarrassait difficilement de mille riens auxquels peu de personnes se seraient attaché, et à plus forte raison les lettres écrites par les membres les plus chers de sa famille. Cette volumineuse correspondance je l’ai parcourue, avec intérêt toujours, avec émotion souvent, et j’ai su gré à ma chère maman d’avoir eu cette manie (si je puis dire) du souvenir qui m’a permis de la voir revivre bien des années en arrière, ainsi que bon nombre des membres de notre famille, Cette lecture a été pour moi un apaisement aux heures proches de la cruelle séparation et souvent un enseignement. Je veux dire qu’elle m’a appris à mieux connaître certains caractères, peu compris autrefois, et à excuser de ce fait des travers que mon intransigeante jeunesse avait condamné sans appel. Au milieu de cette volumineuse correspondance se trouvait le fameux cahier vert auquel j’ai fait allusion ; lui aussi je l’ai lu avec intérêt et le conseil donné par l’auteur, mon grand-oncle paternel, je veux le suivre, c'est-à-dire continuer cette histoire de la famille pour ceux qui la prolongeront. Mes filles aînées, captivées par la lecture de ce petit recueil, ont insisté pour que j’entreprenne ce travail, mais au moment de me mettre à la tâche, je suis un peu effrayé par sa complexité. Tant de souvenirs se présentent à ma mémoire, tant de visages veulent sortir de l’ombre où il ils sont déjà plongés, ou échapper à l’oubli qui les guette… Il faudrait la plume d’un écrivain pour coordonner tous ces souvenirs, grouper ou éclairer ces visages ; à défaut de talent, je fais appel à mon cœur pour me guider dans ce dédale du passé, et rendre mon récit compréhensible et attrayant, si possible, pour ceux et celles qui le liront plus tard. Ce Grand-oncle qui nous encourage dans son journal à poursuivre l’histoire de notre famille était Fortuné VIAU, oncle maternel de mon père, artiste mais très original, il mit plus d’une fois ce dernier dans l’embarras par des réflexions, en public, dont il aurait pu se dispenser. Une fois, entre autres, se promenant sur les grands boulevards à Paris il arrêta subitement mon père et se plantant devant une jolie femme qui passait il le prit à témoin sur la beauté de celle-ci… Aux reproches que son neveu lui adressa de le mettre dans cette situation ridicule, il protesta qu’il n’y avait là rien d’extraordinaire, il avait parlé en artiste et voilà tout.
Une autre fois il s’arrêta dans la campagne auprès d’une Une autre fois, il s'arrêta dans la campagne auprès d'une robuste paysanne qui allaitait son enfant et voulu absolument goûter à ce lait que le nourrisson semblait tant apprécier. Cet oncle, malgré ses originalités, était très aimé de ses neveux. Il arrivait toujours sans crier gare, au gré des ses caprices et de ses randonnées, et, toujours il était le bienvenu : les benjamins de la famille se régalaient paraît-il de ses histoires mouvementées et originales comme lui Artiste peintre, portraitiste surtout, il voyageait de ville en ville ainsi qu’il le raconte dans son journal et y laissait de nombreuses toile Il fit poser également bien des membres de la famille, et c’est ainsi que j’ai la joie de conserver l’image de mes parents dans la fleur de leur jeunesse, ma grand-mère et mon grand père paternels, la sœur de mon père, et lui-même tout jeune enfant, enfin la grand-mère paternelle de ma mère, cette amie à laquelle sans doute il fait allusion dans son journal, en disant qu’il aimât plus que de raison à Clermont (Oise) une charmante femme, qui hélas n’était plus libre. Ce récit de l’oncle Fortuné s’arrête en 1852, époque où la mère de mon père, Marie Viau épouse de Pierre-Frédéric Huault, était une femme de 49 ans.
Elle
avait eu cinq enfants nés chacun à cinq ans d’intervalle, mon père (Eugène)
était le benjamin et sa mère avait 45 ans lorsqu’il vint au monde ; elle
avait eu le malheur de perdre trois de ses enfants : l’aînée je crois,
Valentine était morte à 20 ans d’une sorte de maladie de langueur a-t-on
dit ? Une seconde fut emportée je ne sais à quel âge ni comment ? La
troisième, Eugénie, eut une vie romanesque dont je parlerai plus loin, le
quatrième, un garçon, Raphaël périt de convulsions, je crois avoir entendu
dire, à un âge très tendre. La famille de mon père, comme en le voit, était ami de celles de ma mère (Desmarquais, Mosse et David) de longue date. Papa rappelait en souriant que sa future femme avait couché dans son lit quand elle n’était qu’un tout jeune poupon, J’ai beaucoup entendu parler de ma grand-mère Huault Marie VIAU 4 par mon père qui avait pour elle une tendresse et une vénération peu commune, par ma mère aussi qui lui gardait une respectueuse affection, et par ma cousine germaine Amélie GOMEZ (Fille d’Eugénie sœur de mon père) « Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son » a-t-on coutume de dire, pour moi j’ai entendu bien des sons de cloches à ce sujet. Je n‘ai pu me faire une opinion personnelle sur ma grand-mère, celle-ci ayant quitté ce monde à un âge avancé alors que j’avais environ cinq ans ; mais d’après les dire des uns et des autres, j’ai pu conclure que c’était une femme de tête, intelligente et sensée. Ma cousine la donnait comme très autoritaire et, d’après elle, je l’aurais supposée assez dure, mais elle avait je crois bien des raisons d’être parfois un peu sévère vis-à-vis de certains de ses enfants ou petits enfants qui, d’abord gâtés par la vie, auraient dû dans l’adversité avoir plus de prudence, de docilité devant les conseils des aînés, ou d’énergie pour le relèvement d’une situation plus qu’ébranlée. Ma mère qui avait vécu les 7 premières années de son mariage avec sa belle-mère, en gardait un très bon souvenir : chacune avait su faire des concessions à l’autre, l’une par amour de son mari, l’autre pour son fils. J’ai entendu dire à maman que sa belle-mère parfois remarquait : « Blanche ne dit rien, mais elle fait de qu’elle veut » Un exemple entre autres de leur petites dualités qui n’eurent jamais de conséquences graves : Quand mon frère aîné Frédéric fut annoncé, on prépara avec amour son trousseau, ma grand-mère, pour faire une économie d’étoffe, avait décrété que telle largeur de drap était suffisante ; ma mère, qui n’était pas de cet avis, avait fait des remarques qu’elle estimait convaincantes, mais ma grand-mère qui n’en voulait faire qu’à sa tête, coupa subrepticement les dits draps pendant l’absence de sa bru. Celle-ci ne se démonta point et à son tour des deux draps n’en fit qu’un, ce qui nécessita une couture et prit beaucoup plus d’étoffe concluait-elle. Elle ajoutait que sa belle-mère avait eu le bon goût de ne rien dire et qu’elle montra, en l’occurrence, qu’elle était une femme intelligente. Mon père se souvenait, ou plutôt avait entendu parler, d’une mère jeune, très gaie et chantant toujours, mais les heurts de la vie s’étaient chargés de changer son caractère : elle avait eu bien des déboires dans son ménage par suite de la faiblesse de caractère de son mari (si je crois ce qu’à mots couverts on disait à la maison). Papa aimait bien son père, mais ne me paraissait pas avoir pour lui l’admiration ardente qu’il avait pour sa mère. Selon lui ce qui était arrivé d’heureux à son père, son avancement même d’officier il le devait à sa femme.
Pour ce qui est de bonté de mon Grand-père, tout le monde tombait d’accord pour reconnaître qu’elle était grande. En définitive, je crois qu’il y avait chez ma tante du faible pour mon grand-père, et chez mon père une préférence pour ma grand-mère. Mon oncle Fortuné, beau-frère de « papa grand », avait, dit-il dans son journal, une grande affection pour le mari de sa sœur, il nous le présente, quand il fit sa connaissance comme un jeune homme d’une belle prestance, « Beau de stature, qui avait de beaux yeux, mais d’un feu sombre et se dérobant, la bouche africaine, avec des cheveux droits gros et noires ». A vingt années de distance, ce portrait représente assez bien celui que peignit mon grand-oncle de mon grand-père, en capitaine de la garde impériale. Ma mère qui le connut toute jeune me dit jadis qu’il lui faisait peur, sans doute ce feu sombre des yeux et les cheveux très noirs donnaient ils à papa-grand un aspecte de dureté qui n’existait pas dans son cœur. J’ai entendu dire à papa que, lorsque quelqu’un de ses subordonnés avait pris la clef des champs sans permission, son père l’attendait au poste avec une pièce en règle pour lui éviter tout ennui. Si ce geste dénotait un bon cœur, il n’en laissait pas moins paraître une disposition à la faiblesse qui était un peu le signe de son caractère. Fils d’un patron boulanger, il avait du quitter le collège à 15 ans pour s’occuper de la maison à la mort de son père, mais sa mère laissa bientôt son industrie et mon grand-père voyagea. Puis quelques années plus tard, après avoir été employé dans ce même métier, il se maria avec Marie Viau et ils s’installèrent alors à Loudun. Malheureusement leur commerce ne réussit pas dans cette ville, et, après plusieurs autres essais infructueux, après lesquels mon grand-père quittait ma grand-mère pour aller chercher fortune ailleurs, au sens réel du mot, il s’engagea, et fit enfin une carrière assez heureuse dans l’armée. Il fut décoré de la Légion d’Honneur et, si ce titre fut mérité, il n’en reste pas moins, d’après l’avis de mon père, que c’est grâce à ma grand-mère qu’il l’obtint. Il mourut vers 1870 à la suite d’un accident, une chute, chute qui lui avait occasionné une fracture de la jambe. (Il meurt à 44 ans).. Maman-grand, en dehors des déboires et des peines dont j’ai déjà parlé, eut de gros soucis avec sa fille Eugénie. Celle-ci très jolie, paraît-il, fut remarqué par un riche Cubain, possesseur dans son pays de plantations importantes de cannes à sucre et de sucrerie d’un gros rapport. Les jeunes gens, épris l’un de l’autre, désiraient se marier, mais la mère du jeune homme, excessivement hautaine et autoritaire, mettait son veto à ce projet, trouvant trop modeste la situation de ma tante.
Passant outre, les jeunes gens partirent pour l’Angleterre où fut célébré leur union : mais à force d’intrigues, la nouvelle belle-mère, jouissant d’un grand crédit auprès de son fils, parvint à obtenir de lui qu’il abandonne sa jeune épouse. Le désespoir de cette dernière fut terrible et l’on peut juger de ce que fut celui de ma grand-mère par ricochet. Mais Madame GOMEZ del RUNCO avait affaire à forte partie en la personne de ma grand-mère, celle-ci n’abandonna pas la partie et réussit à ramener au foyer le jeune époux trop respectueux de l’autorité maternelle ; comment y parvint-elle ? Je crois que la naissance d’un fils fut la raison qui attira à nouveau le mari vers la femme, encore aimée, et qui fondit la résistance de la terrible belle-mère. Cette dernière, quand toute la famille eu rejoint Cuba, ne savait plus que faire pour être agréable à sa belle-fille, et ne jurait plus que par elle. Mais quel pouvait être l’état d’esprit de la pauvre mère restée en France et tremblant pour l’avenir de sa fille dont le mariage avait si mal débuté. Cependant les années passant, elle dut peu à peu se rassurer à ce sujet, tout en gardant au cœur la blessure faite par une séparation qui pouvait paraître définitive. Chaque année, en effet, amenait la naissance d’un nouvel enfant, et les voyages, dans ces conditions, voyages si lointains, n’étaient guère à envisager, malgré les facilités que pouvaient donner une grosse fortune. Quand mon père, de 10 à11 ans plus jeune que sa sœur, eut atteint l’âge de se faire une situation, une fois sorti du collège, maman grand eut l’idée de l’envoyer auprès d’elle, espérant que le mari de celle-ci lui faciliterait l’accès à une situation, avec l’aide de ses nombreuses et opulentes relations. Malheureusement mon oncle GOMEZ, habitué à vivre en grand seigneur, ne vit pas d’un bon œil ce désir de travailler de son jeune beau-frère. Celui-ci arrivé à la sucrerie fut entraîné dans un tourbillon de plaisirs : promenades à cheval, chasse, bals, réceptions, rien ne manquait, si ce n’est le temps réservé au travail. J’ai entendu donner à mon père, comme excuse à la stérilité de sa vie, cette période trop facile à un âge où l’on doit se former à l’effort, c'est-à-dire de 16 à 21 ans. Cependant une des sœurs de mon oncle fut attirée par la grâce et le charme de ce jeune Français, qui contrastait, avec sa blondeur, ses yeux bleus et sa peau blanche, avec les jeunes hommes de son pays. Je ne m’étonne guère d’ailleurs de ce choix car j’ai toujours trouvé à mon père un charme, une beauté et une distinction qui me le faisaient trouver supérieur à tous les hommes à qui je le comparais.
Il avait une finesse de traits qui, cependant ne lui donnait pas un air efféminé, car son nez busqué était assez accentué pour lui donner du caractère, et corriger ce que les yeux bleus et la bouche bien arquée aurait pu avoir de trop doux. Il avait les cheveux régulièrement ondés et le coiffeur lui avait dit une fois : combien de femmes donneraient gros pour avoir de telles ondulations. Je ne me souviens de lui que portant la barbe à la Henri IV, et je vois encore ma mère lui retirant en souriant les premiers poils blancs qui y apparaissaient. Mais revenons en arrière. Donc Dolorès GOMES del RUNCO s’éprit de mon père qui, alors âgé de 21 ans, avait une dizaine d’années de moins qu’elle. Je crois que ce second mariage ne fut pas du goût de tous, mais il se conclut cependant sans trop de difficultés, en France ? En effet, à la suite de différents évènements survenus à Cuba, entre autre la révolution, toute a famille GOMEZ était revenu en Europe. Ma tante (Eugénie Huault Gomez del Runco) qui, a 33 ans eut son treizième enfant, eut les quatre derniers dans son pays. La situation de mon oncle (Philippe Gomez) avait été très ébranlée par la mauvaise administration des sucreries confiée à un fondé de pouvoir, durant les voyages à l’étranger. Il vendit ensuite à des conditions désastreuse, pour lui et ses sœurs, ses plantations ; enfin, sans savoir exactement ce qui se passa, j’ai cru comprendre que sa fortune était très amoindrie quand il vint en France. Peu de temps après son mariage, la femme de mon père tomba gravement malade : une fluxion de poitrine ? Congestion pulmonaire sans doute ? Et elle mourut après 6 mois d’union. Mon père au même moment était, lui aussi, dangereusement malade. Je sais qu’il eut la fièvre typhoïde, sans doute était-ce à ce moment. Après cette fugitive union mon père vécut à nouveau avec sa mère, il acheta en Touraine, non loin de son pays natal, Chinon, le château des Mariaux.
Sa sœur, son beau-frère et leurs enfants se joignirent bientôt à eux, mais quelques années plus tard, les aînés qui avaient sept ou huit ans seulement de moins que mon père eurent avec lui quelques difficultés, les cousins, comme de jeunes chevaux échappés, parcouraient la campagne avec leurs chiens, chassant sans s’occuper des moissons, ou vendanges. Mon père voyait naturellement cela d’un mauvais œil, car cela n’arrangeait pas les affaires. Enfin, un beau jour, mon oncle, dans un coup de tête, prit la défense de ses fils, et acheta non loin de là une autre propriété : le château du Plessis. Il se lança alors, sans connaissances suffisantes, dans la grande culture et l’élevage, et, en peu de temps, il finit de perdre les débris de sa fortune. C’est durant ces années des Mariaux et du Plessis que Maman-grand se trouva souvent obligée de faire certaines remarques à son gendre et à ses petits enfants, trop habitués à la vie large, et ne comprenant pas qu’il était grand temps d’y renoncer : et c’est de là que lui vint cette réputation de femme autoritaire et que découle le peu de sympathie que lui témoignait ma cousine Amélie, qui, trop jeune pour juger, dut entendre souvent les plaintes des uns et des autres. Après plus de 10 ans de veuvage, à 32 ans, mon père se remaria avec ma mère qu’il avait connue toute jeune, mais qu’il avait perdue de vue depuis 2 ou3 ans. La dernière fois qu’il avait vu ma mère celle-ci n’était encore qu’une fillette, dans l’âge ingrat ; quand il la retrouva lors d’un voyage à Paris, il fut surpris de la trouver si embellie et si changée. J’avais cru, jusqu’à ces temps derniers, que mon père avait été très influencé par sa mère, qui, connaissant maman, savait qu’elle avait été élevée de façon à faire une excellente maîtresse de maison, susceptible de la remplacer et qui, momentanément serait assez malléable, étant donné son jeune âge. Après avoir relu la correspondance laissée par ma chère maman, j’ai changé d’avis ; je crois vraiment que mon père fut subjugué par la gracieuse jeune fille qu’il retrouvait. Pourtant est-il resté si longtemps sans voir ma mère ? En y réfléchissant, je ne le crois pas et quelques mois peut-être suffirent à la métamorphose, car de son côté, maman avait un tendre sentiment pour papa, qu’elle trouvait, elle aussi, mieux que tous les jeunes gens qu’elle connaissait. Si bien que chaque fois qu’un projet de mariage échouait pour lui, elle espérait qu’un jour, peut-être, il s’intéresserait à elle. Ce jour vint donc où les yeux de mon cher papa s’ouvrirent et où il demanda la main de maman.
Celle-ci qui, toute jeune, avait toujours dit, 1° qu’elle n’épouserai pas un homme plus âgé qu’elle, 2° qu’elle n’épouserai jamais un veuf, 3° qu’elle ne vivrai jamais avec sa belle-mère, passa sur ces trois inconvénients en acceptant mon père, qui avait 14 ans de plus qu’elle, mais qui était gai et très jeune de caractère, qui avait été marié, mais si peu de temps, et dans de telles circonstances, que ce premier mariage ne lui portait pas ombrage, et enfin qu’il voulait continuer à vivre avec sa mère, ce dont elle ne s’effraya pas, connaissant de longue date ma grand-mère, qui avait sans doute su gagner son cœur, ou qui trouvait grâce à, ses yeux, étant la mère de celui qu’elle aimait et aima toute sa vie si tendrement. Au physique maman était une jolie brune, grande sans excès, et bien proportionnée ; elle n’avait certes pas une beauté académique : sa bouche était un peu grande et la lèvre supérieur très légèrement trop mince, mais elle s’ouvrait sur de jolies dents blanches, en forme d’amande ; son nez avait l’extrémité un peu trop arrondie, mais elle avait de jolis yeux, dans l’ensemble couleur de noisette mure, mais dont l’iris vue de près, était striée de tons allant du jaune d’or au marron, et cerclé d’un ton brun foncé. Ces yeux étaient surmontés de sourcils noirs admirablement bien arqués, et de cheveux d’ébène souples et abondants ; un tain de brune, légèrement coloré, complétait cet ensemble aimable. Mon père et mère formaient ce qu’il est convenu d’appeler un beau couple, et, bien souvent, j’ai entendu des compliments sur eux qui flattaient mon amour filial. Même dans les dernières années de leur vie, ils gardaient tous deux un charme proportionné à leur âge et qui faisait l’admiration de leurs amis. Papa et maman s’installèrent après leur mariage, aux Mariaux, avec grand-maman. Celle-ci offrit à sa bru de prendre la direction de la maison, mais ma mère se récusa, n’étant pas avide à ce moment d’autorité et préférant être plus libre pour accompagner son marin, et, plus tard, s’occuper de ses enfants. Elle me racontait que, toute jeune femme, ayant été un jour à la cuisine, elle souleva un couvercle de casserole pour voir ce qui avait été commandé pour le repas, et la cuisinière en grande colère lui avait dit : « Que madame ne touche pas à mes casseroles, quand j’étais chez moi et que mon mari faisait cela, je lui jetais une poignée de poivre à la figure…. ». Charmant petit caractère.
Maman, la première année de son mariage, allait à la pêche sur la Vienne, au bout du parc avec mon père ; cette rivière était très poissonneuse, et maman se souvenait souvent avec plaisir des pêches de goujons merveilleuses qu’elle avait faites. Elle allait aussi à la chasse et me disait que, sans doute ces plaisirs goûtés avant la naissance de mon frère, étaient cause de son tempérament de pêcheur et de chasseur. Ce tempérament, il le tenait aussi de mon grand-père maternel qui était un pêcheur et chasseur enragés. Avant le mariage de sa fille, il était l’ami de son futur gendre, comme sa mère, Madame Mossé, devenue Madame Deswatines en secondes noces, était l’ami de maman grand, et ils venaient souvent pêcher et chasser aux Mariaux. Cette madame Deswatines était, on se le rappelle, l’amie trop aimée de l’oncle Fortuné, qui fit d’elle un charmant portrait, appartenant à mon frère depuis la mort de ma chère maman. (Ce tableau est maintenant chez Marie-Claude Huault Chapuzet).
Cette grand-mère, très aimée de maman, l’avait élevée jusqu’à l’âge de 7 ans. Le père et la mère de maman avaient en en effet un commerce de vin en gros et d’épicerie qui les absorbaient beaucoup, et la fillette avait trouvé chez sa « maman Deswatines », ainsi qu’elle l’appelait, la tendresse et les soins qui lui auraient fait un peu défaut chez ses parents. Loin de moi la pensée de sous-entendre qu’elle n’était pas aimée chez elle, mais mon grand-père était un homme d’affaire actif qui ne semblait pas s’embarrasser beaucoup de complications sentimentales, et ma bonne grand-mère était suffisamment occupée à satisfaire les exigences de son bouillant époux. Pauvre grand-père, je l’ai peut-être un peu méconnu durant sa vie, et depuis la lecture des lettres trouvées chez maman, à sa mort, je lui ai fait, jusqu’à un certain point, amende honorable. Cet homme que j’ai connu grognon s’emportant avec une facilité déconcertante, paraît avoir été dans sa jeunesse, gai, bon vivant et affectueux camarade pour mon père. Maman disait bien qu’elle avait connu son père ainsi, mais moi, je ne pouvais me le représenter de la sorte. Quelques unes de ses lettres à mon père avant son mariage ont levé le voile sur un passé inconnu de moi, et j’y ai contemplé avec surprise un grand père tout différent, et devenu sympathique. Qu’est-il survenu qui a changé ainsi son caractère ? Un drame intime sans doute. Je me souviens avoir entendu dire à ma mère que son père, qui avait toujours été heureux de lui faire plaisir avant son mariage, avait changé beaucoup après. Un sentiment de jalousie sans doute, insoupçonné de lui-même, avait dû peu à peu envahir son coeur. Il en voulait à ce gendre de 7 à 8 ans années à peine plus jeune que lui de l’avoir supplanté dans l’affection de sa fille unique. Ceci est une supposition toute gratuite, mais plausible. J’ai lu une lettre où mon grand-père se plaint mélancoliquement à mes parents, jeunes mariés, de ne pas écrire assez souvent, et il site à ma mère la chanson sentimentale du nid abandonné… Un grand-père Mossé sentimental voila ce qui bouleverse toutes mes conceptions… Quelques malentendus, des question d’intérêts aussi ont dû finir d’envenimer une situation déjà tendue et voilà né le grand-père que j’ai connu, peu attirant, et irascible à l’excès… Une véritable soupe au lait, disait ma grand-mère excellente personne qui opposait à cette mauvaise humeur fréquente de son mari une patience et un calme à toute épreuve.
Un jour que celui-ci, d’un peu loin, lui parlait, elle répondit : oui… oui… oui…, sur quoi sa fille lui demanda : mais que dit papa ? Oh je ne sais pas, répondit grand-mère, mais il faut toujours dire oui ! Ce caractère qui s’était envenimé, si je puis dire, n’avait jamais dû cependant être d’une douceur extrême, car il paraît qu’habitant dans la même maison que sa fiancée, lorsqu’il amorçait une colère, il se calmait à l’idée que mademoiselle Joséphine pourrait entendre. Et puis comme après tout il n’était pas méchant, il passait ses colères sur les chaises, et, comme dans les noces de Jeannette, il fallait, chez lui, choisir la bonne. Je me souviens avoir dit à ma grand-mère : je ne te comprends pas, si tu lui avait un peu résister autrefois, au début de ton mariage, il ne serait pas ce qu’il est ; ma jeune expérience ne savait pas encore qu’il est des caractères devant lesquels tout se brise : patience, douceur ou fermeté.
Pour moi, je fut baptisé «la petite péronnelle» un jour ou je lui résistais et lui dit son fait parce qu’il avait été, à mon avis, d’une injustice criante à l’égard de mon père. Pouvait-il y avoir deux caractères plus opposés que ceux de ces deux anciens amis :. Mon père nature d’artiste, remplie d’idéal ; mon grand-père fort réaliste et positif ; mon père n’ayant jamais rien entrepris en raison de ce que j’ai expliqué et des circonstances de sa vie ; mon grand-père que la sienne avait forcé, au contraire, à se débrouiller seul, tout jeune ; fier de la fortune acquise par son travail et son esprit d’entreprise, accrue par son économie. Pour lui, à l’époque, un sou était un sou et il avait coutume de dire, lorsqu’il avait été au théâtre, « au poulailler », comme on disait vulgairement, qu’il avait pris tout autant de plaisir que s’il avait été au fauteuils d’orchestre. De même, après un voyage en 3ème classe, il constatait avec satisfaction qu’il était arrivé aussi vite, et avait quelques dizaines de francs de plus dans sa poche. Mon père aurait été, au contraire, plutôt dépensier ; il lui fallait les doux freins de sa raisonnable épouse pour le retenir sur une pente où il aurait glissé très facilement. Il avait une nature généreuse et la main toujours prête à s’ouvrir. Il n’est pas étonnant que deux natures si dissemblables se soient heurtées en se trouvant plus fréquemment en présence, et, durant le mois de septembre, que nous passions régulièrement, tous les ans à Freneuse, que de bourrasques le baromètre familial n’a-t-il pas enregistré ?... Mais en parlant de mon grand-père, je suis arrivé à une époque éloignée du mariage de mes parents. Je reviens en arrière et les retrouves à ces Mariaux qui abritèrent leurs jeunes amours. Mon frère Frédéric naquit le 27 avril 1882, un an après le mariage de mes parents, qui avait eu lieu les 9 et 11 mai 1881 à Issy le Moulineaux où habitait ma mère avec ses parents. Frédéric était un fort beau bébé qui fit l’admiration de toute le famille, paraît-il. On convia au baptême les grands parents, grands oncles et grandes tantes etc…etc… et ce fut une grande fête. Le parrain était Hyppolite Desmarquais un charmant homme pacifique au possible, qui avait horreur de la moindre discussion.
Il était le frère cadet de mon arrière grand-père Jules Desmarquais, père de la grand-mère Joséphine Mossé (née Desmarquais). C’était un ancien entrepreneur de peinture qui avait acquis une jolie fortune et occupait ses loisirs en faisant du paysage, ce en quoi il excellait. Il exposait jusque dans les dernières années de sa vie au salon des Artistes Français, où il avait obtenu des mentions honorables et une fois même une troisième médaille. Nous avons de lui de bons paysages dont nous sommes fiers, comme des portraits ou copies de tableaux du Louvre qui viennent de notre oncle Fortune Viau, oncle de notre père. Cet oncle Hyppolite éprouva très vite une grande amitié pour papa, amitié qu’il lui conserva jusqu’à sa mort et qui fut payé de retour ; en effet j’ai toujours entendu mon père parler de l’oncle Desmarquais avec affection.
C’est pendant les voyages que mon oncle fit aux Mariaux qu’il donna le goût de la peinture à mon père. A trente ans passés, celui-ci s’y donna avec tant d’ardeur qu’il fit des progrès rapide et le maître fut vite satisfait de son élève. Depuis, bien des fois, ils partir ensemble à la recherche du site qui tenterait leurs yeux d’artistes. Mais il avait été convenu je crois que maman ne resterait pas toujours à la campagne et qu’après avoir liquidé la propriété des Mariaux le jeune ménage, ainsi que ma grand-mère Huault reviendraient à Paris. Maman n’a jamais beaucoup aimé la campagne ; pour moi, il me semble que j’aurais quitté avec peine ce petit château, admirablement situé, sur une légère hauteur, non loin de la Vienne qui passait au bout du parc, et à laquelle on accédait par deux superbes allées qui partaient de chaque côté, non loin de l’habitation, et se rejoignaient pour former un petit bois qui longeait la rivière. La vue devant la maison n’était donc pas bornée, mais se reposait sur le grand pré dévalant jusqu’au bosquet du côté de l’entrée, 2 ou3 arbres verts en toutes saisons, une petite serre séparaient la maison de la route, et sur le côté une ferme. J’ai vu vers l’âge de 16 ans non sans émotion, ce coin de Touraine dont j’avais tant entendu parler et que j’aimais sans le connaître Le château (c’est un nom légèrement pompeux pour cette habitation) avait brûlé en partie et avait été reconstruit, je crois, un peu différemment, tout au moins quant à la toiture qui devait être autrefois une terrasse à l’italienne ou, au contraire, comportait maintenant ce genre d’architecture qui n’existait pas autrefois. Depuis 40 ans, mes souvenirs ne sont plus précis dans les détails. Je me souviens que l’on me fit admirer les belles pièces du bas : le billard, le grand salon, on me fit remarquer la chambre où naquit mon frère, mais les autres parties de la maison, entrevues dans cette fugitive visite, s’estompent dans ma mémoire. O choses inanimées, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?…ces vers du poète, combien je les trouve vrais et combien j’ai eu de mélancolie à quitter certains cadres de ma jeunesse heureuse. Je ne sais si ma mère éprouva ces regrets, toujours est-il que mon père et elle revinrent non loin de leurs parents, dans la région parisienne, à Ablon, en Seine et Oise, après avoir vendu les Mariaux. Là ils restèrent fort peu de temps, je crois ; moi-même n’y restait que 6 mois après ma naissance, qui eu lieu deux ans et demi après celle de mon frère. Ce séjour à Ablon, pour mes parents comme pour moi, n’eut pas d’histoire. De là ils vinrent se fixer à Clamart, gentil pays presque uniquement formé de coquettes maisons enfouies dans des jardins, et situé en bordure de la forêt du même nom. Je crois que l’oncle et la tante Desmarquais avaient beaucoup insisté pour que leurs petits neveux viennent les rejoindre, car ils habitaient là un charmant pavillon. Mon père loua donc un appartement dans une maison non loin de chez eux. Ma tante Desmarquais tenait sa maison avec un soin méticuleux aidée par la bonne Rosalie qui n’eut jamais d’autres maîtres, comme mon oncle et ma tante n’eurent point d’autre servante. Pauvre Rosalie qui se maria tardivement, après la mort de mon oncle (resté le dernier sur terre). Elle était mon rayon de soleil quand j’allais chez tante Desmarquais, car dés que je sus comprendre, on m’apprit que dans ce royaume de la propreté, où ma tante était reine, les sujets, s’ils ne devaient pas marcher sur la tête, étaient du moins astreints à des règlements qu’il ne fallait pas enfreindre. On devait, en entrant, s’essuyer les pieds, ce qui est normal, mais avec une application qui nous faisait tous ressembler à des jouets mécaniques bien remontés ; ensuite il fallait, par des enjambées plus ou moins longues atteindre de petits tapis qui jalonnaient le plancher ciré, comme les pierres d’un gué jalonnent la rivière. Lorsqu’on avait atteint son siège sans glissade, il fallait y demeurer bien sagement. C’est alors qu’intervenait la providence, en la personne de Rosalie, qui trouvait quelques prétextes pour m’attire vers la cuisine où le premier ministre de ma tante trônait dans un étincellement de cuivres : casseroles, chaudrons, ornements de la cuisinière, tout cela brillait à se mirer dedans. Certes notre appartement était tenu admirablement, mais il y avait ici un je ne sais quoi, une minutie de propreté, qu’il est impossible de décrire. Ma tante avait eu un fils, Henri, qu’elle perdit à vingt ans d’une maladie de poitrine, malgré des soins assidus et le séjour à la montagne ; la maladie n’ayant pas été décelé assez tôt, à la suite d’un refroidissement. C’est de ce deuil cruel que venait sans doute cet ait de mélancolie dont le visage de ma tante était empreint, et qu’un sourire éclairait rarement. J’ai entendu rapporter par mes parents de la boutade de ce fils, au sujet de la propreté de sa mère. Comme quelqu’un lui demandait où elle se trouvait. : « Ma mère, répondit-il, elle doit être ne train de laver son charbon ». Il était recommandé quand on se rendait chez ma tante, de ne plus venir de la maison au jardin et du jardin à la maison ce qui aurait pu être désastreux pour le plancher ; quoique, à vrai dire, les petits cailloux qui tapissaient les allées étaient si sagement alignés et si propres qu’ils n’auraient pu en rien souiller nos semelles. Autre recommandation : Les rideaux, qu’il ne fallait pas toucher, ou bien soulever légèrement entre le pouce et l’index, comme s’ils avaient la fragilité d’une aile de papillon. De monter sur les sièges il n’en était pas question nous étions, mon frère et moi, assez bien élevé pour ne pas nous permettre cette licence. Malgré toutes ces contraintes, je goûtais un certain plaisir à me trouver dans cette maison où l’arrangement heureux, l’ameublement bourgeois, était relevé d’une touche artistique qui venait de mon oncle, et d’un luxe de propreté, cachet de ma tante. Celle-ci était une jolie vieille, avec son teint frais, ses yeux bleus, ses cheveux blancs aux bandeaux naturellement ondulés, ses dents rangées comme des perles, qui, je l’ai su plus tard, faisaient honneur à son dentiste. Elle avait un tic dans les moments d’émoi ou de contrariété, qui lui faisait imperceptiblement, mais vivement, tourner la tête de droite à gauche, dans un mouvement qui surprenait mon observation enfantine. Mon oncle (Hyppolite), lui, était un beau vieillard, très grand et corpulent, sans être gros ; il avait gardé malgré le malheur qui l’avait frappé, une gaieté de caractère qui le mettait au diapason des plus jeunes ; mais moi j’étais encore trop petite pour apprécier ses boutades, et suivre les jeux de la conversation, et les repas interminables auquel il me fallait assister en tête à tête avec mon assiette et la nappe blanche qu’il ne fallait pas souiller, m’ont laissé un souvenir des plus mélancoliques, pour ne pas dire d’avantage. Je n’ai jamais eu un gros appétit, et je n’ai jamais été ce que l’on appelle une gourmande, mes satisfactions gastronomiques ne pouvaient donc en rien compenser l’incompréhension de mon esprit.
A propos de gourmandise je me souviens avoir mangé, chez ma tante, des confitures de fraises comme je n’en ai jamais mangé depuis ailleurs. Quel goût, quel parfum, quel onction !... C’était un véritable chez d’œuvre du genre. Avec mon oncle et ma tante habitait la sœur de celle-ci : Madame Champy que j’appelais ma tante, et qu’il me fallait embrasser, ce qui me répugnait un peu car elle avait un eczéma qui lui recouvrait le visage, comme tout le corps, d’une quantité innombrable de petites pellicules blanches, se levant sur un fond de teint rouge. Ma tante la soigna avec un grand dévouement jusqu’à sa mort. Madame Champy partie en effet la première. Mais tous ces souvenirs dont je parle ne datent pas du temps où nous habitions Clamart que j’ai quitté à 3 ans, mais d’un peu plus tard. Mes parents, en effet, étaient harcelés par le grand-père Mossé qui désirait les voir habiter dans une de ses maisons à Issy les Moulineaux. On le contenta donc, en mécontentant le ménage Desmarquais qui, lui, désirait nous garder dans son voisinage. Ce changement ne fut pas très salutaire aux relations de mes parents et grands-parents. Dés ce moment il y eut je croit des relations orageuses. J’ai peu de souvenir de cette époque. Je crois revoir très vaguement maman’grand dans les derniers moments de sa vie, ou bien mon imagination se la représente d’après ce que j’ai entendu dire de son physique, ou d’après les portraits que nous en gardons. Je vois un visage plutôt sévère dont les traits assez réguliers sont encadrés de boucles encore brunes, à la mode du Second Empire. Elle était très ridée, paraît-il, et la soeur jumelle de mon oncle Desmarquais, ma tante Bouchard, dans une gouaille de gavroche Parisien, la nommait l’ « indéplissable ». Pourtant elle avait dû garder un grand air de jeunesse dans sa tournure, tout au moins, car, un soir qu’elle avait accompagné mon père au théâtre, avant son remariage, et qu’il l’avait laissé seule un moment pour faire l’achat de cigarettes, un inconnu l’avait abordé en lui proposant de la reconduire chez elle. Ce à quoi, se tournant vers un réverbère, elle lui avait répondu en riant : « mais vous ne m’avez pas bien regardé mon pauvre ami ». Mon père en la voyant ainsi parler à un inconnu qui s’éloignait à son arrivée, lui demanda ce dont il s’agissait ; elle lui fit une réponse évasive, et, quand ils furent plus loin, elle éclata de rire en avouant à mon père ce qui venait de se passer. Elle n’avait voulu lui dire plus vite, craignant un mouvement de mauvaise humeur de son fils et une algarade entre lui et l’indiscret passant. Ma grand-mère mourut vers 1888, je crois, dans ce pavillon que nous habitions au 21 de la rue Ernest Renan. À Issy.
Deux ou trois ans plus tard s’éteignait aussi mon bisaïeul père de ma grand-mère Mossé, Jules Desmarquais, frère aîné d’Hyppolite. C’était, lui, un grand et sec vieillard dont la belle tête était couronnée de superbes cheveux blancs Je me souviens bien de lui qui habitait dans un immeuble de rapport de son gendre au 30 de la rue Ernest Renan Cet immeuble que grand-père avait fait construire quand il s’était retiré des affaires, avait été bâti sans le secours d’un architecte, grand-père dirigeant ses ouvriers et les entraînant de son exemple car il ne craignait pas de mettre la main à la pâte. Cet immeuble existe encore en bon état. Quoique j’ai dit que je n’étais pas gourmande, le souvenir le plus saillant qui me reste de mon bisaïeul c’est l’habitude qu’il avait de nous donner, quand nous aillons le voir, des petits morceaux de chocolat qui étaient coupés à l’avance et renfermé dans un bocal de verre. Je crois que mon bisaïeul avait gagné ce qu’il possédait étant associé à son frère, mais je ne l’affirmerai pas. J’ai entendu dire que Jules Desmarquais était d’une rigide probité ; très pointilleux sur l’honneur. Devenu conseiller municipal d’Issy, il donna sa démission à la suite d’une offre de pot de vin quelconque, et voyant que ses collègues mettaient leurs intérêts propres au dessus de ceux de la commune.
Lui aussi faisait du paysage, mais plus vieux que son frère d’une dizaine d’années, il évolua moins vers la peinture plus moderne et ses tableaux ont une teinte un peu sombre et une rigidité qui ne sont plus de mode. L’art cependant n’a pas d’âge mais quant à moi je trouve ses toiles moins à mon goût que celle de son frère. Quelle bonne personne était sa fille la femme de mon grand-père Mossé. Comme le poète je peux dire d’elle :
Grand-mère était la gaieté même, Depuis que j’ai commencé ce journal ; mon jeune fils ma récité la fable qui contient ces vers, saisis au vol, car il peignent bien ma grand-mère, toujours souriante, malgré les sujets de mauvaise humeur qu’elle aurait pu avoir du fait de son mari. Elle prenait tout du bon côté. Sa belle mère madame Deswatines avait coutume de dire qu’elle avait été créée et mise au monde pour son fils. Voila un beau compliment de la part d’une belle-mère.
D’un autre côté son gendre lui vouait une réelle affection car il avait été conquis par sont caractère aimable et conciliant. Elle avait du être, dans sa jeunesse, une petite brunette très agréable, avec de jolis cheveux très frisés dans lesquels les trois petits velours qu’il était à ce moment de mode de porter, disparaissaient 5 minutes après la coiffure terminée. Elle avait une toute petite bouche, sur laquelle la plaisantait irrespectueusement son gendre, parfois à table, parce qu’elle avait toutes les peines du monde à y faire passer la salade de pissenlits dont elle était très friande, quelques brins récalcitrant se refusant parfois à franchir cet orifice trop exigu. A ce moment dont je parle, elle était devenue assez boulotte et le qualificatif que lui donnait une de nos amies, « la petite marquise », à cause de ses cheveux blancs sans doute, ne me semblait pas absolument lui convenir. Toujours très proprement mise, je ne la trouvais pas assez élégante (par la faute de son mari), car j’avais pu constater 2 ou 3 fois, dans les grandes occasions, que la toilette, malgré sa rondeur, lui allait très bien. Mais, pour mon grand-père, acheter des colifichets c’était absolument jeter l’argent par les fenêtres. Maman avait été une fois très amusée car il lui avait été reproché de me donner des goûts dispendieux en me voyant une petite robe à carreaux blanc et rose, or la pauvre robe incriminée avait coûté onze sous le mètre !
Mon grand-père, toujours très propre, lui aussi, s’embarrassait peu du pli de son pantalon très propre. Il l’était grâce aux soins de son épouse, que j’ai entendu s’exclamer souvent, qu’il irait aussi bien en habit sur les toits, ou gâcher du plâtre, qu’avec son vêtement de travail. Il surveillait en effet de très prêt ses ouvriers lorsqu’il faisait construire ou réparer sas maisons, et en faisait volontiers plus qu’eux. Cependant il avait été lui aussi élégant, paraît-il, et portait bien l’habit ; cela me semblait de la légende, ainsi que son amour du bal. Ma grand-mère et lui y allaient assez souvent, et quand maman fut en âge de s’y rendre on voulut l’y emmener ; mais celle-ci d’une pudeur extrême, ayant résolu qu’elle ne se présenterait pas les bras et la gorge nus, en public, ce fut une belle scène et mon grand-père décréta que personne ne sortirait plus, puisqu’il serait ridicule que les parents ayant une fille en âge de danser la laissassent à la maison. Pour être exacte, je dois reconnaître que mon grand-père, connu comme facilement irascible, eut pour sa fille, enfant, une certaine douceur qu’il n’eut pas pour beaucoup d’autres. C’est ainsi que maman me disait, à mon grand étonnement, avoir reçu pas mal de gifles de sa mère, alors son père n’avait jamais levé la main sur elle. Il est vrai, ajoutait-elle, que maman était souvent énervée par les exigences de son époux et de la clientèle ; alors, dans ces moments d’exaspération, la claque était aussi vite tombée qu’elle était promise. Ma grand-mère Mossé avait un frère, Louis Desmarquais qui mourut jeune, vers 40 ou 42 ans de tuberculose. Ces deux hommes Hyppolite et Jules Desmarquais qui furent de si robustes vieillards et vécurent plus de 80 ans, perdirent tous deux leurs fils de la même et triste maladie. Louis Desmarquais avait épousé une jeune fille qui avait été élevée en Allemagne jusqu’à l’âge de 17 ans : Céline de Brancas, son père y avait une industrie et des intérêts. Lorsque la guerre de 1870 éclata, sa sympathie semblait aller à nos adversaires et souvent elle répétait à son mari très patriote : « ils gagnerons tu ferras qu’ils gagnerons » car elle avait un très léger accent tudesque. Cette prophétie, si souvent répétée, mettait son mari et sa famille dans une légitime exaspération et mon grand-père dit un jour à sa belle-sœur : « C’est bien, c’est bien ils gagneront mais f…. nous la paix. Mes grands-parents restèrent une certaine partie de la guerre à Issy, mais les bombardements ayant mis ma mère, qui avait alors 7 ans, dans un état d’énervement préjudiciable à sa santé, il fut décidé, sur l’avis du docteur, qu’on l’emmènerait à Clermont Oise dans une propriété appartenant aux grands-parents David, parents de Madame Deswatines. Grand-père et grand-mère y emmenèrent donc maman. Je crois que grand-père dut revenir car il devait être chargé, en partie, du ravitaillement des troupes du fort de Vanves. Sa mère ne voulue point quitter sa maison, voulant garder des meubles. On avait mis aux fenêtres matelas et couvertures pour protéger des balles, mais à la fin du siège les pauvres armoires et autres meubles n’en n’avaient pas moins reçu quantité d’éclats d’obus. Pendant la commune qui suivit, Madame Deswatines un jour appréhendée dans la rue, mise au mur par les communards, faillit être fusillée, car elle avait été prise pour une autre personne. Heureusement quelqu’un la connaissant vint à passer et certifia qu’elle était femme d’un professeur du lycée et elle fut relâchée. Mais elle avait eu une telle révolution qu’on la supposa à l’origine de la maladie qui devait l’emporter 9 à10 ans plus tard. Elle mourut en effet quinze jours après le mariage de maman d’hydropisie. On lui avait fait une première ponction qui l’avait soulagée d’une quinzaine de litres de liquide, mais celui-ci se reforma au bout d’un certain temps, et entraîna cette fois sa mort à l’age de 59 ans.
Quand elle était au plus mal et que les siens ne pouvaient cacher leurs larmes, c’est elle qui se montrait la plus vaillante et relevait le courage de tous. Maman aimait beaucoup sa grand-mère et cette affection était réciproque. Quand le mariage de mes parents fut décidé, maman Deswatines dit à sa petite fille : « et bien maintenant je puis mourir en paix je sais que tu sera en bonnes mains. » Étant veuve, très jeune encore, du père de mon grand-père Mossé, elle se remaria avec Monsieur Deswatines professeur au lycée de Vanves. Son premier mari lui avait dit : « je suis tranquille, tu es jeune, tu es jolie, tu te remarieras, quant à Édouard, il a la bosse du commerce il se débrouilleras », ceci avec un accent du midi, car il était originaire de Marseille. Mon bisaïeul, en effet, voyageait de ville en ville avec une voiture, vendant des tissus, il avait déjà jugé des aptitudes de son fils malgré son jeune âge. Je me souviens avoir encore vu, dans ma petite enfance, quelques unes de ses énormes voitures, véritables magasins roulants très bien achalandés. Mon arrière grand-mère, avant d’épouser son second mari, avait été recherché par le frère de celui-ci, le docteur Deswatines ; un jour qu’il était venu lui faire la cour, il avait éloigné mon grand-père, qui avait alors une douzaine d’années, en l’envoyant acheter des gâteaux, mais celui-ci, qui avait l’esprit éveillé, se doutant qu’il se tramait quelque chose qu’on voulait lui cacher, écouta à la porte et entendit son futur beau-père parler du fameux projet ajoutant : « nous mettrons Édouard au lycée…» mais il n’en écouta pas davantage, rentra furibond, et chassa sans ménagement celui qui voulait l’éloigner de sa mère. Le frère de l’évincé, plus adroit, fit au contraire beaucoup de promesses… qu’il ne tint pas toutes, je crois, ce dont mon grand-père ne lui garda pas rancune, car il estima que cela lui avait rendu service. En effet, Mr Deswatines ne garda pas mon grand-père auprès de lui, il ne le mit pas non plus au lycée, mais à Saint Nicolas qui était une école tenue par des Frères et dans laquelle on faisait autant de travail manuel que de travail intellectuel. Mon grand-père, quoique intelligent, mordait peu à l’étude d’ailleurs, et son beau-père, professeur , habitué à juger les enfants, avait peut-être apprécié qu’ils serait mieux dans son élément à Saint Nicolas qu‘au lycée. Grand-père était très adroit de ses mains, et j’ai entendu souvent mon père dire : « c’est inconcevable ce qu’Édouard est adroit, avec ses gros doigts il vient à bout du travail le plus minutieux. ». Encore un point qui le différenciait de mon père qui ne pouvait enfoncer un clou sans se taper sur les doigts. Grand-père, quand sa mère fut morte, n’abandonna pas son beau-père ; il le reçu chez lui, ma grand-mère le soigna comme une fille lorsqu’il fut malade. Il dut mourir 3 ou 4 ans plus tard, d’un osteosercum, à Freneuse Seine et Oise où mes grands-parents avaient acheté une maison qu’ils habitaient les beaux mois de l’année. Le reste du temps ils occupaient une partie du pavillon qui nous abritait nous-même, quand j’avais de 3 à 6 ans. Je commençais les études chez les sœurs grises (ainsi dénommées) je ne sais de quel ordre, qui avaient un pensionnat non loin de la maison.
De ces débuts j’ai le souvenir d’une page de bâtons, d’une leçon de catéchisme, et surtout d’une attente prolongée au parloir, un jour où ma mère était un peu en retard pour venir me chercher. Je ne puis dire à quel point ce temps me parut long, et l’immensités de ma détresse… c’est de le jour, sans doute, que date l’impression de mélancolie ressentie longtemps en entendant le tic tac d’une pendule. Mais les incompréhensions mutuelles, sans doute, décidèrent un jour mes parents à s’éloigner de mes grands-parents et à choisir un nouveau gîte. C’est alors qu’ils louèrent un appartement à Levallois Perret Place de la République, immense place où bientôt on construisit l’Hôtel de Ville, majestueux bâtiment qui fut entouré de jardins et d’arbres agréables à la vue. Nous habitions un entresol, fort plaisant, ensoleillé, et suffisamment vaste : deux chambres assez grandes, salon, salle à manger, cuisine, cabinet de toilette. Mon frère qui était pensionnaire devait se contenter à ses sorties d’un lit cage à l’extrémité du couloir qui longeait tout l’appartement. Frédéric, quand nous étions à Issy, avait été externe chez les Jésuites, vers la porte de Vaugirard, mais quand nous fûmes à Levallois, il fût mis pensionnaire à Passy. Il ne s’y plut pas énormément et à la suite d’une explication que papa eut avec le supérieur on retira Frédéric ce cette pension où il avait eu à se plaindre d’un professeur peu recommandable. Aurais-je, en approfondissant mes études, mieux gardé ce que j’avais appris ? Je ne sais, mais j’avoue, à ma grande honte, qu’il me reste bien peu de chose de mon bagage scolaire. Ces années d’études étaient couronnées tous les ans par des vacances agréables. Nous allions régulièrement passer un mois au bord de la mer, puis le mois de septembre à Freneuse, chez mes grands-parents. Nous allâmes aussi à Saint Valery en Caux, Saint Aubin, (une année avec le ménage Desmarquais et mes grands-parents Mossé). Très coléreuse, et l’air de la mer m’excitant sans doute, j’y fit quelques bonnes petites scènes, une entre autres, un jour que je voulais aller au casino et que j’avais compris dans la conversation, à mots couverts, de maman et de grand-père qu’on avait l’intention de me coucher avant que les grandes personnes ne partent en soirée. Ma pauvre maman ne pouvait arriver à me déshabiller car j’avais aussi vite renfilé mes vêtements qu’elle les avait ôtés. Une autre fois j‘affolais la plage en poussant des cris perçants parce que maman était ai bain et, qu’ayant horreur et frayeur de l’eau, je m’imaginais qu’elle allait s’y noyer. Ma pauvre tante Desmarquais qui, me gardait au bord du flot eut assez de mal à se faire comprendre du public qui la prenait à partie, croyant qu’elle voulait me forcer à me baigner. Mais j’étais à ce moment là encore toute petite. Mon frère était beaucoup plus pacifique, mais il était taquin comme pas un ; alors il en résultait des disputes orageuses auxquelles, un jour, papa mis fin en disant qu’il ne chercherait plus qui avait tord ou raison, mais punirait mon frère et moi. A la première escarmouche, il tint parole, il gifla l’un et l’autre, et ce fut paraît-il la fin de nos hostilités. Je crois aussi que le départ de Freddy (comme nous l’appelions) fut une cause de notre bonne entente. Quand il revenait, lui ne songeait pas à taquiner et moi j’étais heureuse de retrouver le grand frère si longtemps parti. Nous allâmes aussi plusieurs fois au Tréport, au Pouliguen, enfin à Roscoff, Granville etc… Une année nous abandonnâmes le mer pour aller à Saint Rémy, Frédéric ne devant pas quitter l’école pour les vacances, mais quelques mois plus tard définitivement.
Nous logions dans une petite auberge où les propriétaires étaient très aimables et j’ai gardé très bon souvenir de ce séjour où mon frère nous fit apprécier les agréments de la campagne environnante et l’immense parc attenant à l’école. J’ai le souvenir d’une petite source nichée dans les bois, où l’eau était su pure et si fraîche que jamais je n’en ai bu d’autre aussi bonne. Je me souviens aussi de bonnes pêches d’écrevisses, de promenades où papa faisait de jolies études ; du village même où les tas de fumier voisinaient avec les maisons, mais n’offusquaient pas trop mes yeux ou mes narines de Parisienne. C’était la pleine campagne, avec souvent son manque d’hygiène, mais tout son pittoresque. Je vois aussi le frère vacher , avec sa bonne mine ronde d’Alsacien, et aussi la plus distinguée personne du frère enragé d’astronomie, qui nous fit regarder dans son immense longue-vue, à plusieurs kilomètre à la ronde, et admirer le ciel semé d’étoiles. Cette année nous finîmes nos vacances à Freneuse. Ce séjour fut toujours, pour moi, plein d’attraits. Etait-ce qu’après l’animation de la ville ou l’agitation la mer j’y trouvais le calme reposant des champs ? J’aimais pourtant autrefois beaucoup la mer, j’en goûtais, toute jeune, les plaisirs multiples de la pêche, du bain, après ceux « barbotage » cher aux tout petits. Je l’aime encore, mais ne peux plus jouir de beaucoup de ces agréments. Quant aux horizons lointains, qui me charment toujours ils n’exaltent plus mon goût du risque, et de l’inconnu, cher à ma jeunesse. De plus en plus j’aime la campagne qui s’harmonise mieux avec les sentiments de mon âge : désir de paix et de repos. Pourtant, aux années dont je veux parler, ces sentiments étaient loin de mon âme et la vie et le mouvement m’attiraient beaucoup plus que le calme. On dit que le bonheur parfait n’est pas de ce monde, il me semble pourtant, qu’à cette époque, le jouissais du mien sans arrières pensées. Cependant il y avait dans notre ciel familial bien des nuages, que, petit à petit je découvris ; mais ce qui, pour mes parents étaient de grosses menaces d’orage ne présentait pour moi, que ces légères vapeurs roses s’étirant dans un ciel pur, au soleil couchant… Heureux privilège de la jeunesse, qui pare toutes choses des plus belles couleurs et, dans un égoïsme inconscient, entraîne le cœur bourré d’illusion vers un destin radieux, lui faisant oublier, hélas, trop souvent, la misère des autres. Cette pauvre jeunesse, elle ne manque pas de générosité, au contraire, mais grâce à Dieu, « elle ne sait pas » ; La vie se chargera de l’instruire. Quant à moi, je suis pleine d’indulgence pour elle, et je ne puis comprendre les personnes âgées qui ne lui accordent aucun crédit. Certes, je ne suis pas de ceux qui disent : « il faut que jeunesse se passe », en donnant à cette phrase un sens libertin ; mais je crois que cette légèreté, cette insouciance qu’on lui reproche, sont des bienfaits de Dieu, pour lesquels je ne puis vraiment me montrer sévère. Aux parents aux éducateurs le soin de mettre un frein à cette légèreté ; à cette insouciance, dans ce qu’elles ont d’exagéré ; de faire affectueusement les sages réflexions qui s’imposent, et surtout de donner cette éducation religieuse qui servira de balancier à cette jeunesse mouvante, l’amènera sans secousse, à une pondération naturelle, et, de ce fait à une vie équilibrée, saine et heureuse, dans le devoir accompli. Mais me voila entraînée bien loin de mon sujet. J’en reviens aux nuages qui menaçaient notre tranquillité familiale, lors de nos séjours à Freneuse. Ils étaient provoqués par l’antinomie existant entre les caractères et les goûts de mon père et de mon grand-père. Tout était prétexte à orage. Ceux-ci éclataient parfois brusquement, dans un ciel serein, d’autres fois grondaient sourdement quelques jours avant de nous foudroyer. Dans ce cas mon père filait à l’Anglaise, et restait le moins possible à la maison, ma mère montrait un front soucieux ; quant à ma grand-mère elle évoluait dans cette atmosphère lourde, toujours calme et paisible, mais attentive à ne pas attirer la foudre. Les sujets les plus puérils amenaient les plus graves réactions. J’ai le souvenir d’un baba qui, privé ou couvert de rhum, à l’encontre de ce qui avait été décidé, fut cause d’une catastrophe… Mon grand-père d’ailleurs faisait admirablement la pâtisserie, il avait à la campagne un four de boulanger dans lequel il faisait les gâteaux les plus délicieux du monde. Malheureusement papa ne les aimait pas, (ce que grand-père ne pouvait admettre) mon frère et moi n’étant pas non plus avides de friandises, nous semblions, sens doute, mépriser les chef d’œuvres sucrés de mon grand-père, ce qui avait le don de l’exaspérer. Mais celui-ci était bien difficile à satisfaire… en effet plus tard lorsque je fus fiancée, je lui annonçais triomphalement que mon futur mari était très amateur de gâteaux, (croyant le flatter). Hélas quand mon grand-père le vit à l’œuvre, il fut complètement scandalisé, car le voyant dévorer un éclair en deux bouchées, il dut penser qu’il n’avait certainement pas le temps de le goûter… et de l’apprécier. J’eus d’ailleurs quelques échos de cette façon de voir les choses. Une autre fois Grand-père rapporta de la chasse, à défaut de gibier, un plein carnier de champignons ; papa doutant de la science de son beau-père en fait de cryptogamies, dit prudemment à ma grand-mère qu’il s’abstiendrait d’en manger ; elle-même n’étant pas rassurée, prit une décision énergique et jeta tout le panier… Hélas mon grand-père ne perdait pas la mémoire en courant, aussi ne manqua-t-il pas, au repas suivant, de réclamer les fameux champignons. Je ne me souviens plus de la réponse embarrassée que fit ma grand-mère, mais sur une interrogation plus serrée, elle dut avouer le sort lamentable qu’elle leur avait réservé, sur l’instigation de son gendre. Ce fut un beau drame…. De fil en aiguille, grand-père dit qu’il fallait être bien sot pour ne pas vouloir manger d’une si bonne chose ; sur quoi je lui répondis, indignée, mais calme en apparence, qu’en tout cas, il n’était pas bien poli, vis-à-vis de papa, de faire une telle remarque… Pour le coup je cru qu’il étoufferait, il quitta la table en proie à une forte colère ; je ne sais si cette fois il menaça de partir en Amérique, comme il l’avait fait maintes fois dans des circonstances analogues… Mais, parti à la pêche avec un de nos cousins, il épancha sa bile toute la journée. Il dut entre autre : « croyez-vous cette petite péronnelle qui se permet de me tenir tête… » Ma grand-mère, très ennuyée, vint me demander de faire des excuses à grand-père, pour que tout soit arrangé ; J’avais alors 17 ou18 ans ; tout en reconnaissant que je n’avais pas été respectueuse, évidemment, je me trouvais de nombreuses circonstances atténuantes. Grand-père avait eu le tort de toucher à mon idole, car, pour moi, papa avait toutes les qualités, et, d’autres parts, je trouvais révoltant le manque de mesure d mon grand-père, et ridicules ses colères si peu légitimes. Enfin pour ma bonne grand-mère et la tranquillité de mes parents, je fis des excuses, si l’on peut dire, car je crois avoir, en mots voilés, laisser transparaître mon, état d’esprit. Grand-père, cependant, eut le bon goût de s’en contenter et tout rentra dans l’ordre, une fois encore. Quand nous étions à Freneuse, nous étions toujours dehors (encore un des grief de notre hôte) « Ils sont ici comme à l’hôtel, disait-il, ils rentrent pour déjeuner, dîner et se coucher ». Pourtant ce programme était bien logique, il me semble, en vacances .A la campagne quoi de plus naturel que de courir les chemins, les champs et les bois ? Freneuse était pour moi le paradis… Un jour que ma cousine Amélie semblait dire que Freneuse n’avait rien d’extraordinaire, elle me parût absolument aveugle. C’tait d’ailleurs un coquet village, et le coin où nous nous trouvions était particulièrement avenant, à mon avis. La maison de mon grand père était sur une grande et large route, qui traversait le pays, mais vers l’extrémité de celui-ci en se dirigeant sur la Roche–Guyon. Cette grand’route avait pour moi d’autant plus d’attrait que la maison ne comportait, en dehors des appartements, qu’une cours intérieure, une grande réserve, sorte de hangar, où mon grand-père serrait bois, filets de pêche, instruments de toutes sortes, et propre à tous les métiers ; enfin un minuscule jardin terminé par un poulailler où grand-père emprisonnait les volailles achetées à Mantes ou Vernon, entre lesquels se trouvait Freneuse, près de Bonnière en Seine et Oise. Cette grande route blonde, de sable et de fin silex, avec lesquels nos genoux eurent des rapports aussi fréquents que douloureux, était une vision bien émouvante pour moi, lorsque sortant du train m’amenant de Paris, elle déroulait son ruban de 2 ou 3 kilomètres que parcourait l’omnibus brinqueballant de l’immortel Jourdain.
Plus tard mon grand-père eut une automobile, qu’il acheta d’occasion au temps héroïque de ce mode de transport, et nombreuses étaient les pannes. Maman avait en horreur ce véhicule, et n’y montait que contrainte et forcée : elle gardait le souvenir d’un retour du marché de Vernon qui l’avait rassasiée pour longtemps des promenades de ce genre… mon grand-père étendu sur le dos, sous la voiture, la priant de lui passer des écrous huileux, tendant des mains avides, pleines de cambouis…
Grand-père avait coutume de dire qu’il n’avait fait dans sa vie que deux bêtises : l’achat de ses deux voitures, car il ne s’était pas contenté d’une première acquisition, il en avait fait une seconde qui ne valait guère mieux que la première. Il était habitué à faire de bons placements et ceux-ci avaient été désastreux. Grand-père, retiré des affaires très jeune, un peu plus de 40 ans, avait ensuite doublé sa fortune à force d’économies. Il dépensait à peine le tiers de ses revenus, ceux-ci faisaient boule de neige. Il eut aussi quelques héritages qui contribuèrent à son arrondissement. Il suffisait au contraire à mon pauvre papa de faire un placement pour que celui-ci s’avérât mauvais, mais que me voila loin de ma route de Freneuse ! Lorsque je descendais de voiture, je pénétrais dans un couloir assez large, dallé, qui au fond donnait accès dans la cour et, à gauche, dans la cuisine, et à droite dans la salle à manger. De la salle à manger on montait par un petit escalier qui faisait mes délices, et avait, je ne sais pourquoi, une odeur particulière. Il montait entre deux murs étroitement rapprochés, peints en vert clair et tournait vers le haut à droite, dirigeant sur deux chambres, celle de mon frère et celle de mes grands parents, dont les fenêtres donnaient sur la route. A gauche il accédait à un couloir bordant la cour, et, vers la fin duquel on montait encore trois marches pour trouver, à gauche, la chambre de bonne ; en face une pièce très vaste, ancien salon devenue ma chambre, ouverte par deux fenêtres sur la campagne et communiquant avec celle de mes parents, possédant la même vue : la Seine coulant non loin, en bas d’un coteau verdoyant. En face de la maison de grand-père se trouvait la ferme de deux pauvres vieux : le père et la mère Grège. Toute jeune j’aimais aller faire la causette avec cette dernière. « Ben là », disait-elle en appuyant sur la dernière syllabe à tout propos. Le matin elle faisait cuire une grande marmite de pommes de terre destinées à ses cochons, et moi qui n’aimais pas me lever de bonne heure, qui n’avais pas d’appétit, je trouvais délicieux de déguster ces pommes de terre fumantes, à une heure matinale, sur le milieu de la route… elles étaient bonnes, si bonnes… je crois que les naufragés de la Méduse ne les auraient pas trouvées meilleurs. A côté de cette ferme se trouvait la maison bourgeoise qu’une vieille demoiselle, que mon frère s’obstinait, quand il était petit, à appeler Madame. Comme maman le grondait doucement de son entêtement, il répondit péremptoirement « pas demoiselle du tout…» Il ne pouvait admettre que cette petite vieille, très coquettement arrangée pourtant, mais aux cheveux blancs recouverts de dentelles, put avoir droit à ce qualificatif demoiselle qui, pour lui, convenait à un jeune visage.
Chez Mademoiselle Antoinette, il y avait de beaux meubles anciens qui faisaient mon admiration, et surtout, une belle boîte à musique qui égrenait des airs jolis et vieillots me comblant d’aise. Dans le jardin, qui précédait la maison, se trouvaient des conifères donnant des fruits rouges, que Mademoiselle Antoinette m’attrapait et que je dégustais avec un plaisir mitigé de curiosité et d’appréhension. Enfin accolé au mur de la ferme voisine, se trouvait un minuscule pavillon où l’on grimpait par un minuscule escalier extérieur, pavillon qui était un observatoire très plaisant sur la route. De là, je voyais l’autre maison de Mademoiselle Antoinette, inhabitée, et qui semblait, pour moi, la maison de la belle aux bois dormant. J’y avais pénétré une fois tout au moins dans le jardin, accompagnée de la vieille demoiselle. Jardin et maison semblaient à mon enfance aussi mystérieux l’un que l’autre. En fait de belle au bois dormant, cette maison avait appartenu à Monsieur de Giverny, qui l’avait laissé en mourant à Melle Antoinette. Entre cette dernière propriété et la maison de mon grand-père, existait une grande battisse carrée, sèche et sans grâce, qui, à mon avis ressemblait à sa propriétaire : Melle Montoit. C’était une femme d’une soixantaine d’années, mi-campagnarde mi-bourgeoise, vêtue d’une robe à la mode ancienne, comportant une jupe froncée, et ce qu’on appelait un « caraco » bien plat, coiffée d’un bonnet blanc à bride, légèrement tuyauté tout autour, et qui ne laissait voir que des bandeaux plats, sans couleur précise. L’ensemble, moins qu’attrayant, de notre voisine me souriait moins que les prunes et abricots de son jardin… Ce n’est pas quand j’y pense que j’ai beaucoup mangé de ceux-ci, mais j’aimais cette odeur de sucre et de fruit qui s’exhalait de ce jardin baigné par le soleil l’été. Les abeilles et les guêpes qui partageaient mes goûts en avaient fait leur royaume et ce n’est pas sans un certain effroi que je leur disputais la place. Le long de ces deux habitations, dont je viens de parler, courait un petit jardin étroit sur lequel il fallait bien sagement marcher pour dévider les lignes de fond emmêlées de grand-père. « Marche » disait-il, « arrête », et il fallait obéir au doigt et à l’œil quand il entreprenait ce travail délicat. S’il y avait ce quart d’heure désagréable, (moins cependant que l’accrochage des vers de terre que je n’ai jamais assumé) il y avait en revanche la levée des lignes au petit jour. Sitôt que la bonne avait frappé à la porte pour me réveiller, je sautais au bas de mon lit, m’habillais en grande hâte, car je savais que grand-père n’était pas patient « à peu près comme un chat qui s’étrangle », disait grand-mère. On mangeait avant de partir, le plus souvent un morceau de lard froid avec du pain rassis ; puis, mon grand père, qui était dans ces moments là de bonne humeur disait : « il faut prendre un bon canard de cognac, cela te réchauffera, car il fait frisquet ce matin. » En effet dans ces journées de septembre, le brouillard matinal était pénétrant et il fallait bien se couvrir. Il nous jouait quelque fois de vilains tours, ce brouillard, il nous arriva, après bien des détours de revenir à notre point de départ, sur l’eau, au lieu de l’emplacement des lignes. Mais quand tout allait bien, quelle joie lorsque grand-père, ramenant les lignes, qui s’égouttaient dans le bateau, disait au rameur : « doucement, il y a quelque chose… c’est gros… » et qu’il sortait avec adresse soit une belle anguille, soit un gros barbillon, ou tout autre beau morceau qu’il mettait, avec précautions, dans le coffre du bateau, un coup de queue est si vite donné… Rentrés au port, nous reprenions, à la queue leu leu, le petit sentier qui nous ramenait à la maison, portant triomphalement les rames set les engins de pêche … et ce jour là tout risquait d’aller bien. J’assistais aussi à quelques pêches à l’épervier. Grand-père, debout sur l’extrémité de la barque, lançait avec adresse le filet qui s’élargissait comme la robe d’une danseuse, retombait dans un clapotis doux sur la surface de l’eau polie comme un miroir, car on choisissait un jour de calme plat pour ces expéditions. Alors, ramant quelques instant avec une prudence d’indien, on remontait ensuite, à ma grande joie, l’épervier dans lequel frétillaient des pièces de toute grosseurs. Ce n’était pas toujours la pêche miraculeuse, mais la Seine était cependant, à cet endroit, très poissonneuse et mon grand-père s’entendant à appâter, on revenait rarement bredouille. Que de pêches à la ligne aussi ravirent mes jeunes années. La veille du jour choisi on préparait le coup en lançant des boulettes de glaise amalgamées avec du son, et le lendemain on s’installait en bateau à quelques mètres du bord, et, amarrés aux fiches solidement plantées dans le fond de la rivière. La première fois que je mis une ligne à l’eau, elle n’était pas plus tôt lancée, que le bouchon s’enfonça énergiquement ; quelle ne fut pas ma joie, lorsque ayant ferré, suivant le conseil de grand-père, je sortis un beau gardon, ce qu’on nomme en Charente un Rouget. Nous étions trois dans le bateau, l’un n’avait pas fini de décrocher son poisson, que l’autre en tirait un à son tour…. Il y avait des jours cependant où tout n’allait pas aussi bien. Malheur alors à celui dont le pied glissait tout à coup dans le fond du bateau, ou faisait tomber un objet quelconque ; il provoquait les foudres de grand-père qui l’accusait de faire fuir les poissons. Ces jours d’expédition, souvent, grand-père faisait traverser la seine à toute la famille, dont une partie s’installait sur a berge ; ma grand-mère alors n’était pas à son affaire, « Je suis comme les chats, disait-elle je n’aimes pas l’eau », et mon grand-père, jaloux, ne manquait pas de remarquer : « il faut que ce soit pour suivre ta fille que tu montes en bateau, pour moi, tu ne ferais pas cette imprudence…. » Après ces bonnes journées de grand air, on ne se couchait pas tard ; quelquefois pourtant ma grand-mère me prenait sur ses genoux et racontait des histoires, déjà bien des fois écoutées, mais auxquelles je trouvais un charme toujours nouveau. Elle avait une façon si gracieuse de broder sur les contes de Perrault, ou tout autre conte de fées. Grand-mère connaissait aussi mille chansons, que je trouvais toutes plus jolies les unes que les autres, et qui amusaient même les grands ; elle aurait pu chanter ainsi, gaie et souriante, de longues heures, sans que son répertoire fut usé. Quelquefois nous jouions aux cartes ; que de gaies parties de 31, et lorsque l’un de nous étant « mort » il en faisait parler un autre, lui subtilisait ainsi un jeton, et jouait de nouveau. Je ne me souviens pas de ces soirées de Freneuse sans revoir les deux timbales d’argent de mes grands-parents ; dans celles-ci fumait un thé doré et si délicieusement parfumé…je n’ai jamais aimé le thé, mais ce parfum de tous les soirs m’était très agréable. Nous avions à Freneuse de nombreux amis qui venaient, comme nous, y passer la belle saison, entre autres les familles Guimier et Millardet. De Mr Guimier je garde le souvenir d’un grand, frais, et robuste vieillard, aux cheveux et à la moustache blancs et drus. Je le vois vêtu de coutil blanc, coiffé d’un immense chapeau de paille, et mangeant de bon appétit, à 4 heures, du pain trempé dans un bol de lait. Cette symphonie blanche m’avait, sans doute, inconsciemment frappée. Ce bon Mr Guimier, vêtu comme un farinier, avait pourtant fait sa fortune dans le charbon. Plus exactement, le chantier où il exerçait son métier à l’angle des rues Jouffroy et Cardinet et du Boulevard de Courcelles ayant pris énormément de valeur, son propriétaire devint au moment de la vente, plus que millionnaire, ce qui à l’époque était une bonne situation. Mme Guimier, elle, était une grosse personne dans la grisaille. Je me la rappelle en effet vêtue de gris, dans le même style que Mme Montoit, mais à la différence qu’une opulente poitrine et des hanches rebondies meublaient ses vêtements, contrairement à sa sèche compatriote. Elle avait des cheveux gris coiffés en bandeaux plats, peu seyants, qui n’adoucissaient pads une figure plutôt rébarbative, c’était pourtant parait-il une excellente personne. Sa fille mademoiselle Millardet était également une femme sans beaucoup de grâce, grande personne robuste comme ses parents, qui m’intimidait assez ; devant laquelle je me sentais devenir insignifiante et embarrassée, aussi ne fus-je pas peu surprise un jour que, devenue grande, papa me dit : « sais-tu ce que m’a dit mademoiselle Millardet ? …non… et bien qu’elle donnerait la moitié de sa fortune pour avoir une fille comme toi… » Pauvre Madame Théophile, tel était le nom de son mari (que nous n’avons jamais connu) elle n’avait pas eu d’enfant et le déplorait, elle avait pour toute famille des cousins germains du côté de ses parents, et des neveux de son mari. Ceux-ci, monsieur et madame Milllardet, avaient un fils et habitaient un beau chalet Normand, construit sur l’emplacement d’une maison attenante au jardin de mademoiselle Antoinette, et qui fut habité un moment par des négociants de Paris . J’étais à ce moment assez petite, et ne garde qu’un fugitif souvenir d’eux. La maison démolie fut donc remplacée par ce grand chalet, situé au milieu d’un beau parc, touchant celui de madame Théophile ; le mur séparant les deux propriétés fut abattu pour n’en faire plus qu’une, madame Théophile continuant d’habiter sa grande maison cubique, dans le style des maisons bourgeoises d’alors. Là, comme chez mademoiselle Antoinette, le mobilier était cossu mais avec un peu plus de banalité, il me semble, que chez la vieille demoiselle. La maison était entretenue avec soins par la charmante Andésine, une appétissante et rieuse jeune fille, dont je m’accommodais mieux, enfant, que de sa maîtresse. Elle riait toujours en découvrant des dents blanches et bien rangées, qui étincelaient au milieu d’un visage coloré, couronné de cheveux frisés, très noirs. La maison, du côté de la route, comme sur la façade regardant le parc, était entourée de parterres abondement fleuris, qui rejoignaient un petit bois dont on avait réservé un bel emplacement pour jouer au croquet. Les personnes d’âge rassis y trouvaient bancs et sièges où elles pouvaient, confortablement installées, jouir des évolutions d’une jeunesse turbulente. A que de joyeuses parties de croquet fîmes nous dans ce coin… Grand-père dans ses bons jours n’était pas moins enragé que les jeunes et tenait à prouver qu’il était aussi adroit à ce jeu qu’à n’importe quel travail. Rien en effet ne lui faisait peur : jusqu’au violon qu’il avait décidé d’apprendre seul, ou à peu près, je crois. Il est vrai que pour cela le résultat n’était pas merveilleux et que nos pauvres oreilles souffrirent parfois ; sons et mesures étaient souvent mises à mal. Par malheur mon grand-père avait un faible, justement, pour cette distraction, et il fallait le voir appuyer amoureusement sa forte tête sur l’instrument qui paraissait bien petit en comparaison de sa vaste poitrine. Grand-père était grand et fort avec des jambes un peu longues pour le buste, épais sans obésité. Il avait la tête légèrement dans les épaules ; le tout donnant une impression de force et de puissance que je comparais à celle du sanglier (si je ne craignais de manquer de respect.) Je n’ai jamais connu mon grand-père que chauve,son crâne luisant était entouré d’une demi couronne de cheveux noirs, à peine grisonnant sur les tempes, et qui laissait découvert son front large et légèrement bombé.
Les yeux étaient marrons, le nez assez rond à l’extrémité, la bouche largement fendue, entourée d’une moustache et d’une barbe noire au milieu desquels les dents blanches, assez courtes et solides, lui donnaient un aspect sain et jeune encore. Mon grand-père était un bel homme d’après l’avis de certains, pour moi, ce genre de beauté ne m’attirait pas. Pour revenir au croquet nous en fîmes aussi beaucoup avec d’autres amis : Les Desmousseaux de Givray. C’était un jeune ménage ayant, au moment ou il vint à Freneuse, 3 enfants, l’aînée Yvonne 6 à 7 ans, le deuxième Max, dit Toto, 3 à 4 ans, enfin le plus jeune Georges, dénommé Kiki était un tout jeune bébé. J’avais à ce moment là une douzaine d’années et j’étais très attirée par ces enfants, surtout le plus petit, qui avait été nourri par la servante, fille dévouée, qui ne quitta pas ses maîtres, même à l’époque où le ménage très gêné, ne lui payait pas ses gages. Madame D. qui avait à ce moment là 32 ou 33 ans, comme maman, était une excellente personne, malgré ses airs un peu évaporés ; sa mise assez excentrique et ses cheveux oxygénés révolutionnaient le paisible village de Freneuse, Elle avait eu le grand tord de se laisser prendre à la beauté brune et au bagout de son second mari, pour lequel elle avait quitté son foyer et divorcé. Il faut dire à sa décharge que son père, très autoritaire, l’avait marié à 17 ans, en 4 ou 5 semaines, sur la vue d’une photographie et à la suite d’une ou deux entrevues à un jeune homme qui lui était parfaitement indifférent. Les trousseaux superbes, les cadeaux, la vie mondaine avec ce jeune attaché d’ambassade, occupa son esprit à défaut de son cœur, jusqu’au jour où, déjà lassée de cette vie mondaine, elle se rendit compte que son mari la trompait, et trouva elle-même sur son chemin l’énigmatique Desmoureaux , soi-disant de Givray de St Roch, pour qui elle divorça. L’origine de celui-ci était assez mystérieuse, car il donna de sa vie pas mal de versions. Je ne sais comment nous entrâmes en relation avec ce ménage, somme toute sympathique, toujours est-il que, plusieurs années, aux vacances, nous nous retrouvâmes Sur la famille de la jeune femme, nous avions eu d’ailleurs des renseignements certains et des plus rassurants. Le père était un très gros propriétaire, originaire de la contrée de Nice où il avait de nombreux immeubles de rapports et maisons de campagne. Plus tard, papa et maman qui passèrent leurs hivers à cannes, après mon mariage, retrouvèrent ces amis avec lesquels ils avaient toujours gardé des relations épistolières. Le beau-père était toujours irréductible, jamais il ne put admettre son gendre, et celui-ci gardait une haine féroce à celui qu’il appelait « le vieux fou ». Entre temps quand j’étais encore jeune fille, nous étions allé, mes parents et moi, au Meix St Epoing, dans la Marne, en villégiature chez Monsieur Desmousseaux, à sa propriété de l’Hermitage. C’était une simple maison de paysans qui avait été aménagée coquettement par Madame D. dont le goût était très sûr. Cette maison ne comportait qu’un rez-de-chaussée divisé en cuisine, salle à manger, bureau et deux chambres. Nous-même couchions dans un petit bâtiment plus rustique, à quelques pas de là, dans le même jardin. Ce jardin était à la lisière de la forêt de la Traconne pour laquelle Max D. de G. avait des élans lyriques. Il faut dire que celui-ci avait des prétentions à la littérature, et que cette forêt était vraiment digne d’être louangée. Nous y fîmes des promenades magnifiques. Elle était sillonnée de larges avenues qui coupaient de loin en loin des futées majestueuses ayant la hauteur d’une cathédrale. Sur les remblais bordant la route, mûrissaient à cette époque, des fraises des bois d’un parfum et d’une saveur inouïs, dont nous emplissions des paniers. A peu près vers la même saison, nous cueillions dans les bois d’énormes bouquets de muguet qui foisonnait, à tel point, que le sol en était tout blanc. C’est lors d’une de ces promenades que madame D. dit à maman que je ressemblais à un petit saxe. Cela me parût un compliment, mais je n’en étais pas bien sûre car j’avais autrefois, vers 6 ou 7 ans entendu dire à mon père qui me regardait ; « que fea », ce qui en Espagnol veut dire : « qu’elle est laide ». J’en avais d’ailleurs ressenti de la peine non pas que je fusse déjà coquette, mais parce qu’il me semblait qu’un papa devait toujours trouver se enfants jolis, et que moi-même avais déjà, pour le mien, la plus vive admiration. Plus tard il fit amende honorable et je me souviens qu’un jour, ou il me regardait avec insistance, je lui en demandais la raison, il me dit alors très simplement, comme s’il se parlait à lui-même, « que m’importe à moi quelques imperfections de traits si l’ensemble est heureux. ». Je puis bien conter cela maintenant que, comme ma grand-mère, « l’indéplissable » je puis faire cette réflexion en ma regardant mélancoliquement dans la glace : « Dire que c’est moi qui suis là !... » La même remarque, je l’entendis d’ailleurs faire à mon père, un jour que, marchant avec lui sur les boulevards à Paris, il s’aperçut dans la grande glace d’une devanture. Moi, je me trouvais encore très bien, mais lui qui se souvenait du jeune homme fringant qu’il avait été à Blois, donnant le ton à la jeunesse fortunée de la ville, (Dans les années séparant ses deux mariages) il trouvait la comparaison amère, sans doute. Je me suis astreinte à peindre de mon mieux les parents dont j’ai parlé jusqu’ici, parce qu’à la lecture des mémoires de mon grand-oncle, j’ai été très heureuse de trouver les reflets de l’aspect physique de mes ascendants comme les traits de leurs caractères. Je veux donc, pour moi faire de même, quoiqu’il soit assez difficile de parler de soi, sans que cela paraisse ou sot ou prétentieux.
Je commence pour me donner du courage dans cette tâche délicate, pour signaler un grave défaut de mon visage. J’ai le front beaucoup trop découvert, heureusement des cheveux frisés et légèrement ondulés permettaient de le dissimuler en partie. A l’époque de mes 18 ans, ces cheveux étaient châtains foncé avec des reflets cuivrés au soleil ou à la lumière ; les yeux étaient d’un bleu gris, et ma bouche, assez petite, ne dégageait pas trop mes dents blanches, mais trop grandes et imparfaitement alignées. Mon teint, pas tout à fait celui d’une blonde, était cependant clair et transparent et ne nécessita longtemps ni poudre ni artifice d’aucune sorte. Cette nécessité remplie je reviens aux Meix dont j’ai gardé le meilleur souvenir. Frédéric à cette époque était au régiment ayant devancé l’appel. Donc au Meix on jouissait d’un calme reposant, en pleine nature. En dehors des promenades, Madame D, maman et moi, nous brodions ce qui était autrefois la mode, comme actuellement de tricoter. Madame D. faisait notre admiration, non seulement elle travaillait à la perfection, mais encore avec la rapidité d’une machine. J’avais au Meix une autre occupation, bien inattendue pour moi. Le « Maître », je veux parler de Monsieur D, me confiait la correction de ses ouvrages, avant de les faire éditer, afin de faire disparaître quelques fautes qui pouvaient s’y être glissées dans le feu de l’inspiration... .Mais hélas le feu devait être bien violent, car toutes les règles de la grammaire y fondaient comme beurre au soleil… Si encore je n’avais eu qu’à corriger les fautes d’orthographe… mais je devais refaire des phrases entières, et c’était un véritable travail de Pénélope .Cela ne m’ennuyait pas pourtant, car je lisais avec surprise ces ouvrages abracadabrants. Ce pauvre homme se croyait du génie, il ne s’en tenait d’ailleurs pas à la littérature, il faisait de la peinture…. Dieu sait comme. Enfin il avait conçu une sorte de bateau increvable, inchavirable, insubmersible, et…infaisable…. disaient les méchantes langues de ses amies. Je ne sais comment ce pauvre illuminé finit ? J’au su incidemment il y a quelques années qu’il était mort, mes parents s’étant brouillés avec lui à une époque déjà lointaine. Madame D. avait coutume d’admirer le ménage de mes parents et, comme maman lui disait que, dans notre famille, tous les ménages étaient ainsi, elle répondait : « Chez moi c’et tout le contraire, je n’ai jamais vu que des ménages désunis ». Et cela a continué, car sa fille aînée (fille de son premier mari) divorça et Yvonne fit de même… L’exemple en effet est contagieux, et le mauvais plus que le bon. Qu’elle triste chose ce doit être pour des enfants de vivre au milieu de la discorde. Pour moi qui n’ai jamais entendu la moindre discussion entre papa et maman, je garde un très doux souvenir de mon enfance. Je me souviens qu’un jour, alors jeune femme, mon grand-père me dit, je ne sais à quel propos : « C’est que cela n’a pas du être toujours drôle pour toi… » Il voulait faire allusion, sans doute, aux ennuis de papa qui avait subi d’assez grosses perte d’argent, par de mauvais placements. Je ne fus pas longue à me récrier, car papa avait été pour moi, non seulement le plus aimable des pères, mais le plus gai des compagnons. Nous avions bien des goûts semblables et nous bavardions à cœur ouvert de ceux-ci. Un jour même que nous parlions voyage, visitant les lieux saints et les autres, notre imagination nous emportait si bien que nous nous voyions déjà parties… Maman, alors à table avec nous, en fut si impressionnée qu’elle se mit à pleurer. Cela nous dégrisa aussitôt, et nous ne tardâmes pas à rire tous trois de nous-même. Avec papa je visitais ses expositions de peinture, nous ne manquions pas, particulièrement, d’aller tous les ans au Salon des Artistes Français. C’était un plaisir que je goûtais beaucoup et je regrette bien maintenant d’en être privée. Dieu que c’était fatigant pourtant ce piétinement de salle en salle. Nous allions aussi quelquefois au théâtre, pas si souvent que nous l’aurions aimé, car c’était assez coûteux. Mais c’était parfois très inattendu. Nous avions été faire des courses dans Paris, alors papa disait : « si nous allions au théâtre,…. » Maman qui était très raisonnable souvent répondait : « non »… Elle n’aimait pas, non plus, aller en soirée sans faire sa toilette minutieusement, et je me souviens qu’à cette occasion, c’était le grand tra la la.
Maman réfrénait les goûts de dépenses de papa car elle savait que ses revenus étaient limités et qu’ils avaient du déjà, pour nous élever grignoter son capital, ce qui est désastreux. Je pense à ce sujet que grand-père avait dû croire son gendre plus riche qu’il n’était en réalité, et que de son côté, papa avait eu l’espoir que son beau-père se montrerait plus généreux qu’il ne le fut. Il avait, en effet promis, en dehors de la rente versée comme dot à ma mère, d’aider à élever les enfants qui viendraient. Mais plus tard il aurait trouvé suffisant, d’après ce que disait mon père, avec humeur, de nous voir fréquenter les écoles communales, au lieu des pensions coûteuses qui furent les nôtres. Pour en revenir à mon heureuse jeunesse, papa qui avait été très souvent au théâtre, étant célibataire, connaissait presque tous les airs d’opéra à la mode de ce temps, il avait une oreille merveilleuse et retenait admirablement les airs qu’il entendait chanter ; il m’avait légué ce don, et je crois qu’il ne se passait pas de jours que nous chantions ensemble pour notre plus grand plaisir. De mon temps, de mon temps… tout était mieux qu’à présent, dit la chanson, en traduisant les sentiments des vieilles gens pensant à leur jeunesse. Mais, à l’heure si triste où j’écris, je suis sûre de n’être pas démentie si je la compare à l’heureuse époque de mes jeunes années. Donc sur un fond de vie agréable commun à tous, se brodaient les charmantes arabesques de mes joies particulières… Une des qualité de papa, dont j’ai oublié de parler, c’est la façon parfaite dont il lisait, même les pièces de théâtre. Il donnait si bien le ton à chaque personne, qu’on le voyait évoluer devant soi. C’était un véritable régal pour maman et moi, et je me souviens avoir ainsi travaillé avec beaucoup plus d’ardeur aux fameux cadeaux de premier de l’an, que nous préparions pour grand-mère ou tante Desmarquais, le soir sous la grande suspension de cuivre. Ce qui me plaisait beaucoup aussi c’était le récit de la vie à Cuba ; mon imagination d’enfant en a gardé quelques souvenirs comme de grandes et superbes images d’Epinal à la mode d’autrefois ; mon père à la chasse, les nègres coupant d’un mouvement souple et sec à la fois la liane bienfaisante contenant la meilleur et la plus fraîche des boissons, les oranges succulentes (que nous ne connaissions pas) mûries sur l’arbre, cueillies religieusement, et jetées au loin dédaigneusement après en avoir exprimé le suc sans effort.
Autres visions : les belles jeunes femmes, très prudes, évitant, dans les grandes pièces en enfilades de se mettre à contre jour, ce qui était très imprudent avec les légères robes d’organdis, et ces mêmes jeunes femmes se baignant, sans gêne aucune, devant les serviteurs nègres. Les promenades à cheval des jeunes hommes à côté de la « volenta », voiture à deux toues, légères et découvertes , qui mettait en valeur la beauté des femmes et la grâce de leurs atours. Le village chinois où mon oncle ne s’hasardait pas la nuit, sans être armé, en cas de troubles, alors que pour aller au village nègre il ne prenait pas cette précaution. Les belles nuits trompeuses où il était dangereux, parait-il, de dormir à la clarté de la lune et des étoiles, car on y risquait de prendre le tétanos. Toutes ces belles histoires, dont papa était le héros, ont du contribuer à me le faire voir différent des autres et supérieur à tous. Je n’ai pas parlé jusqu’ici beaucoup de la famille Gomez. Après l’insuccès du Plessis, mon oncle et ma tante durent vendre et perdre encore beaucoup à cette nouvelle transaction. Ils avaient d’ailleurs déjà à désintéresser des créanciers, ayant toujours mené assez grand train : domestiques, précepteurs pour les plus jeunes, etc…
Après la vente du Plessis les aînés durent avoir une librairie qui réussit mal, puis chacun dut se chercher une situation. Philippe partit à Cuba, puis en république Argentine où il fonda une famille et eu 8 ou9 enfants, à qui il donna des situations intéressantes : docteurs, en médecine, pharmacien, etc…Lui-même avait beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat, ainsi que sa femme, et tous deux avaient dû économiser et vivre sagement pour élever une si nombreuse famille, n’ayant que leur situation dans l’enseignement. Philippe est mort en 1932. Eugène, parti également en Amérique, y mourut jeune, je ne sais pas au juste dans quel endroit, assez mystérieusement. La version donnée à ma tante fut qu’il était mort lors d’une épidémie de fièvre jaune, après s’être dévoué, ce qui était très possible étant donné son caractère très généreux. D’autres prétendaient qu’il avait été assassiné par ordre du gouverneur de l’endroit, qui aurait eu des raisons d’être jaloux de lui. René, après avoir été à St Rémy, partit lui aussi en république Argentine, où il eu pas mal de déboires dans son exploitation. Il arriva cependant à se tirer d’affaires, mais sa santé épuisée par ses efforts ; il mourut vers 40 ou 43 ans. Dolorès, toujours appelée Lolita, fut une élève merveilleuse en pension à Tours, jusque vers 13 ans. Puis vers cette époque elle commença à donner des signes de dérangement cérébral, et, pour la soigner on dut la mettre dans une maison de santé. Après quelques temps, on espéra pouvoir le faire sortir, mais il fut reconnu que la malade n’était pas apte à supporter la vie courante ; les difficultés matérielles que sa famille traversait ne lui auraient pas permis de goûter le calme qui lui était nécessaire. Très normale, à certains moments, son esprit tout à coup, se mettait à vagabonder, et il fallait, avec habileté, le remettre dans le bon chemin. Lolita toute sa vie resta donc éloignée des siens, sauf pendant quelques jours tous les mois. Raoul s’engagea dans la Légion Etrangère, à la fin de son temps de service, il renouvela son engagement et fit plusieurs campagnes, dont celle du Tonkin ainsi que son frère cadet Jules. Ils allèrent aussi je crois en Algérie. Ce dernier ayant contacté d’abord de la dysenterie, au Tonkin, dut, pendant des mois, ne prendre que du lait pour se rétablir. Mais sa santé ébranlée, ne résista pas à d’autres campagnes .Il revint enfin en convalescence mais au bout de 8 à 9 mois il mourut de tuberculose, je crois, à Freneuse où il fut enterré. Je n’avais guère que 8 ou 9 ans à cette époque, mais j’ai gardé très bon souvenir de lui, car c’était une nature tendre et délicate, fine comme sa personne. Raoul avec lequel je n’ai jamais beaucoup sympathisé (car il ne s’occupait pas beaucoup de moi, comme mes autres cousins) portait beau. Il était très grand, comme Jules, mais plus robuste. C’est (avec Faust) celui qui avait le moins le type Cubain. Il n’avait pas le teint basané, comme ses frères, mais assez haut en couleur, une moustache à la gauloise, d’un blond fauve, des cheveux plus châtain foncé que noir. Il était assez grand seigneur, peu équilibré et dépensier et mis souvent sa famille en émoi. Il se maria un jour avec une très jolie femme, veuve très jeune avec 2 enfants. Il eut ensuite avec elle deux fils, dont l’un mourut vers 2 ans d’une méningite, et l’autre, je crois, au régiment. Raoul était mort depuis bien des années, nous avions perdu sa famille de vue, n’ayant jamais beaucoup sympathisé avec Juliette. Cependant nous avons su que celle-ci s’était remariée une troisième fois avec un docteur qui était mort le soir même de son mariage. Frédéric était très différent de son frère Raoul ; il était plutôt petit et trapu ; ma tante ayant été très fatiguée pendant qu’elle l’attendait, avait toujours supposé que c’était de là que venait son manque de développement
Il avait
les cheveux très noirs et frisés, et les yeux également noirs, assez petits,
mais à la fois malicieux et perçants. Ce n’était pas un mauvais garçon, mais
si faible, il se laissait facilement entraîner au jeu, et son mois de
vendeur au Louvre était bien vite envolé. C’était heureusement un vendeur
extraordinaire et un travailleur, ceci rachetait cela. Avec moi, il était
très gentil, il me racontait des histoires de brigands dont
les : « tout à coup » me mettaient dans une curiosité angoissée, non sans
charme, puisque j’en redemandais toujours. Il m’apportait aussi des
échantillons de soieries, ce qui me comblait d’aise, et dont je faisais
faire, à sa sœur Amélie, des robes princières pour mes poupées hautes comme
le doigt. Il se maria avec Lucie Bergeron, dont la famille était apparentée au compositeur Benjamin Godard. Cette jeune femme avait un assez joli visage régulier, mais la bouche dont la lèvre inférieure était fortement accentuée, le déparait un peu.
Tous deux sont disparus, laissant une fille, Paulette qui se maria avec Charles Bordeaux, jeune homme ayant été pensionnaire dans leur appartement et qui avait 6 ou 7 ans de moins qu’elle. Paulette qui eut 2 enfants, a perdu une petite fille à l’âge de 3 ans, et n’a plus que son fils Claude, charmant enfant de 13 ans environ. (1941) Amélie, la neuvième de la famille Gomez, fut pour moi une grande amie. De 18 ans plus âgée que moi, quand j’étais petite elle me dorlotait, plus tard, elle me contait des histoires et, quand je la voyais arriver à la maison, c’était une véritable fête. Enfin, mariée et mère de famille, je trouvais toujours auprès d’elle une confidente heureuse de mon bonheur et prête à me soutenir de son affection dans les jours de tristesse. Elle avait d’ailleurs une humeur toujours égale, et, quoique n’ayant jamais eu qu’une vie de labeur et d’abnégation, elle ne se plaignait jamais de son sort. Je fut même étonnée un jour où elle entrepris de me démontrer qu’elle avait eu sa part de bonheur, moi qui ne voyais dans sa vie que privations et déceptions. J’ai entendu dire à Amélie que vers l’age de 15 ans, elle avait été courtisée, c’était bien tôt en effet, et il est compréhensible que la perspective d’un mariage ne l’ait pas tentée à ce moment. C’est à cette époque d’ailleurs que la famille Gomez dut quitter la Touraine pour habiter Paris. Là, Amélie fraya beaucoup avec la colonie Cubaine où elle retrouvait des membres de la famille paternelle, et où elle fut toujours affectueusement reçue. Malgré les comparaisons qu’elle put établir entre sa vie, devenue plus modeste, et celle de ses parents fortunés, jamais je n’ai surpris chez elle une phrase de regret ou un mot d’aigreur. Elle a toujours prétendu d’ailleurs qu’elle n’aimait pas le monde, et elle avait pour les siens une tendresse aveugle. Cela agaçait quelque fois un peu mon père qui, lui, voyait mieux certains travers de la famille Gomez.
Le portrait de mon oncle, par exemple, tracé par papa ou Amélie aurait été bien différent. Le premier disait par exemple que c’était « un foie mou », suivant le langage imagé de maman’grand (qui n’était pas très tendre pour son gendre). Papa reprochait à mon oncle de ne pas avoir été assez ferme pour ses enfants, d’être trop grand seigneur, ses moyens ne lui permettant plus Amélie, au contraire, exaltait cet orgueil qu’elle voyait sous un bon angle, et prétendait que son père avait élevé ses frères et elle-même d’une façon parfaite. Je crois aussi qu’au point de vue éducation, il avait cherché à en faire des personnes de bonne compagnie, mais il n’était pas toujours parvenu à atténuer, chez ses fils, certains défauts, et à mettre en valeur certaines qualités, les uns déplorables, les autres forts utiles dans la vie. Quand à moi, je trouvais mon oncle décoratif. Il était assez négligé, parait-il, dans sa tenue à Cuba, mais quand je le connus à Paris, j’admirais la façon dont il s’arrangeait à paraître toujours correct, même élégant dans la médiocrité ; médiocrité qui devint à un moment ce que l’on appelle la misère dorée, et à laquelle papa dut venir souvent en aide. Mon oncle avait une assez belle tête : les cheveux noirs, fins et luisants, mais un peu clairsemés sur le dessus de la tête, la barbe assez longue et grisonnante. De taille légèrement au dessus de la moyenne, il était bien proportionné et avait les extrémités fines. Je le vois toujours polissant les souliers vernis qui moulaient ses pieds petits et cambrés, ou faisant reluire le huit reflets que coiffaient à cette époque tous les hommes élégants, et qu’il ne quitta jamais pour un chapeau plus populaire. Il était avec moi gai et taquin, malgré les soucis qui devaient souvent l’accabler. Il faisait une sorte de courtage, de représentation, je ne sais pas au juste, que devaient lui faciliter les relations opulentes qu’il avait conservées dans la colonie Cubaine, et il voyait toujours les affaires faites dés qu’elles se présentaient. Combien construisit-il de châteaux en Espagne sur la réussite de ces affaires merveilleuses ?… Toute la famille (Amélie en tête) gardait d’ailleurs ce bel optimisme qui devait lui permettre de passer les plus dures épreuves. Ma tante était sûrement la moins emballée, quoique son mari ait un peu déteint sur elle, mais elle était d’un caractère calme, excessivement posé, et je ne l’ai jamais vu se départir de cette placidité qui me déconcertait un peu. Je la voyais toujours la même devant les plus gros souci, les plus dures épreuves, ou de rares joies que la vie lui octroyait. Ses sentiments intérieurs étaient marqués par un visage un peu plus grave, ou plus souriant qu’à l’habitude, c’était tout. Si j’en crois Amélie sa mère était parfaite, mais pour ma jeunesse elle était incompréhensible. Cette sérénité serait certainement un brevet de sainteté si elle découlait d’une vie intense de l’âme, abandonnée à la providence et fortifiée par une pratique religieuse sans défaillance. Mais tel n’était pas, je crois, le cas de ma tante ; elle avait été élevée ainsi que papa dans l’indifférence vis-à-vis de la religion ; des grands-parents et arrière grands-parents avaient été autrefois de fervents catholiques, mais pour des raisons ignorées, peu à peu cette ferveur avait disparu pour faire place à l’oubli. Ce mot d’oubli me paraît inexact après l’avoir écrit, car si ma tante n’en était pas une pratiquante intégrale, elle était une croyante et avait la dévotion du chapelet, .Mystère des âmes que seul Dieu pénètre et peut juger équitablement. Ma tante, lorsque je l’ai connue, était devenue d’une assez forte corpulence que sa taille, un peu en dessous de la moyenne, accentuait. Elle avait une opulente chevelure noire, séparée en bandeaux relevés sur le front et dégageant celui-ci, large et droit ; de longues nattes s’enroulaient autour de sa tête dans une coiffure gracieuse mais démodée. Une bouche privée de dents à la mâchoire inférieure déparait son visage régulier, éclairé par des yeux marron, longuement fendus. J’avais entendu dire à papa que maman Deswatines lui avait fait autrefois cette remarque : « Toi, Eugène tu es joli garçon, mais ta sœur est encore beaucoup mieux que toi ! » Plus tard je trouve que papa avait, mieux que ma tante, conservé sa beauté et surtout l’air de jeunesse, grâce à sa sveltesse te à son caractère enjoué. Amélie tenait de sa mère des cheveux longs et épais, mais plus fins et luisants comme ceux de mon père ; moi qui avais des cheveux frisés, mais courts de ce fait, j’admirais cette longue natte serpentant dans son dos pour la nuit. Le jour, ses beaux cheveux étaient relevés en une épaisse torsade qui remontait de la nuque jusqu’au sommet de la tête. C’était là ce qu’Amélie avait de mieux, avec ses yeux grands et doux. Son visage était d’un ovale très allongé, la bouche un peu forte, et le nez, hélas, relevé exagérément, faisait remarquer des narines trop ouvertes. Jeune elle avait un teint mat, assez velouté qui s’était jauni avec l’âge. Elle avait été recherchée par un ce ses cousins Cubain, mais on avait craint qu’il n’ait pas beaucoup de santé, et laissé tomber ce projet. Un autre, veuf avec 4 enfants, l’aurait bien épousée aussi, alors qu’elle avait une trentaine d’années, mais mon oncle et ma tante avaient objecté que ce serait une bien lourde charge pour elle. Papa et maman reprochèrent un peu à mon oncle et à ma tante d’avoir toujours fait obstacle aux projets de mariages envisagés, mais Amélie prétendait que ses parents avaient eu raison, et souvent même, elle critiquait cet état d’esprit des parents Français qui n’envisagent pas un autre avenir que le mariage pour leur fille. A Cuba disait-elle, il n’en est pas ainsi, et nombreuses sont celles qui optent pour le célibat. N’ayant jamais eu ce minimum de bonheur humain auquel chacun aspire, elle gardait un trésor d’indulgence et de dévouement pour tous ceux qui l’entouraient, et particulièrement pour les siens. Elle avait bien quelques petits travers, mais bien excusables. Jusqu’à la quarantième année, elle avait joui d’une excellente santé, et accompagnait comme interprète les riches étrangères Américaines venues à Paris pour leur plaisir … Elle se fatigua beaucoup à ce métier, piétinant dans les magasins, rentrant à toutes heures chez elle pour les repas ; sa santé un jour s’altéra et l’on constata qu’elle avait un rein flottant. Ensuite elle dut être opérée d’un fibrome. Elle se remis à peu près de cette opération qui avait présenté une certaine gravité en raison d’adhérences nombreuses, puis, après la mort de mon oncle et de ma tante, elle alla soigner une cousine germaine de cette dernière : Mathilde Taillandier, atteinte d’un cancer du sein.
Cette cousine était la fille de tante Gréard, sœur de papa grand. Elle habitait l’Isle Bouchard en Touraine et vivait de ses revenus dans une maison lui appartenant. Ces revenus était modestes, elle était d’une économie confinant à l’avarice et Amélie mena là une vie de dévouement et de privations (qu’on ignora dans le moment) si bien qu’à la mort de Mathilde, elle eut besoin de se réadapter à une vie plus large au point de vue alimentation. Je crois que ce stage auprès d’une malade au jugement un peu faussé par la maladie même fut un peu cause du délabrement de la santé d’Amélie. Elle vécut dés lors grâce aux soins attentifs qu’elle prenait de sa personne et qui provoquaient, à tord sans doute, les sourires ou les agacement des uns ou des autres suivant leur tempérament. Amélie qui, dans ma jeunesse, fut pour moi comme une jeune maman ou une sœur aînée, et toujours une amie fidèle, s’est éteinte il y a six mois à la maison, d’une suite de congestion cérébrale qui la frappa le 27 janvier 1941et l’emporta le 1er février, après quelques jours de paralysie supportée avec une patience admirable. Elle avait su gagner l’affection de tous ceux qui l’entouraient, et les étrangers eux-mêmes, ayant été séduits par sa grande bienveillance, la regrettèrent sincèrement. Ernest son frère, quoique beaucoup plus âgé que moi, lui aussi, fut un compagnon de mes jeunes années, surtout lorsque mon oncle et ma tante habitaient dans la même rue que nous, mais au côté opposé de la place de la République à Levallois ; à ce moment j’allais tous les jeudis déjeuner chez eux et j’exerçais ma tyrannie sans aucune discrétion. Je faisais marcher tout le monde à la baguette et tout le monde paraissait enté de son esclavage.
Ce pauvre Ernest devenu presque impotent sur la fin de sa vie, (1936) en raison d’une maladie de cœur, avait grossi démesurément et perdu les attraits de sa jeunesse. Il avait été en effet un beau garçon, fort sans excès, brun, avec de doux yeux marron, des lèvres rouges un peu trop charnues, et un nez assez correct, quoique manquant de finesse. Il était d’un tempérament assez timide et effacé qui lui faisait perdre beaucoup de ses moyens. Ecrivant assez bien, il s’exprimait fort mal de vive voix, bredouillait facilement, ce qui lui donnait peu de prestige. Mais il avait un cœur excellent. Il vécut avec ma tante et Amélie jusqu’à 40 ans passés faisant l’abandon presque total de ses appointements de chancelier au consulat de Cuba, jusqu’au jour où, après la mort de ma tante, on apprit qu’il était marié depuis 2 ou 3 ans et ne l’avait jamais dit à sa mère ou à sa sœur pour ne pas les contrarier.
Cette situation de chancelier, il l’avait acquise à force de patience d et de travail, et sa veuve, Margueritte et son fils Raymond touchent actuellement une retraite qui leur permet une vie large, ajouté aux fruits d’une maison acquise à force d’économies. César, mort âgé d’une cinquantaine d’année vers 1923, était plus indépendant ; il fut assez longtemps assez bohême, vivant dans un milieu d’artistes, puis un jour il rencontra celle qui devint sa femme et changea complètement. Marié à 32 ans à une jeune fille de 18 : Virginie Pérot, il prit conscience de ses responsabilités et fut un mari affectueux et rangé.
Il se créa un portefeuille d’assurances lui donnant une aisance appréciable et lui permettant d’élever convenablement ses dieux enfants Charles et Amélita. Malheureusement à la guerre de 14-18, il fut atteint de pleurésie et dut quitter Vanves, où il habitait, pour achever sa convalescence et vivre dans de meilleurs conditions à Arcachon, où il mourut 5 ou 6 ans plus tard d’une embolie. Faust fut un beau garçon, plein de vie et d’entrain, de type plus Français que ses aînés paraît-il. J’ai de lui le souvenir d’un visage clair et joyeux, mais il mourut à 20 ans, lorsque j’étais toute jeune, des suites d’une typhoïde contractée en Algérie alors qu’il était au régiment. Venu en convalescence en France, il eut l’imprudence de manger un éclair plus tôt qu’il n’eut fallu et une rechute l’emporta. Ma tante que j’ai toujours vue très calme, fut si déprimée paraît-il à ce moment qu’on craignit pour sa raison. Le Docteur lui avait dit très brutalement qu’elle avait tué son fils comme si elle l’avait frappé d’un coup de marteau Quant au dernier-né de ma tante il était mort vers l’âge de 18 mois par suite de mauvaise conformation du cœur. Mes longues digressions sur la famille Gomez m’ont fort éloignée de ma petite jeunesse et des joies que je goûtais à Freneuse à cette époque. Il nous est arrivé quelquefois d’aller à Freneuse aux vacances de Pâques ou à la pentecôte ; c’est alors que nous goûtions le plaisir de faire la cueillette des asperges ou des cerises. Celle des asperges m’amusait beaucoup. Quelle joie de découvrir, pointant dans la butte de sable, la tête toute blanche de l’asperge, à peine sortie, qui se confondait avec le petit cailloux voisin, ou de signaler à grand-mère, de loin, celles qui déjà se dressaient toutes roses sous le soleil, ayant été oubliées à la visite précédente. Grand-mère, adroitement, cueillait les unes et les autres, et nous revenions, bras dessus bras dessous, gaîment à la maison. Une des pièces d’asperges de grand-père se trouvait à « la pointe » c'est-à-dire à l’endroit où, sortant du pays, la route bifurquait à gauche sur la Roche Guyon, à droite vers l’église. Cette dernière était en effet située au milieu des champs, desservant plusieurs paroisses ; pourtant elle était bien peu fréquentée, même le dimanche. C’était une vieille église et son clocher branlant ne permettait plus l’appel des cloches dont la population aurait eu pourtant le plus grand besoin pour secouer sa torpeur. Nous étions donc parmi les rares fidèles s’acheminant vers elle le dimanche, entre les champs de blés parsemés de bleuets et de coquelicots, avant la moisson prochaine.
Les alouettes, dans un vol rapide, semblaient nous encourager à presser le pas et nous stimulaient de leurs petits cris joyeux et stridents. Nous franchissions le seuil du petit cimetière où la plupart des tombes disparaissaient sous une végétation exubérante. Vers quelques sépultures, mieux entretenues, se dirigeaient des femmes vêtues de noir, et les mains chargées de fleurs. Passé le porche, nous nous dirigions vers notre banc ; l’église en effet n’était pas meublée de chaises, mais de sortes de stalles, reliées les unes aux autres, fermées par une porte à chaque extrémité, et comprenant un banc fixe et un autre très étroit, mobile et instable, servant de prie-Dieu, sur lequel j’aimais beaucoup grimper, et qui avait le double privilège, en se renversant, de faire un bruit infernal et d’écraser les pieds de mes voisins. Cette grand-messe était pour moi bien nommée, car je la trouvais interminable. Je ne reprenais espoir que vers le Pater, m’étant rendu compte qu’après ce chant elle ne tardait pas trop à finir. Le passage de l’enfant de choeur distribuant le pain béni était aussi pour moi une heureuse diversion. Enfin, la messe terminée, le prêtre entonnait le « libera nos » » et c’était pour moi un véritable chant d’allégresse…. Longtemps il le resta et je ne pouvais l’écouter sans voir un porche lumineux, s’ouvrant sur une campagne resplendissante de fin d’été, sans percevoir les coups de fusils, plus ou moins proches, des chasseurs poursuivant lièvres et perdreaux, dans les prés et les bois environnants. Ce chant n’était pas pour moi l’élan d’une âme vers son créateur, mais celui d’un jeune cœur qui ne le connaissant pas bien encore, volait d’instinct vers tout ce qu’il a fait de beau et de bon : le soleil, la lumière, l’air pur des champs, l’amitié… Mon frère et moi avions en effet de bons amis d’enfance. Frédéric avait pour compagnon Charles Millardet, fils de Mr et Mme Paul, d’un an plus âgé que lui et Gaston Machon, fils d’un commissaire de police d’Auteuil, son aîné de 2 ans On avait coutume de les appeler la Trinité, car on ne voyait guère l’un sans les autres. Pour moi toutes mes sympathies allaient au second, doux et prévenant, alors que Charles avait toujours un petit air de se moquer du monde qui me refroidissait, et mettait ma jeune susceptibilité en éveil. A notre groupe se joignit, un peu plus tard, une cousine germaine de Charles, Blanche Miquel, mon aînée de 20 mois, et sa jeune sœur, Alice, appelée « Ranavalo » dans sa famille, à cause de son teint bistre et son type un peu étrange. Blanche était une très gentille amie, si franche, si gaie et pleine de bonne humeur ; Elle avait fait la conquête de grand-père, quoiqu’il la trouva un peu trop « fin de siècle » comme on disait à l’époque des jeunes filles moderne, et qu’on jugeait aller trop de l’avant… Quant à moi j’étais en admiration devant elle, et son air déluré m’en imposait beaucoup. Que de bonnes promenades, de gaies conversations, que de disputées parties de croquet ensoleillèrent nos journées et celle de nos parents, car à cette époque il était encore bien peu admis que jeunes gens et jeunes filles fassent bande à part. Car petit à petit, en effet, une transformation s’était faite en nous, le papillon était sorti de sa chrysalide, et je me souviens de mon étonnement, lorsqu’une année je me retrouvais en face d’un Gaston embelli et virilisé, qui n’était plus le grand adolescent dégingandé dont le nez prenait une trop grande importance dans le jeune visage. Ma sympathie pour lui avait été un peu effarouchée par les affectueuses moqueries de Mr Desmousseaux à son égard, et ses propos soulignant les attentions de Gaston pour moi. Depuis ce dernier avait perdu cet excès de timidité qui le rendait un peu gauche, et stimulait les plaisanteries de notre ami commun. Gaston avait pris de l’assurance à un certain point de vue ; mais vis à vis de nos rapports, il n’avait guère changé. C’était toujours le même ami dévoué, délicat, prévenant, qui, revenant de la chasse me donnait à pleines mains les noisettes cueillies à mon intention, me facilitant en promenade les passages difficiles, puis, de retour à la maison, s’accoudait du dehors à la fenêtre, et y restait en contemplation parfois jusqu’à ce que ma grand-mère, doucement, lui fasse observer qu’il était largement l’heure d’aller dîner. Cette adoration muette n’était pas sans me toucher, et il est fort probable que je l’aurais payée de retour si je n’avais trouvé sur mon chemin celui qui devait devenir mon mari, et avait un tempérament d’homme d’action et non de contemplatif….
La rencontre HUAULT et DUPUY Mes parents las de se diriger toujours vers les plages de la Manche décidèrent, une année, sur la recommandation d’une amie, d’aller à Chatelaillon sur l’Atlantique. C’était, comme c’est toujours, une immense plage, mais en ce temps là, modérément fréquentée par des familles sans faste auxquelles le grand air, l’espace, la pêche, et le modeste casino suffisaient. Nous y avons donc passé, en cette année 1900, une bonne saison. De loin en loin sur cette plage immense, quelques maîtres baigneurs s’étaient installés. Auprès de leurs cabines, ils avaient édifié de grands abris de bois, communs à tous leurs clients. Sous ces abris de larges et confortables fauteuils invitaient au repos et la contemplation, et les familles s’y installaient, se groupant suivant les sympathies. Un jour que nous étions sur la plage, papa fit remarquer à maman qu’un bouton de sa veste menaçait de tomber, et la pria de bien vouloirs le lui recoudre, sur quoi maman se récria en arguant que le coton à broder n’avait aucunes des qualités requises pour consolider un bouton. Une dame d’un certain âge qui était non loin d’elle, lui offrit une aiguillée de fil que maman accepta en remerciant. A la suite de ce petit évènement, nous ne manquions pas de nous saluer à chaque rencontre et, petit à petit, la conversation s’engagea. Madame louis Dupuy, très aimable et sociable, était en villégiature avec sa plus jeune fille : Marthe, âgée de 13 ans, et sa nièce madame Ménard, accompagnée de ses petits garçons. Un jour ce groupe s’augmenta d’une jeune personne, de 25 à30 ans, d’aspect assez sévère, qui nous voyant saluer Mme Dupuy nous regarda de haut en bas, en ayant l’air de penser : quels sont ces ostrogoths ? De son côté maman était assez offusquée par ce regard moins qu’aimable et en concluait que nous n’avions pas l’heur de plaire à la nouvelle venue. Celle-ci était la fille aînée de Mme Dupuy, Louise, arrivée d’Angoulême avec son frère Georges.
Ce dernier, brun comme sa sœur, était certainement un beau garçon et, sans arrières pensées, très ingénument, (je n’avais pas 18 ans) je pensais que j’aimerais bien un mari de ce genre, plus tard. Ce beau jeune homme aimait, avant de se baigner, à se promener de long en large au bord de la mer et maman, mauvaise langue, pour une fois, avait dit qu’il tenait à faire admirer son anatomie. J’ai su plus tard que, tout simplement, la plongée brusque dans l’eau froide était assez pénible à celui qui devint mon mari. Tandis que de notre côté, nous faisions ainsi ces jugements téméraires, de l’autre côté de la barricade, on traitait Frédéric de sauvage, ou de brigand calabrais, etc., etc.….En effet mon frère, chasseur enragé, passait une bonne partie de ses journées à l’affût des oiseaux de mer, dans un endroit désert de la côte et arborait pour cela une tenue appropriée qui faisait un peu scandale lorsqu’il s’aventurait sous la tente. A la suite de ces contacts un peu rugueux, je ne sais comment Georges, Louise et Frédéric arrivèrent à sortir ensemble à bicyclette et à y prendre suffisamment de plaisir pour renouveler assez fréquemment ces sorties. Un jour enfin Louis Dupuy vint passer quelques heures avec sa famille ; il n’aimait pas la mer et quittait d’ailleurs toujours à regret son usine ; Très aimable, comme sa femme, il sympathisa sans doute avec nous, car, au cours de la conversation, il suggéra à papa de faire avancer l’appel à Frédéric, et de choisir Angoulême comme lieu d’incorporation. « Il serait, dit-il, un bon camarade pour mon fils, les jeunes gens comme il faut sont si rares maintenant. » Papa répondit qu’en effet Frédéric serait ensuite plus libre pour se faire une situation, et l’on se quitta d’accord. Cependant, arrivés à Freneuse pour finir les vacances, nous ne pensions plus à ce projet, quand une lettre de Mr Dupuy vint nous le rappeler. Après tout dit papa ce ne serait pas une mauvaise chose, et, puisque Frédéric est fort, il n’y a qu’à s’orienter dans ce sens. Frédéric fut trouvé bon pour le service et il partit à Angoulême. Là, tous les soirs, il sortait pour se rendre dans la famille Dupuy où monsieur et Madame Dupuy, très accueillants, le recevaient à leur table. Melle Louise s’occupait aussi du jeune soldat, vérifiait l’état de son linge, etc.…. enfin Frédéric était là soigné comme un coq en pâte…. Un jour Mr Dupuy annonça sa visite à mes parents ; il venait pour affaires à Paris, mais maman eut toujours dans l’idée qu’il y venait aussi pour faire sa petite enquête, et voir notre installation. Vers l’époque des vacances, Mr et me Dupuy nous invitèrent à passer quelque temps à Angoulême pour y voir Frédéric, mes parents acceptèrent une invitation si cordialement faite, et nous dûmes rester une quinzaine de jours les hôtes de la famille Dupuy. Tous les soirs nous voyions Frédéric et Georges et les attendions……La prévenances de ce dernier ne me déplaisait pas. Après ce séjour à Angoulême nous partîmes à Châtelaillon, et tous les dimanches, les jeunes gens venaient nous y retrouver. Ce doit être l’hiver qui suivit qu’un soir, mon père rentrant à Levallois de sa promenade quotidienne à Paris, nous dit : « devinez qui j’ai rencontré sur les boulevards ? … Mr Georges… vous pensez peut être qu’il a eu l’air surpris ? Et bien pas du tout, il m’a parlé comme si je l’avais quitté de la veille, quel flegme…. » Puis papa poursuivait : « nous nous sommes installés à la terrasse d’un café et nous avons bavardé ; mais, dit-il à maman, en y réfléchissant, je trouve bizarre ce qu’il m’a demandé au cours de cette conversation : « Mademoiselle Odette aime-t-elle beaucoup Paris ? Est-ce que cela l’ennuierait d’habiter la province, etc.…. » Et, en parlant, il grattait les unes après les autres, sur le porte allumettes toutes celles qui y étaient contenues, et les soufflait au fur et à mesure qu’il les allumait ; « qu’en penses-tu ? Cette attitude m’a paru étrange. » Quelques temps après, Mme Louis vint à Paris, avec son fils et nous rendit visite. Après le repas, pris à la maison, nous allâmes conduire les voyageurs à la gare. Restée seule avec Georges sur la plateforme de l’omnibus, celui-ci me dit : « Viendrez-vous en Charente cette année ? » Je ne sais, répondis-je, cela dépendra de mes parents, ce à quoi il ajouta : « Oh si vous le voulez bien ils ne demanderont pas mieux ». Je protestais alors faisant remarquer que ce n’était pas moi qui prenais les décisions à la maison. Cette année là nous allâmes à St Palais, non loin de Royan où Frédéric devait venir passer son congé ; de son côté Melle Louise avait loué une villa sur le bord de la amer où elle devait venir avec sa jeune sœur Marthe, et où Mr Georges devait les retrouver à son congé également. Quand Frédéric fut rendu, papa à table lui demanda : « Et Mr Georges quand vient-il ? » …. « Oh je ne sais pas, il fréquente beaucoup des cousins qui, je crois, veulent le marier. » Je fus véritablement saisie par cette nouvelle à laquelle j’étais loin de m’attendre, et très déçue en pensant que ce jeune homme était, comme beaucoup d’autres, inconstant et frivole. Pourquoi avait-il eu l’air de s’intéresser à moi pour ensuite me négliger ? Ayant conscience de ne lui avoir fait aucune avance, j’estimais qu’il aurait pu réfléchir avant de me prodiguer les siennes. Mais le lendemain ou le surlendemain, Mr Georges arriva, plus entreprenant et plus gai que jamais. Quant à moi j’avais revêtu une cuirasse d’indifférence : Je m’appliquais même à rechercher tout ce qui, en ce jeune homme, pouvait s’éloigner de mon idéal. Les vacances terminées chacun rentra chez soi. Mais au mois de novembre une mauvaise nouvelle nous parvenait : Mr Dupuy était très mal ; il mourait en effet quelques jours plus tard, laissant des regrets unanimes car c’était un charmant homme, plein de bonté pour ses ouvriers, serviable, excellent mari et père de famille. Sin fils Georges, possédant le diplôme de l’Ecole Supérieur de Commerce, n’avait fait qu’un an de service militaire, et, depuis une année, avait pu se mettre au courant des affaires. Sa fille Louise secondait son père depuis plusieurs années déjà, et Mme Dupuy dirigeait également certains services. L’usine ne devait donc pas souffrir du départ de celui qui avait tant contribué à sa bonne marche et à son développement. La maison Dupuy et Cie avait en effet été fondée par Pierre Dupuy, originaire de Mareuil, en Dordogne. Celui-ci devait, comme son arrière grand-père, parcourir les campagnes avec son magasin ambulant. A ce moment là les chemins de fer n’existaient pas, les populations rurales étaient heureuses de trouver ainsi ce qu’elles ne pouvaient aller chercher facilement à la ville. En 1854 cependant, Pierre Dupuy s’établit à demeure à Angoulême dans l’emplacement qu’occupe actuellement la Compagnie du Gaz, route de Bordeaux. Ses enfants, une fois en âge de l’aider, s’associèrent à lui : Son fils aîné Alexis, le Cadet Louis, et le mari de sa fille, Ferdinand Penot. J’ai ouï dire que Louis et Ferdinand voyageaient beaucoup pour la maison qui, de plus en plus, prospérait. En 1870 elle travailla pour l’armée, fabricant je crois des bourres de fusils et d’autres accessoires de guerre ; son outillage, l’importance du personnel, lui permirent de réaliser, honnêtement des bénéfices assez intéressants, d’après ce que j’ai entendu dire à ma belle-mère. Louis Dupuy ayant eu un fils, Georges, né en 1881 (Après 3 filles dont l’aînée mourut vers 18 mois, et la troisième, Berthe, à 20 ans de rhumatismes aigus), la maison se transporta à St Roch dans une superbe usine construite selon les goûts de Mr Louis. Là, après quelque temps de travail en commun, certains dissentiments surgirent du fait d’un des enfants de Mr Alexis : Amédée Dupuy. Celui-ci avait une sœur, Adrienne, qui se maria avec Henry Veyret. Amédée voyageait pour la maison Dupuy et Cie, mais ses frais de voyage étant importants, il dut y avoir discussion à ce sujet et une rupture d’association en résulta. Dans la famille de Louis Dupuy, on trouvait d’ailleurs que celui-ci se prodiguait pour l’affaire, alors que son frère Alexis se serait facilement, occupé de son jardin ou de tout autre travail. Alexis et son beau-frère Penot, mari de Gabrielle Dupuy, quittèrent donc la maison Dupuy et Cie et fondèrent, peu après, la maison Dupuy fils aîné qui s’installa non loin de la première. Plus tard Henry Veyret, mari d’Adrienne Dupuy, associé à Amédée Dupuy fut évincé et son frère, Frédéric Veyret repris l’association avec Amédée, qui, après quelques années se retira à son tour, et cette maison passa, de ce fait, complètement dans en des mains étrangères à la famille. Fait à noter, cependant, Mr Frédéric Veyret était marié à une demoiselle Taillandier , originaire de Touraine, et l’on se rappelle que la sœur de mon grand-père Frédéric Huault : Madame Gréard, avait une fille : Mathilde, mariée à un monsieur Taillandier, habitant l’Isle Bouchard ; nos familles étaient-elles alliées sans le savoir ? Nous n’avons pas fait de recherches à ce sujet, étant données les dissensions qui avaient eu lieu. Mais revenons à la maison Dupuy et Cie. Le départ de capitaux importants, la concurrence de la nouvelle maison, n’entravèrent pas sa bonne marche heureusement, et elle fonctionnait normalement quand Mr Louis disparut. Son frère Alexis, et son père, Pierre Alexis, étaient morts quelque temps avant à peu de distance l’un de l’autre. Les petits enfants taquinaient quelquefois ce vieux grand-père, un très beau vieillard parait-il, qui était d’une économie légendaire, frisant l’avarice. Les jours de paye, il leur arrivait de prendre quelques sacs de Louis destinés à celle-ci, et de les verser sur le plancher du bureau, et le grand-père réprobateur disait : « Prends garde petit d’en avoir toute ta vie ». Un jour, malencontreusement, une pièce s’était logée sous une plinthe ou avait disparue dans une rainure du plancher, et cela avait fait un drame. Après la mort de Mr Louis, vers le printemps 1903 mes parents reçurent un jour une lettre de Frédéric qui révolutionna la maison. Il demandait à papa et maman l’autorisation d’épouser Melle Louise. Ceux-ci ne virent pas le projet d’un bon œil en raison de la différence d’âge existant entre les jeunes gens, différence jouant en sens inverse de ce qui se voit couramment. Papa fit alors le voyage d’Angoulême et exposa à Melle Louise les raisons l’incitant à s’opposer à ce projet. Celle-ci répondit à mon père qu’il ne pourrait lui en dire plus long qu’elle ne s’en était dit elle-même ; que d’ailleurs elle connaissait de jolies femmes, plus jeunes que leurs maris, qui avaient été trompées par eux, alors qu’un ménage de leurs amis dont la femme était plus âgée était un couple des plus heureux. Devant l’insistance des intéressés, maman dit elle-même à papa qu’elle n’osait pas maintenir son veto, craignant que plus tard, Frédéric ne soit pas heureux avec une femme plus jeune et soit en droit de reprocher à ses parents leur intransigeance à ce sujet. Madame Louis, qui de son côté croyait garder sa fille définitivement avec elle, reprocha presque à papa de n’avoir pas deviné ce qui se tramait ; ce à quoi papa répondit qu’il lui était plus facile à elle-même, sur place, de juger la situation qu’à lui, séjournant à Paris. Enfin, toutes difficultés surmontées, les fiançailles furent décidées pour le mois de juillet. Celles-ci se passèrent dans l’intimité et c’est à cette époque que Madame Louis demanda ma main pour son fils. Je fus effrayée d’avoir à prendre une décision si importante et qui engageait toute ma vie. Je demandai donc quelques jours de réflexion. J’avais besoin de voir un peu plus clair dans mes sentiments ; l’année précédente peut-être aurai-je répondu impulsivement, mais le petit incident dont j’ai parlé précédemment m’avait dérouté. Mon futur époux dont la patience n’était pas la vertu dominante, revint à la charge 3 ou 4 jours après ; comme nous nous promenions dans le jardin, il me demanda à brûle pourpoint : « Me ferez–vous attendre bien longtemps votre réponse ? ». Je le vis pâle et anxieux, une ardente interrogation dans le regard ; prise de peur comme le cheval devant l’obstacle, je fis comme lui je me dérobai. « Puisque vous voulez une réponse immédiate, et bien, c’est non. Je lui dis le plus aimablement que je pus, ajoutant que je ne savais d’ailleurs pas si le mariage était bien ma vocation … etc… Ce fut le branle-bas dans la maison ; papa qui pourtant m’avait suggéré ce faux-fuyant, au cas où je ne me déciderais pas pour une acceptation, partit en guerre, parait-il, contre les pauvres religieuses qui m’avaient élevée, et que je continuais à voir fréquemment. D’autres m’accusaient de coquetterie, ce qui était loin d’être la vérité. Pour moi, je trouvais fort étrange d’être si mal comprise. L’éducation religieuse que j’avais reçue me faisait considérer le mariage comme une chose grave qui n’engageait pas quelques jours de ma vie, mais celle-ci toute entière ; était donc normal que je ne franchisse pas avec précipitation ce tournant dangereux. Le dîner qui suivit fut lugubre, chacun gardait le nez dans son assiette. Je me souviens aussi que, placée à la droite de Georges, il lui arrivait parfois de poser amicalement sa main sur le mienne et que ce geste amical me manqua ce soir là. Après le dîner cependant, et la nuit tombée, Georges fit le tour de la terrasse avec moi, et me dit qu’il ne m’en voulait pas et souhaitait que je sois heureuse avec un autre. Je fus touché de ce noble désintéressement, mais, plus tard, il m’avoua qu’il n’en pensait pas un mot, étant bien convaincu que je changerai d’avis et qu’il se marierait avec moi. Le lendemain nous partions pour Châtelaillon à quatre heures et demi du matin. Mr Georges nous accompagna à la gare. Au moment du départ du train, il monta sur le marchepied et demanda la permission de m’embrasser ; il était difficile de refuser et je m’inclinai devant cette ténacité désarmante. Plus tard, quand je connus bien mon mari, je pensai que ma résistance aurait-elle été dix fois plus grande, il aurait fallu qu’il arriva à ses fins, car il a une suite dans les idées peu commune, il revient à la charge aussi souvent qu’il le faut pour obtenir ce qu’il désire. Mais je reviens un peu en arrière ; le mariage de Frédéric et de Louise eut lieu le 3 octobre 1903 en l’église St Martial d’Angoulême par une journée superbe. Louise n’ayant plus son père, ce fut Georges qui dut accompagner sa sœur aînée à l’autel. De ce fait à la sortie de l’Eglise, il donna le bras à maman ; mais celle-ci ayant l’air excessivement jeune, elle n’avait d’ailleurs que 40 ans, certains, dans les bons badauds, la prirent pour une demoiselle d’honneur. Elle avait en effet une robe de crêpe de Chine gris argent très pâle qui lui seyait parfaitement, et pas un cheveu blanc ne paraissait dans sa chevelure d’un noir de jais. Pour moi j’avais, ainsi que Marthe, une robe de crêpe de Chine blanc et une capeline mousseline de soie entièrement froncée, ornée d’une plume d’autruche blanche, également retenue au pied par un macaron de velours vert amande. Marthe avait comme cavalier un ami d’enfance André Lagargue, avec lequel nous avons encore d’excellentes relations. Je fus accompagné par un camarade de régiment de Frédéric, un jeune docteur ou étudiant en médecine Mr Mondon. C’était un fameux original et un pince-sans-rire qui nous taquina un peu gorges et moi. Car ce fut ce jour là que notre mariage fut annoncé officiellement. Frédéric et Louise partir en voyage de noces. Mon frère devait, à son retour, s’occuper de l’usine à côté de sa nouvelle famille. Papa maman et moi rentrâmes à Levallois ; à fin octobre Georges vint nous voir. Le 31 était le jour de ses 19 ans et il m’offrit un superbe pendentif qui me fit un grand plaisir. Comme je le faisais voir à l’une des religieuses sécularisée qui m’avait élevée, en lui disant que c’était un cadeau du frère de ma belle-sœur, elle me répondit que l’on offrait pas cela à n’importe qui ….je lui annonçai donc mes fiançailles qui n’étaient pas encore officielles. Elles le devinrent le jour de Noël suivant. Je me vois encore ouvrant le précieux écrin où scintillaient un diamant et un rubis entourés de brillants plus petits, dans une composition sortant de l’ordinaire. Mon émerveillement était grand, mais j’étais aussi heureuse de voir la joie de mon fiancé à la pensée de mon plaisir. Notre mariage avait été fixé à fin janvier, sans doute voulait-on abréger nos fiançailles, car Georges ne pouvait se déplacer facilement et souvent pour venir me voir si loin. Mais un jour que nous nous apprêtions maman et moi à partir à Paris pour des achats en vue du mariage, je constatai que j’avais un peu mal à la gorge. Je me récriai quand maman parla d’appeler le docteur. Mais celle-ci tint bon disant qu’en raison des circonstances elle préférait exagérer les précautions. Bien lui en prit car le docteur consulté diagnostiqua la Diphtérie, à peu près sûrement. Un prélèvement de membrane fut fait et porté aussitôt à l’analyse ; celle-ci confirma le diagnostique. On me fit aussitôt une piqûre de sérum et ma gorge se dégagea rapidement. Mais après cinq jours de lit seulement, et sans avoir souffert, j’avais passablement maigri ; mon mariage fut repoussé d’un mois et la date en fut fixée au 22 février 1904. Ce jour arriva bien vite, je me vois encore, comme si c’était hier, revêtant ma parure de mariée ; le coiffeur n’avait pas voulu toucher à mes cheveux prétextant que son concours était inutile et qu’il était préférable que je garde ma physionomie habituelle. Il se contenta donc de poser sur ma tête la couronne et le voile et de les assujettir solidement pour la cérémonie. Une fois prête, on m’installa comme une idole sur le pouf central du salon afin de ne pas froisser ma robe en attendant l’arrivée des parents et amis. Je pense maintenant que j’étais absolument calme pour un jour si mémorable ; après mes hésitations, j’avais acquis une confiance totale en mon futur mari, et j’allai sans appréhension vers mon destin. Pourtant quand les cloches de l’Eglise tintèrent à l’arrivée du cortège de voitures, je sentis les larmes monter aux yeux en pensant que mon frère ne serait pas là, pour mon mariage ; en effet Louise attendant son premier enfant dans quelques mois, les jeunes mariés n’avaient pas voulu entreprendre le voyage assez long vers la capitale. Maintenant que je connais bien ma belle-sœur, je suppose qu’elle était bien contente d’avoir une excuse pour s’abstenir. Mais je refrénai de mon mieux mon émotion, afin de ne pas paraître une victime menée à l’holocauste. J’assistai à notre messe de mariage avec beaucoup de ferveur, demandant à Dieu de bénir notre union et de nous accorder la grâce de rester fidèles à notre amour. Je le remercie de nous avoir exaucés. Certes les chagrins ne nous furent pas épargnés, mais nous les avons supportés appuyés l’un sur l’autre, nous réconfortant mutuellement dans ces dures épreuves. Mais revenons aux jours bénis de la jeunesse où tout n’est qu’illusion. Certes les jeunes n’ignorent pas que la douleur existe, mais ils ne conçoivent pas facilement qu’elle puisse fondre sur eux ; ou bien encore, ils l’envisagent dans un jour si lointain que cela ne les empêche pas de courir allègrement sur les chemins de la vie. Quant à ceux que le malheur a déjà frappés, leur âge même les a préservés d’en goûter toute l’amertume, et ils marchent presque aussi gaillardement que les autres vers leur avenir. Une à une, avec les années, nos illusions s’envolent. Dieu fait bien ce qu’il fait. Il nous faudrait un héroïsme surhumain, malgré les promesses éternelles, pour nous détacher de la vie, si Dieu ne nous enlevait petit à petit tout ce qui en fait le charme : jeunesse, attraits, tendres et légitimes affections. Je parle pour le commun des mortels, car certes il y a des Saints qui n’attendent pas ce rappel à l’ordre pour se livrer à Dieu tout entier et dés l’âge le plus tendre. Mais me voici bien loin encore de cette Eglise St Justin de Levallois-Perret d’où le cortège nuptial sortait ce 22 février 1904 ; huit ans plus tôt je franchissais le même seuil au milieu de centaines de communiantes, cette fois embarrassée dans ma longue traîne et mon voile vaporeux, je m’engouffrais, suivie de mon mari dans le coupé impeccable dont un valet de pied ouvrait la portière tandis que le cocher, raide comme son fouet, maintenait deux chevaux impatients de partir.
Avant de nous rendre au restaurant Le Doyen à Paris, où devait avoir lieu le repas de noces, je tins à présenter mon mari à mes chères religieuses du Pensionnat St Jean ; on me fit beaucoup de compliments sur mon choix, au risque de troubler la modestie de mon époux, mais à ma grande satisfaction. Modérément grand, un mètre soixante dix environ, il avait à l’époque des cheveux noirs et souples, des yeux verts et facilement rieurs, dans un visage brun et énergique, barré d’une moustache également noire (ornement habituel à cette époque, mais qui ferait pousser des hauts cris à nos jeunesses modernes ; il est vrai que, timidement, on revient à cette mode masculine). Après la visite au pensionnat, le repas, qui me parut bien long, mon mari et moi nous rendîmes chez ma tante Bouchard ; celle-ci presque impotente n’avait pu assister au mariage. Avant de descendre de voiture, mon mari n’eut-il pas la fâcheuse idée de m’embrasser dans le renfoncement du coupé, mais un des boutons de son plastron de chemise s’étant accroché dans la dentelle de Bruges de mon corsage, j’eus toute les peine du monde à l’en sortir avant que maudit valet de pied ne vienne ouvrir la portière, quelle émotion… Nous avions projeté de faire un voyage de noces, et, après avoir hésité entre Pau, les Pyrénées, et Nice et la côte d’azur, durant nos fiançailles, nous avons opté pour cette dernière contrée, pensant à juste titre pouvoir plus facilement, par la suite, nous rendre dans les Pyrénées plus proches d’Angoulême. Mes parents craignant pour moi un départ précipité après les fatigues du mariage, nous accompagnèrent 2 ou 3 jours plus tard à la gare de Lyon. Là ce fut pour eux une dure séparation, car je ne les avais jamais quittés, et moi-même quand le train s’ébranla je ne pus retenir mes larmes. Georges en parût troublé ; pour lui il n’y aurait pas dû avoir d’ombre au tableau. Mais il comprit très bien mon émotion, après mes explications, ou eut la délicatesse de paraître les comprendre. Comme le soleil reparaît après une brève pluie d’orage, les sourires et la joie revint vite sur mon visage et dans mon cœur ; je ne voulais d’ailleurs pas, dés mon mariage, être un sujet de tristesse ou même de mélancolie pour mon mari. J’ai su plus tard que la sérénité était revenue moins vite dans le cœur de mes parents, qui, pour se distraire, avaient été à l’opéra comique voir jouer « Louise » où ils avaient copieusement pleuré. Il est vrai que le sujet était assez mal choisi en fait de distraction. Notre premier arrêt fut pour Dijon, où nous dînâmes au buffet, de fort bon appétit. C’était une sensation tout à fait nouvelle pour moi que de me trouver seule avec Georges dans une ville inconnue, au milieu de ces étrangers qui semblaient trouver cela tout à fait naturel, alors que j’en étais moi-même toute éberluée. Après ce repas hâtif, nous reprîmes le train jusqu’à Lyon où nous descendîmes pour passer la nuit et visiter la ville le lendemain. Lyon est certainement une belle cité, mais venant de Paris, je ne puis dire que je fus émerveillée ; les bord de la Soane dominés par la basilique de Fourvière, m’ont laissé cependant une impression assez frappante. Nous visitâmes la basilique, puis le jardin public ; je me souviens que j’étais assez lasse. Après une seconde nuit à Lyon, nous partîmes le lendemain pour Marseille. En cours de route nous avons été interviewés par un vieux ménage que notre jeunesse avait sans doute attiré et qui nous donna d’utiles renseignements pour notre séjour dans le midi. A Marseille nous avons passé quelques heures seulement, visitant les quais et pénétrant, sans invitation, dans un enclos réservé pour assister aux régates. .J’avoue qu’une fois de plus je n’ai rien compris à ces courses nautiques, mais nous étions, surtout Georges, très amusés de la façon dont nous avions pénétré, assez innocemment et si facilement dans cette enceinte réservée aux autorités. Nous avons dîné sur la fameuse Canebière « si Paris possédait une Canebière, ce serait un petit Marseille. » disent les Marseillais avec l’accent. Quant à moi, j’étais trop parisienne pour être de cet avis. Nous avons vu le vieux port, très pittoresque à cette époque, mais que je n’aurais pas été tenté d’habiter. Nous avons vu Notre Dame de la Garde que de loin ; je pense que nous étions trop pressés par l’heure, ayant annoncé notre arrivée chez une petite cousine de maman, la cousine Legay qui habitait Toulon. Celle-ci nous reçu très amicalement, quoique ne nous connaissant pas, et nous fit visiter Toulon. Elle nous conseilla de prendre un petit bateau qui faisait le service d’une plage dont je ne me souviens plus le nom maintenant, et qui ne m’a pas laissé un souvenir très précis. J’ai parlé de la promenade des Anglais, si réputée à juste titre pour son immense courbe et sa vue magnifique sur la mer et le littoral ; pour son luxe et sa joie exubérante ; elle fut cause pour moi, cependant- d’une grosse contrariété : j’y perdis un joli coulant de sautoir formé de feuilles d’or ciselées, surmonté d’un scarabée aux ailes de rubis et de saphir. Ma déception fut grande lorsque je constatai cette perte. J’avis peu de temps avant, pris dans mes bras un joli et tout jeune chien de montagne que son propriétaire offrait aux passants ; est-ce à ce moment que le bijou se décrocha, ou fut-il subtilisé par l’homme en question ? Georges en fut toujours persuadé. Nous fîmes plusieurs fois l’allée et venue sur la promenade mais sans résultat, hélas… De Nice nous partions tous les jours pour de jolies excursions dans les environs proches ; le vieux Nice, le port, Cimiez, un vrai paradis de verdures et de fleurs ou d’immenses mimosas remplissaient l’air d’un parfums pénétrant. Durant ce voyage nous n’avons pas été favorisés par un temps merveilleux, mais nous prenions assez philosophiquement notre parti de l’absence de soleil, ce soleil qui, dans le midi plus que partout, embellit toutes choses. Nous jouissions assez de notre nouveau bonheur pour voir du soleil là où il n’y en avait pas. Cependant il eut le bon esprit de nous accompagner lors de notre promenade de la Grande Corniche. Quel ravissement … la montée du car, partant de Nice et grimpant dans les derniers contreforts de la montagne, où l’on découvrait, à chaque tournant de la route en lacets, un paysage nouveau, aux lointains bleus, mauves ou roses ou d’un blanc étincelant, quel enchantement ! Je n’aime pas la montagne (ou plus exactement ce que j’en connais dans le Pyrénées), tout en reconnaissant sa magnificence, j’en éprouve une sensation d’étouffement et de tristesse peu agréable. Là, c’était tout différent, car la vue s’étendait au loin, comme sur un immense océan aux vagues gigantesques et irrégulières. Après ce passage merveilleux la route surplombe la mer, et c’est alors que je pu contempler, dans cette clarté d’un beau jour, le bleu sans égal de la Méditerranée. D’une teinte douce et irréelle vers l’horizon, elle prenait au long des roches abruptes et d’un ocre presque rouge, une nuance profonde allant du bleu violent au vert de l’émeraude … Beaulieu, St Raphaël sont des noms qui évoquent pour moi des coins charmants, mais dont le souvenir est vague dans ma mémoire. Eze, en revanche m’a laissé une vision sauvage et très particulière. En effet, que ce village perché sur son rocher aux tons de cuivre rouge est original… Monte Carlo me parut un peu un décor de théâtre en carton pâte. Ses maisons rose bonbon, vert pistache, me surprirent un peu, mais comme cela a dû changer depuis 37 ans… Les jardins de la principauté de Monaco provoquèrent mon admiration. La dernière étape fut Menton. Là je retrouvai un peu cette sensation pénible de la montagne toute proche ; on l’a vraiment trop sur le dos mais c’est à elle sans doute que Menton doit son climat tempéré, favorable aux malades. Pour le temps il n’était pas question de malades parmi les voyageurs du car, et je me souviendrai toujours de la satisfaction avec laquelle chacun se mit à table et fit honneur au déjeuner servi dans un coquet restaurant. Le retour se fit par la petite ou moyenne corniche, je ne me souviens plus, mais j’en garde une image moins frappante, un souvenir moins enthousiaste. Le parcours est-il réellement moins beau, l’heure était-elle moins propice, ou la fatigue engourdissait-elle mon admiration ? Je ne sais. Durant notre séjour dans le midi nous avons eu la curiosité de passer la frontière et de visiter les localités les plus proches, situées sur le territoire Italien : Vintimille, Sordighera. Cette promenade fut faite en landau et les petits Italiens nous bombardaient de fleurs des champs, courant pieds nus dans la poussière, derrière la voiture et sollicitant en revanche quelques pièces de monnaie. Mais les jours passaient et il fallait songer au retour proche et à la rentrée dans la vie sérieuse. Celle-ci nous avait déjà fait un petit signe par l’intermédiaire d’une lettre reçue d’Angoulême, et qui avait laissé Georges un peu soucieux. Il y était question du dernier inventaire qui n’avait pas donné le résultat escompté. Mais Georges ayant un caractère très optimiste, cette contrariété n’avait pas laissé de traces durables et il avait vite retrouvé son insouciance habituelle. Quelle heureuse étape dans notre vie aura été ce voyage de noces ; certains trouvent des inconvénient à cette coutume de voyage au loin alors qu’à mon avis elle a beaucoup de bon ; elle met d’emblée les jeunes mariés en présence sans l’entourage de la famille, et ils apprennent ainsi à s’appuyer l’un sur l’autre, comme ils devront le faire toute leur vie. Cette séparation de la jeune épouse et de ses parents sur lesquels elle s’est habitué à se reposer, la jette plus entièrement entre les bras de son mari pour y rechercher la protection habituelle qui lui manque, comme une tendre affection qui lui fait défaut … Ceci, naturellement, ne joue que dans un mariage où l’inclination et l’estime ont leur place, et où le mari a les qualités de délicatesse et de générosité nécessaires. Dans le cas contraire, en effet, le voyage de noces peut être la pire des choses, car on peut y découvrir plus facilement, dans une intimité constante, des défauts qui apparaîtraient moins dans une vie active normale, au milieu d’un entourage nombreux. Je me fais peut-être mal comprendre, et mon raisonnement n’est peut-être pas très clair et exact ? Je conclue donc simplement en disant que j’ai gardé un très bon souvenir de mon voyage de noces. Nous écrivions chaque jour à nos parents plusieurs cartes postales représentant les vues des pays traversés et relatant nos faits et gestes. Un jour était consacré à mes parents, l’autre à ma belle-mère, et nous avions recommandé de les garder précieusement avec l’intention de les grouper dans un album pour les feuilleter plus tard quand nous serions devenus vieux Ce temps est venu, mais hélas les cartes ont disparu, brûlées dans l’incendie qui dévasta notre usine te notre habitation en 1906. Donc notre voyage étant fini, nous reprîmes le chemin d’Angoulême, non sans nous arrêter quelques heures à Toulouse où les indigènes nous regardèrent de travers quand nous demandâmes à voir le Capitole, devant lequel nous étions arrêtés. Je ne puis dire que je fus enthousiasmée par cette ville ; j’étais décidément trop blasée après avoir joui, depuis mon enfance, de la capitale, de ses monuments, de ses jardins et de ses perspectives. En arrivant à Angoulême un nouveau chapitre de ma vie commençait, celui du labeur et des responsabilités… Louise s’occupant de l’usine, je ne voulus pas me confiner à la maison et j’offris mes services au bureau ; je n’y étais peut-être pas très utile mais on m’y accepta cependant et j’étais heureuse d’être ainsi davantage avec Georges et de m’initier, si peu que ce soit, à la marche de la maison.
Les six premiers mois de notre mariage, d’ailleurs, je n’avais pas à m’occuper de mon intérieur, ma belle-mère nous ayant offert aimablement l’hospitalité en attendant que tout fût bien au point dans notre appartement. Nous prenions nos repas avec elle et Marthe, ma plus jeune belle-sœur avec laquelle je ne tardais pas à m’entendre admirablement, n’étant son aînée que de 2 ans. Elle fut ma compagne assidue jusqu’à son mariage, 9 ans plus tard. Notre intimité fut alors rompue, mais notre affection mutuelle resta le même… Comme on le voit, la Providence me menait à la vie plus grave par des étapes bien douces ; ma belle-mère était en effet la bonté même, et durant les 6 mois que je passai chez elle, elle n’eut pour moi que sourires et bonnes paroles. Papa et maman vinrent bientôt nous retrouver à Angoulême, et par le fait, coupèrent ce laps de temps. Pendant leur séjour en effet, nous nous groupions tous pour les repas, Frédéric et Louise se joignant à nous. La maison de St Roch était un immense bâtiment de 75 mètres de long sur 25 de large, composé de trois étages sur la façade regardant le panorama de la ville, et n’en comportant qu’un sur le côté opposé donnant sur la rue. Cet étage supérieur était occupé par les ateliers et les bureaux ; l’étage en dessous appuyé sur le roc comportait les magasins, et le rez-de-chaussée, donnant par des portes fenêtres sur une terrasse très agréable, large de plusieurs mètres, de laquelle on avait une vue superbe et étendue sur la ville et la campagne lointaine. Cette terrasse était agrémentée de parterres fleuris, de quelques arbres fruitiers ; du côté des appartements de Louise, une jolie volière circulaire abritait serins et chardonnerets qui s’y ébattaient dans une apparente liberté. Au milieu, vers les appartements de ma belle-mère, une tonnelle ombragée permettait de prendre les repas ou de travailler durant la belle saison. Vers notre côté se trouvait un bassin muni d’un jet d’eau qui donnait de la fraîcheur aux heures trop étouffantes. De cette terrasse, on accédait à un jardin en pente, assez vaste jardin potager où se trouvait également un lavoir. J’ai passé dans cette maison si agréable les toutes premières années de mon mariage ; malheureusement le 3 octobre 1906, elle était détruite par un incendie provoqué par la foudre. J’étais à ce moment à Levallois avec Yvonne (née le 4 février 1905). Georges devait venir me chercher et rester quelques jours avec nous, chez mes parents. Quand je reçu le télégramme m’annonçant le désastre, ce fut pour moi un véritable coup : «Usine complètement détruite par incendie, sommes sains et sauf ». Il faut dire en effet que le feu s’était propagé avec une telle rapidité que les tuiles et les débris enflammés tombaient déjà sur la terrasse quand la famille sortait des appartements.
Papa partit aussitôt aux nouvelles, et pour se mettre à la disposition de Georges et de Frédéric s’ils avaient besoin de ses conseils ou en cas de démarches à faire. Non seulement les machines étaient détruites, ainsi que les stocks de papier, mais le mobilier, les vêtements, le linge, tout était anéanti et tous les membres de famille étaient vêtus d’objets prêtés par des parents, des voisins ou des ouvriers. Marthe, Louise, étaient sorties de leur chambre en toilette de nuit, les pieds nus dans des pantoufles. Frédéric avait fait une ronde quelques minutes avant que l’incendie ne fasse rage, et, n’ayant rien vu d’anormal s’était couché comme tout le monde. Ces instants avaient dû être bien tragiques car Frédéric avait à cet instant deux jeunes enfants : André né le 19 septembre 1904 et Paul âgé de 5 semaines … Au baptême de Paul ; dont j’étais marraine avec Paul Déroulède, on avait tiré un petit feu d’artifice, et André voyant les étincelles de l’incendie, et entendant le crépitement du feu disait : « Des fusées…des pataras » puis le lendemain en voyant les décombres, il disait tout triste : « Pauvre Yvonne plus de maison » Il fallut bien chercher une habitation de fortune où la famille put se rassembler durant ce triste hiver occupé par les expertises et discutions avec les assurances. Frédéric, Louise et Georges avaient eu sur les premiers moments la pensée d’abandonner l’exploitation de leur affaire et de chercher, l’un un portefeuille de représentant, l’autre une place de directeur dans une usine. Mais comme je le dis à Georges, les places avantageuses ne sont pas nombreuses ; de plus je connaissais assez mon mari pour savoir qu’il souffrirait de ne pas être son maître, et je les mis tous en garde contre une décision prématurée qui risquerait de compromettre l’avenir. Certes les affaires étaient à ce moment là assez difficiles ; les troubles sociaux et les grèves dégoûtaient un peu d’être patrons ; mais chez nous-mêmes le personnel était composé, en général, d’anciens ouvriers ; nous n’avions pas trop à nous plaindre à ce sujet, et je fis remarquer qu’après tout la maison Dupuy avait était une bonne affaire qui ne se remplacerait peut-être pas facilement. En définitive chacun s’arma de courage, et l’on pris toutes les décisions pour faire revivre l’affaire. Le plus difficile était de trouver un local assez vaste ; nous ne voulions pas en effet engloutir des capitaux dans une construction, préférant profiter de ce triste évènement pour rembourser la part de Marthe qui était susceptible de se marier avant peu et d’avoir besoin de sa dot. Après bien des recherches on dénicha sur le port l’Houmeau d’anciens chais vacants qui se prêtèrent tant bien que mal à un arrangement donnant un minimum de satisfaction. Où était la belle et vaste usine de St Roch ? Si claire, si avenante ? Hélas il n’y fallait plus songer, et se remettre au travail avec une ardeur nouvelle... Après avoir quitté la petite installation de fortune, près de la chapelle St Roch, et avoir vécu ensuite quelques mois dans une étroite maison de la rue de Paris, près de la place l’Houmeau, en attendant la remise en état d’une habitation, définitive, nous rentrions dans celle-ci en juin 1907. Cette maison que nous habitons toujours, m’avait souvent tentée quand, avec ma belle-mère, je me rendais au cimetière du Gond dans le break familial.
La voiture longeait le long mur du jardin que de grands arbres touffus dépassaient majestueusement, et je n’imaginais certes pas qu’un jour je viendrais y habiter. Il aurait fallu avoir pour l’automne et l’hiver notre cher St Roch, et pour la belle saison l’habitation de l’Houmeau. La maison spacieuse et de très bel aspect ne reçoit pour ainsi dire jamais le soleil étant exposée au Nord, et les grands ombrages du jardin permettent de goûter la fraîcheur, à moins que la trop grande chaleur ne nous confine dans la maison qui s’échauffe difficilement, mais qui à certaines époques est une véritable glacière. Cette grande maison de style Louis XIV a beaucoup de caractère, je la décris un peu pour ceux qui plus tard me liront. Elle donne sur une terrasse dallée à balustrade de pierres qui a très grand air ; par un escalier à double révolution, on descend à une vaste cour limitée par des bâtiments, autrefois des chais, quelques énormes marronniers l’égaient ; à cette cour fait suite le jardin d’agrément orné autrefois de fleurs et de pelouses, d’un côté de l’allée centrale, et d’un superbe magnolia et de l’autre côté disposé en jardin potager et fruitier. Ce côté a été transformé depuis pour y installer un tennis. Enfin l’extrémité du jardin forme un petit bois où les arbres se disputent le ciel. Après des mois de tribulations, la vie reprit calme et régulière dans ce cadre agréable. Quand notre cousine Roullet avait visité la maison, elle avait fait remarquer, en voyant les dimensions de la salle à manger, qu’il faudrait une nombreuse famille pour la meubler. Or peu de temps après notre installation, une nouvelle naissance s’annonça chez nous. Georges qui avait désiré un fils avant la naissance d’Yvonne, menaça de jeter à la Charente la seconde fille qui aurait l’audace de se présenter. Pour moi qui n’avais pas de préférence, la première fois, je désirais aussi un garçon. Pourtant nous fûmes déçus tous les deux, mais je n’ai pas souvenir que cette déception fut de longue durée. Notre petite Denise née le 11 octobre 1908 ne tarda pas à devenir un beau bébé, potelé et très éveillé. J’avais pris la résolution de nourrir cet enfant, car pour Yvonne j’avais eu, avec les nourrices, toutes les tribulations possibles Sous prétextes que j’avais eu le croup avant mon mariage, on m’avait refusé l’autorisation de nourrir. La première nourrice avait dû, au bout de 15 jours, être renvoyée. Yvonne était couverte de boutons ; la seconde avait perdu son lait pendant notre séjour à St Palais ; Georges et maman avaient dû en hâte revenir à Angoulême et chercher dans les environs une nouvelle nourrice. Celle-ci enfin dû cesser de nourrir quand Yvonne n’avait que 11 mois. Je me jurais donc bien si j’avais un d’autres enfants de les nourrir moi-même, de m’aider au besoin d’un biberon, ou d’employer ce seul système, à défaut de mieux, mais de ne jamais reprendre de nourrice. Louise qui avait été fort éprouvée lors de la naissance d’André, et n’avait pas nourri, avait au moins eut de la chance pour sa remplaçante. Pour Paul elle s’était révélée parfaite nourrice. Denise se comporta très bien et me fit honneur ; pourtant vers 18 mois, elle eut une broncho-pneumonie qui nous donna quelques soucis, mais elle s’en tira suffisamment bien pour ne jamais s’en ressentir. Papa et maman, depuis notre mariage, venait passer auprès de nous tous, 2 ou3 mois, puis repartaient à Levallois pour une durée de 3 ou 4 mois, et revenaient. Il passaient aussi les hivers dans le midi et s’arrangeaient pour venir pour la belle saison à Angoulême. Les naissances qui alternaient chez nous et chez Louise étaient aussi le signal de leurs visites car maman assista toujours à ces moments critiques et se montra une infirmière aussi dévouée qu’experte vis à vis de la mère et de l’enfant. Elle aimait beaucoup les tout petits et, certes, elle fut bien servie. Denise n’était pas née que Louise attendait Marcelle ; celle-ci naquit en mars 1909 ; ce fut la bien venue auprès des deux petits frères. Ma chère belle-mère qui, depuis l’incendie, vivait avec Marthe dans une petite maison à St Roch, non loin de la prison, commençait à trouver que les naissances étaient un peu trop fréquentes dans nos foyers, quand je lui appris que nous espérions un 3ème héritier à notre tour. Le 13 juillet 1911naissait notre cher petit Roger ; c’était enfin le fils désiré ; les ouvriers de l’usine tirèrent le canon en son honneur, quand à Georges, le roi n’était pas son cousin ! Mais comme Denise, les premières semaines qui suivirent sa naissance, avait eu des troubles digestifs, parce qu’elle s’alimentait trop, la sage-femme crut bien faire en rationnant davantage le nouveau-né ; or celui-ci était peut-être moins vorace, et ne s’éveillant pas la nuit ne prenait sans doute pas suffisamment, et il ne profitait pas normalement. Au début septembre quand je fus suffisamment valide, nous partîmes à St Palais, mais maman était assez inquiète pour son petit-fils. Enfin voyant que chaque tétée remplacée par un biberon ne donnait pas de meilleur résultat, je fis un coup d’état et dés que Roger eut un repas de plus, il se mit à progresser normalement. Ce faux départ fut cause, je crois, de son aspect délicat les premiers mois. Vers un an pourtant ce fut un bien joli bébé. Je n’étais pas seule à le trouver tel car, à Paris, où j’avais été voir papa et maman, j’étais constamment interpellée dans le métro, les autobus ou les magasins ; les voyageurs ou les vendeuses s’extasiaient sur le régularité ou la finesse de ses traits, la petitesse de sa bouche, et la grandeur de ses yeux. J’avais eu le cœur gros en allant à Paris de ne plus y trouver ma bonne grand-mère Mossé, morte le 12 mars 1912. Elle avait fait quelques temps auparavant une chute provoquée par une bicyclette, alors qu’elle s’empressait pour faire une course pour mon grand-père. Un refroidissement, une congestion pulmonaire compliquée d’albumine l’emportèrent. Peu de temps après ce voyage à Paris, durant nos vacances à Châtelaillon, de nombreux malaise me firent connaître que Roger, qui n’était pas encore sevré, allait avoir un petit frère, Celui-ci, Pierre, naquit le 24 mars 1913. Louise avait eu, le mois de septembre précédent, son 4ème enfant, Jean. Mais depuis 3 ou 4 ans déjà, papa voyait sa santé s’altérer. Il souffrait de douleurs que rien ne parvenait à guérir. Il avait vu de nombreux médecins à Paris et à Angoulême et avait fait de nombreuses cures : Enghien, Bourbon-Lancy, Dax, sans avoir grand soulagement ; au contraire, le mal, après avoir semblé décroître légèrement, s’accentuait peu après. Lorsque Roger était tout petit et que nous étions à St Palais avec maman (papa faisait sa cure à Dax) grand-mère Mossé nous avisait que grand-père était souffrant et qu’il allait être obligé de se faire opérer. Maman se rendit donc à Paris à cette occasion. L’opération de la prostate et de la pierre (un énorme calcul dans la vessie) réussit bien, mais dans la suite, grand-père ne se soigna pas suffisamment, et, après la mort de grand-mère surtout, il commença à décliner. Il aurait voulu que papa et maman restassent avec lui, mais papa, de son côté, avait besoin de soins, et surtout l’atmosphère d’Issy les Moulineaux ne lui convenait guère. Le beau-père et le gendre ne s’étaient guère entendus bien portants, tous deux malades, cela n’aurait pas été tenable. Peu de temps après la naissance de Pierre, au début d’avril 1913, papa se sentant de plus en plus fatigué, se décida à quitter Levallois pour Angoulême, disant (je l’ai su plus tard) qu’il voulait mourir auprès de ses enfants. Hélas, le 7 novembre 1913, en effet, il nous quittait après de longues souffrances chrétiennement supportées. Les derniers mois de sa vie il était revenu à la religion abandonnée depuis sa première communion. Notre vieux curé de l’Houmeau, Mr l’abbé Bourdier, lui avait été sympathique et, après quelques conversations avec lui, papa revint aux pratiques de sa jeunesse. Je lui ai entendu dire que Dieu l’avait sans doute récompensé de nous avoir fait élever, mon frère et moi, dans des écoles chrétiennes. Il aurait été d’ailleurs facilement mystique, je crois, s’il avait pratiqué plus tôt, car il nous disait parfois en souriant : « Je ne vous comprends pas, moi, si je croyais vraiment, comme vous, je laisserais tout et j’irais m’enfermer au couvent.» Ce à quoi je répondais que Dieu ne demandait pas cela à tout le monde sans quoi la fin du monde serait vite arrivée. Malgré ses souffrances très vives, dés qu’il avait un léger répit, papa reprenait son caractère aimable et gai. Mais ces répits devinrent de plus en plus rares et seules les piqûres de morphine ou de ses dérivés lui permettaient quelque repos. Cet état durant depuis longtemps déjà, nous étions partis malgré tout avec les enfants à St Palais au début de septembre, mais vers le milieu du mois, Frédéric et Louise nous rappelèrent, car ils étaient inquiets. Le mois d’octobre passa encore cependant sans grand changement, mais, à partir de la Toussaints, papa cessa de s’alimenter ; il rejetait même le peu d’eau qu’il prenait. Ce fut pour nous un vrai supplice moral, car, jusque là nous avions, malgré tout, espéré qu’un jour ou l’autre on parviendrait à juguler le mal. Parfois pourtant papa nous disait : si vous m’aimiez vraiment vous désireriez ma mort car ce n’est pas une vie de souffrir ainsi. Sa fin, le 7 novembre 1913, fut donc une délivrance, mais quel vide creusa pour nous sa disparition. Il avait un esprit fin, cultivé, une conversation agréable. Pour nous qui étions à l’usine dans la journée, il était distrayant de l’entendre discourir sur tel ou tel sujets puisés dans ses lectures. Notre cœur ne souffrit donc pas seul de cette fin, assez prématurée, papa n’avait en effet que 65 ans.
Maman qui l’avait soigné avec un dévouement admirable resta quelque temps avec nous, mais la santé de son père la réclamait à Issy. Elle dut donc partir loin de tous ceux qui étaient sa consolation après la mort d’un mari très aimé. Je comprends mieux maintenant, il me semble maintenant, quelle dût être sa triste vie, seule, auprès d’un malade taciturne et irritable, avec pour unique confidente une vieille servante dévouée, il est vrai, mais bien primitive.
REDACTION Arrêtée ARRÊTEE Fin août 41 Reprise le 26 septembre 1942
Maman avait eu aussi, comme nous, un gros ennui : 15 jours après la mort de papa, l’usine aménagée depuis 6 ans seulement brûlait à nouveau. Nous étions à peine au lit que des coups précipités à la porte de la maison nous alertèrent ; et maman qui s’était mise à la fenêtre pour s’enquérir de ce que l’on voulait apprit de la bouche d’un voisin de l’usine que le feu y couvait. Georges était à Paris cette fois ; Frédéric courut en hâte à l’usine où le sinistre n’était pas encore apparent, mais pris de grandes proportions lorsque les portes furent ouvertes. On ne put sauver le bâtiment des machines et ateliers mais les magasins furent préservés ; c’était d’ailleurs les moins modernes, mais le feu ne choisit pas. Quoique les dégâts fussent moins étendus que lors du premier incendie, c’était encore une grosse épreuve, et l’occasion de nouveaux soucis. Durant les froides journées de décembre, plus d’une fois il fallut que Georges se rendit sur les lieux du sinistre avec les experts ; un jour il eut un assez fort malaise que l’on attribua à un refroidissement. C’était, en s’en rendit compte plus tard une première crise d’appendicite qui fut très fugitive, mais vers la fin mai une crise aigue le terrassa. Le Docteur Texier alerté au début de la nuit diagnostiqua à peu près sûrement le mal et ordonna des compresses très chaudes en attendant la glace, dés le matin. Ma nuit se passa à renouveler les compresses. Quand le Docteur revint à la première heure, accompagné du chirurgien, ils acquirent la certitude qu’on était en présence d’un cas aigu d’appendicite et qu’il y avait lieu d’opérer dans la journée même. Il n’était pas question de transport sans doute déjà dangereux, et l’on convertit notre pauvre chambre en salle d’opération. Adieu rideaux, tentures, tableaux, et mille riens qui font l’intimité et la douceur d’un foyer. Je regardais un peu effarée cette transformation, alors que, stoïquement Georges, de son lit en avait commandé les grandes lignes. Il fit ensuite pousser les hauts cris à sa pauvre mère en réclamant son confesseur, le bon abbé Albot ce que je trouvais de mon côté fort sage et qui ne m’impressionna pas de la même façon que ma belle mère. Oh jeunesse de combien d’illusion ou d’espoir tu pares la vie… Pour cette fois, il est vrai il eut raison, Georges se tira fort bien de ce mauvais pas ; non sans souffrances pour lui, naturellement, et quelques inquiétudes pour nous. Le Docteur Godinaud devant mon optimisme, sans doute excessif, à son gré, au lendemain de l’opération, me dit tout de go comme je le reconduisait, qu’il n’y avait pas encore lieu de se réjouir ; qu’il était grand temps d’opérer Georges et qu’une demi journée de plus, il était f----u. Quant à lui, Docteur, il demandait 48 heures pour se prononcer. J’imagine la figure que j’ai du faire à ce moment…. Heureusement tout se passa bien, sauf au bout de 15 jours où une poussée subite de fièvre nous alarma, et où j’imaginai un commencement de péritonite. Cependant la fièvre tomba comme elle était venue, et peu à peu la convalescence s’affirma. Les suites d’une opération à chaud étant plus longues, je garde un bien mauvais et pénible souvenir de cette période, où je ne m’asseyais guère de la journée pour satisfaire à mes devoirs de garde-malade. Pierre étant encore bien jeune, ainsi que Roger, cela compliquait les choses, et nous avions pris, pour la nuit, une religieuse sécularisée afin de me permettre de prendre un peu de repos. Cette opération avait eu lieu le 27 mai 1914, jour même de la naissance de Jacques, le fils aîné de Marthe qui s’était marié en juillet 1913, avec Augustin Raoux, jeune avocat que lui avait fait connaître Mme Lafargue de Bordeaux. Il faisait alors un stage chez un avoué de cette ville, et devait plus tard acheter une étude à Ruffec.
La première convalescence de Georges terminée, nous partîmes à St Palais, pour achever de le remettre Nous avions loué, cette année, la villa Magali, comme plusieurs fois précédemment, où nous achevions tous de nous remettre de nos émotions. Maman avait pu s’échapper un peu pour nous rejoindre, vers la fin de juillet, mais elle nous arriva de Paris avec des nouvelles bien inquiétantes, au sujet d’une guerre possible avec l’Allemagne, à la suite de l’attentat de Sarajevo. On ne voulait y croire, espérant toujours que les difficultés s’aplaniraient, hélas il n’en fut rien, et le 2 août ce fut la mobilisation générale. Comment dire le bouleversement qu’elle provoqua dans la coquette station balnéaire. Nous y fûmes prises comme dans une souricière ; les trains en effet ne circulaient plus que pour les jeunes hommes contraints de rejoindre leurs corps. Pour Georges nous n’avions pas trop lieu de nous inquiéter, son opération récente, sa large cicatrice à peine fermée, ne lui permettait pas d’accomplir momentanément son devoir, mais nous pensions avec tristesse que Frédéric allait partir sans que nous puissions même l’embrasser. Je ne pouvais laisser les quatre petits seuls avec les bonnes, et, d’ailleurs, je n’aurais pu obtenir les laissez-passer facilement pour moi-même. Maman, après bien des démarches, put enfin rejoindre Louise à Versailles où Frédéric se trouvait avant de partir au front. Georges, après la visite passée à Angoulême, vint nous retrouver à St Palais où toute la vie se concentrait sur les communiqués affichés chaque soir dans la rue proche de la plage. Après les succès des premiers jours, et l’exaltation que l’entrée des troupes Françaises en Alsace avait causée, ce furent le désarroi et l’inquiétude occasionnée par l’annonce des replis successifs. Dans un triste état d’esprit, il nous fut permis de rejoindre Angoulême où la vie de la famille s’était organisée. En prévision du ralentissement des affaires ou de l’arrêt de l’usine, on avait envisagé une compression des dépenses familiales. Ma belle-mère qui habitait, depuis plusieurs années déjà, rue de Paris, locataire chez des religieuses de Chavagnes, vint avec sa fidèle Maria rejoindre Louise qui supprima le service de sa cuisinière. Quand nous arrivâmes de St Palais, les choses étaient en cet état ; j’avoue que je fut un peu peinée que ma belle-mère ait choisi d’habiter complètement avec Louise et non avec nous ; mais quand j’y réfléchi, dans la suite, je dus reconnaître que c’était bien légitime, et je m’étonne maintenant d’avoir ressenti cette déception : l’attitude de ma belle-mère n’ayant jamais pu me faire penser à une diminution d’affection vis à vis de moi. Les heures de septembre furent bien lourdes jusqu’à la bataille de la Marne. Le miracle de la Marne, pourrait-on dire, car il est doux aux cœurs chrétiens de penser qu’en cette journée du 8 septembre la Ste Vierge eut pitié de la France et obtint de son fils que Paris fut sauvé. Hélas la France, après la victoire finale, ne mis pas à profit la leçon qui lui avait été donnée, et elle mérita par son peu de générosité, son relâchement moral, les maux si graves dont nous souffrons aujourd’hui. Je me souviens donc, en ce début de septembre 1914, des soirées d’angoisse, sur la terrasse de la maison, alors que de délicieuses nuits d’été n’aurait dû porter qu’à la douce rêverie. Ce n’était pas sans un certain malaise aussi que je voyais mon mari auprès de moi, alors que tant d’autres femmes vivaient dans une angoisse perpétuelle, et que la France avait tant besoin de ses enfants pour la défendre. Pourtant je ne pouvais nier qu’à ce moment le départ de Georges aurait été une folie, et qu’il pouvait craindre, pendant plusieurs mois encore, l’éventration. D’autre part ses forces n’étaient pas encore complètement revenues. Devions-nous, après tout, dans une action inconsidérée, contrecarrer les plans de la Providence ? L’avance Allemande enrayée, la question se posait moins angoissante pour moi. Frédéric ayant fait son service militaire comme infirmier aurait voulu passer dans une unité combattante ; sa jeune femme jugea elle aussi qu’il devait rester là où Dieu l’avait mis, et il partit au front comme sergent infirmier. Il y fit très consciencieusement et très courageusement son devoir, et même plus, ce qui lui valut d’être nommé chevalier de la légion d’honneur dans la suite. Je ne m’étends pas sur ce sujet lui-même ayant été écrit déjà en détail, dans son journal, les péripéties de ces années de guerre. Après plusieurs mois de front, 15 ou18, il fut rappelé comme officier d’administration à l’arrière : Sarlat, puis Cognac le gardèrent assez longtemps. Au début des hostilités Augustin avait souffert d’une fistule qui l’avait empêché de partir immédiatement au front ; il était à La Rochelle où Marthe avait pu le rejoindre ; le moment vint pourtant de la séparation. Son mari aux armées, Marthe revint avec son petit Jacques habiter avec nous. Les jours s’écoulèrent alors dans l’attente des nouvelles des absents et des communiqués, et dans l’accomplissement d’un travail régulier les affaires ne s’étant pas ralenties longtemps. Georges avait été mobilisé à la poudrerie, il lui était possible, en prenant sur son sommeil, de donner un coup d’épaule à Louise qui, très au courant des affaires, se dépensait sans compter. Je faisais moi-même de mon mieux au bureau, mais, dés le printemps 1915, je fus un peu handicapé par l’attente d’un cinquième enfant. Ce fut celui qui, providentiellement peut-être, me fatigua le moins au début de la grossesse, et je fus heureuse et fière de pouvoir, pendant un mois, grâce à ma présence, permettre à Louise de prendre un peu de repos à la mer, moyennant les conseils que Georges me prodiguait dés qu’il rentrait de la poudrerie, et la sécurité de le savoir là pour les cas difficiles. J’allais ensuite moi-même en septembre à St Palais puiser de nouvellees ; avec ma petite bande et Marthe nous étions à la villa « Yvonne » cette fois. Maman avait dû rester auprès de grand-père qui, très fatigué depuis des mois, ne quittait plus le lit, ne s’alimentait plus guère que de lait. Lui à qui j’avais entendu dire : « Je voudrais mourir après un bon déjeuner », faisait des repas d’ermite. Cette agonie lente se prolongea jusqu’au 20 octobre 1915. Ma pauvre maman vint ensuite nous rejoindre. Depuis de longues années, elle ne connaissait guère de repos, s’étant dévouée à ses chères malades dont le dernier ne compris peut-être pas toujours le sacrifice fait par sa fille en vivant éloignée de nous. Le 15 janvier 1916, naissait notre petit Guy. Le dernier mois d’attente, j’avais dû faire beaucoup de chaise longue car je souffrais d’une jambe dés que je me fatiguais un peu. Ce fut sans doute grâce à ce repos forcé, que Guy remporta le record de poids sur ses frères et soeurs : il pesait 7 livres et demi alors que tous les autres oscillaient entre 6 et 6 livres et demi. Mais si ma belle-mère s’épouvantait de voir ainsi s’augmenter notre famille, en pensant aux lourdes charges qu’elle représentait, c’est pourtant grâce à ce cher petit que Georges ne partit pas sur le front où l’on envoyait plus les pères de 5 enfants. Je ne pensais pas que, plus tard, cet enfant paierait lui-même un dur tribut à la Patrie. Mon beau-frère Augustin, qui devait être son parrain par procuration, puisqu’il était au front, m’écrivit à ce moment une charmante lettre, souhaitant beaucoup de bonheur au petit conscrit de la classe 36, mais elle n’éveilla heureusement en moi aucune crainte de le voir à son tour, 23 ans plus tard, mêlé à un drame identique à celui que nous vivions (ou pire hélas)…
En mars 1917 Marthe mettait au monde son second fils, Pierre. Augustin eut à ce moment une permission, ou peut-être était-il encore en congé de convalescence car il avait été blessé en 1916 à Verdun. Ce fut une heureuse blessure, si je puis dire, car elle l’éloigna de cet enfer. En effet la balle ayant traversé le pied au-dessus du talon, ne coupa aucun tendon, ne broya aucun os, enfin fit le minimum de dégâts ; il eut aussi une blessure légère à la main.
Augustin participa encore, comme lieutenant, à la campagne d’Italie. Enfin, après les affres d’une si longue guerre, dont l’issue parut inquiétante à certains moments, et dont le développement fut, comme pour toutes guerres, toujours douloureux, la demande d’armistice des Allemands en octobre 1918, fut un soulagement, comme un souffle d’air pur dilatant les poitrines oppressées, ranimant tant de cœurs meurtris par des années de souffrances et d’angoisses. La joie était d’autant plus grande que l’effondrement des Allemands était plus subit, et certes inattendu pour la masse du public. Le 11 novembre jour de l’armistice, Paris fit éclater sa joie, ce fut paraît-il inoubliable, la foule était soulevé par un enthousiasme fou. Dan notre calme province les démonstrations étaient peut-être un peu moins bruyantes, mais chacun était profondément ému ; si l’on ne s’embrassait pas dans les rues, comme à Paris, on en avait bien envie je crois. C’était si bon de penser que cette hécatombe de jeunes allait enfin cesser, que ce cauchemar de l’invasion était terminé. Les lourdes bottes qui avaient à plusieurs reprises menacées Paris, fuyaient maintenant en sens inverse. Le fameux « on les aura » était enfin réalisé ; que de patience il avait fallu, que de ténacité et d’héroïsme … Aussi dans le bouillonnement de cette joie tumultueuse, un souvenir reconnaissant et attendri allait à ceux qui avaient fait la victoire et qui n’en profiteraient pas, à ceux qui, jusqu’à la dernière seconde, étaient tombés et dont la mort semblait doublement triste.
Le jour de la demande d’armistice des Allemands, Monique, la première fille et le troisième enfant de Marthe et Augustin, naissait. Le papa venu en permission, comme s’était la coutume en ce cas, échappa à l’offensive meurtrière menée par les Français en Italie contre les Allemands. Cette circonstance lui sauva peut-être la vie.
Petit à petit l’existence repris son cours normal, si je puis dire, car beaucoup, sevrés de joies de toutes sortes pendant la guerre, éprouvèrent un besoin effréné de jouissance, de luxe et de liberté. Ce sursaut sembla à beaucoup excusable, mais, hélas, il ne fut pas un élan passager, on s’habitua à cette vie facile, pleine d’un charme dangereux. Mais 5 à 6 ans après le traité de Versailles, l’atmosphère de l’Europe s’alourdissait, et on commençait à reparler de la guerre possible. D’alertes en alertes, 21 ans plus tard elle éclatait à nouveau, par la faute des politiciens peut-être, mais aussi par la veulerie de la masse. Tandis que sans foi et sans loi nous ne recherchions que notre bien-être, l’adversaire ceignait ses reins ; quand il vit que nous étions bien bas et mûrs pour toutes les abdications, il se crût maître enfin d’agir à sa guise et ne cacha plus ses appétits d’ogre. Un dernier sursaut de notre humeur chevaleresque, qu’exploitèrent sans doute des alliés trompés sur notre puissance réelle, nous jeta contre le colosse enragé. Nous ne sauvâmes pas, hélas, la malheureuse Pologne et notre effondrement total fut l’aboutissement naturel et fatal d’une politique de faiblesse, de démagogie, d’internationalisme et de laïcisation.
Mais je ne m’étends pas sur ce douloureux sujet et reviens en arrière pour continuer l’histoire de la famille.
En mars 1919, nouvelle naissance chez ma belle-sœur Marthe : c’est une petite Bernadette, dont je suis la marraine. Entre la naissance de Monique et de Bernadette Augustin avait acheté l’étude d’avoué de Me Pluchon à Ruffec, et c’est dans cette ville que naquit ma filleule, alors que Pierre et Monique sont nés rue de Paris, chez leur grand-mère Dupuy qui avait, avant la fin de la guerre, réintégré son domicile.
Les années qui suivirent la guerre, jusqu’à la naissance de Christiane, furent des années sans histoire ; c’est vers cette époque cependant que vint à habiter à Angoulême ma cousine Amélie. Papa en mourant l’avait recommandé à maman, et, après la mort de Mathilde, elle revint vers nous. Sa santé très ébranlée donna de grands soucis vers l’hiver 1919. On fit appeler un jeune docteur de nos amis le docteur Trousset, récemment installé à Angoulême ; il trouva Amélie assez mal en point ; reins, foie, intestins, nerfs très fatigués ; l’alerte passée il nous dit : « je l’ai tiré d’affaire pour cette fois, mais elle ne résistera pas à l’hiver prochain ». J’en éprouvais beaucoup de peine ; heureusement le diagnostic du Dr s’avéra faux puisque Amélie vécut jusqu’en 1941, non sans beaucoup de soins il est vrai et le docteur la donnait en exemple à ses malades, en raison de sa ponctualité à suivre les ordonnances. Quand nous allions à la mer, dont le séjour lui était défendu, elle allait aux eaux qui lui convenaient, principalement à Vichy. Elle avait conservé avec Pilar de Lezcano, fille d’un cousin germain de son père, je crois, d’excellentes relations, et celle-ci très fortunée lui facilitait l’accès des villes d’eaux, où elle-même devait se rendre, et jouissait ainsi de la compagnie d’Amélie.
En 1922 las d’aller, pour les vacances, toujours dans les mêmes coins : Châtelaillon, St Palais, nous avions eu l’idée, avec nos cousins Roullet de faire une randonnée en auto, pour choisir un gîte sur la côte, pour les grandes vacances prochaines. Nous profitâmes des vacances de Pâques pour nous rendre d’Angoulême à Châtelaillon, puis La Rochelle, l’Aiguillon sur mer, la Tranche, les Sables d’Olonne, St Gilles Croix de Vie, St Jean de Monts, Pornic. Après avoir écarté pour telle ou telle raison les différentes autres plages, nous nous décidâmes pour St Jean de Monts, baie immense de sable fin, sans danger pour les jeunes enfants, et dont les peu nombreuses villas côtoyaient la plage, ou s’abritaient dans les bois de pins bordant la mer. Nous choisîmes les premières, claires et vastes, et revînmes enchantés de notre décision. Malheureusement l’homme propose et Dieu dispose. Je ne tarde pas à me rendre compte que je suis au début d’une nouvelle grossesse. Le docteur de la famille consulté pour savoir si je pouvais continuer à faire mes petites promenades dominicales en auto, (nous avions en effet une voiture depuis l’année précédente, et le grand bonheur de Georges était de faire ces sorties hebdomadaires) le docteur consulté dis-je, me répondit avec son flegme habituel : « Continuez, continuez, si cela rate et bien vous recommencerez ». J’en concluais qu’il n’était pas bien inquiet de ces sorties, et ne m’en privai pas. Cependant une belle nuit, à la suite d’une randonnée, de 80 km, ce qui devait arriver arriva, et la sage-femme consultée me conseilla un repos complet au lit, sans me garantir un bon résultat. Entre Guy et Christiane qui s’annonçait, j’avais d’ailleurs fait une fausse couche, mais si peu avancée que cela n’avait eu aucune gravité. Cette fois le repos fut salutaire et tout rentra dans l’ordre.
Cependant la question d’un voyage de 230 km, pour aller à St Jean de Monts, se posait. Je ne m’adressai pas cette fois au Docteur Texier, mais à un jeune Docteur ami de la famille, le Docteur Trousset, pour lui demander son avis ; nous étions en juillet et devions partir mi-août, jusqu’à fin septembre. Frédéric et Louise étant déjà, avec leur famille, maman et Yvonne, à St Jean de Monts. Le Docteur Trousset et la sage-femme poussaient les hauts cris à l’idée du voyage et Georges faisait un nez long d’une aune. Enfin on adopta une solution pouvant contenter à peu près tout le monde. Mon ingénieux mari proposa de m’emmener étendue dans la voiture ; celle-ci, une des grandes voitures limousine d’autrefois s’y prêtait ; Georges fit donc préparer par le menuisier un brancard reposant sur des pieds sur la banquette arrière, et s’appuyant devant sur la cloison de séparation de la limousine de façon que mes pieds soient au dessus de la place avoisinant le chauffeur (Georges en l’occurrence). Denise, Roger, Pierre et Guy se casèrent sur ce qui restait des banquettes avant et arrière de la voiture.
A l’encontre de Georges je n’étais pas trop fière de cette installation, car à chaque étape, les curieux faisaient leurs réflexions : « Tiens une malade », et cela m’agaçait un peu. Enfin tout se passa à merveille et j’arrivai sans encombre à St Jean de Monts. Marthe et Augustin y avaient déjà planté leur tente, eux aussi, et Marthe était dans la même situation que moi (janvier février 1923), après avoir alterné avec Louise, pour les naissances, c’était avec Marthe, et je devais continuer, pour le dernier avec mes nièces… Le séjour se passa bien, mais est-ce mon statut du moment qui en est la cause, je ne garde pas un souvenir merveilleux de cette saison. Les enfants et Georges y firent pourtant quelques pêches aux sennes assez intéressantes, mais je garde un souvenir plutôt mélancolique de ce séjour ; le temps aussi ne nous favorisa guère, c’est peut-être une autre raison de mon insatisfaction. En février 1923 Christiane fit son entrée dans le monde, le 13 et un mardi-gras. Ayant 2 filles et 3 garçons, je désirais une autre petite fille et fut servie à souhait. Les aînés étaient en admiration devant cette petite poupée, et Yvonne la disputait souvent à sa grand-mère qui, jusque là, avait si souvent pouponné. L’hiver 1923, nous allâmes à Vallières, près de Royan, et l’année suivante nous retournâmes à St Palais, notre coin préféré décidemment. Je garde un très bon souvenir de ce séjour où je jouissais pour la dernière fois d’un bonheur comme il en existe que passagèrement sur la terre. Je me sentais très jeune encore et jouissais de l’affection d’un très bon mari, des attentions de mes chères grandes filles, de la beauté de toute cette jeunesse, si unie pour dorloter la petite dernière. Mon grand et sage Roger commençait à devenir une aide pour son père, un compagnon compréhensif pour sa sœur Denise (aimant encore pas mal à se remuer) et pour laquelle Yvonne était peut-être d’un tempérament un peu trop calme. Ces vacances se passèrent donc dans la joie et la douceur de vivre, hélas ce furent les dernières d’un complet bonheur. Consciente de la rareté d’un tel privilège, je demandais souvent à Dieu la force dans les épreuves à venir ; celles-ci étaient proches, et sous la forme que je redoutais le plus, la perte d’un de mes enfants. Le 12 mars 1625, Roger qui avait passé sa journée du jeudi au jardin, puis au cinéma avec ses frères et ses sœurs et quelques amis, se plaignit au soir d’avoir un fort mal de gorge. Le matin du vendredi, lui si ponctuel à se lever pour aller à St Paul, resta au lit, se plaignant d’avoir très mal dormi et d’avoir dû refaire son lit plusieurs fois dans la nuit, tellement il s’était agité. Le Docteur aussitôt prévenu diagnostiqua la grippe ; hélas cette grippe devait être un de ces cas rares et mortels comme il s’en trouve un par an disait plus tard le pharmacien. Je ne veux pas entrer dans le détail de ces cinq jours d’angoisse qu’il est si douloureux de revivre, même après 18 ans écoulés. Dés le dimanche, je vis mon cher petit perdu et ne pus m’empêcher, en descendant me mettre à table avec ma famille, d’en manifester la crainte, ne pouvant retenir mes larmes. Tout le monde en fut stupéfait, et l’on m’accusa de toujours me tourmenter à tord. Cependant le lundi je demandai une consultation entre le Docteur Texier et le Docteur Trousset ; ceux-ci tentèrent le mardi matin une piqûre pour combattre l’infection, mais sans grand espoir de sauver le malade, qui avait pourtant été suivi de très près dés le début du mal, et que les deux Docteurs avaient vu ensemble déjà le dimanche. La nuit du lundi au mardi avait été plus mauvaise encore que les autres, et à l’aube Roger avait un visage si défait que je vis alors avec terreur sa mort inévitable. Le Directeur de St Paul alors prévenu envoya Monsieur l’Abbé Roux voir son petit pénitent habituel, qu’il administra ; le tantôt. Roger qui avait sa connaissance dit alors à un membre de la famille : « Je suis donc bien malade pour qu’on me donne les derniers sacrements ». Dans la soirée, le délire le prit, et il insistait pour qu’on le ramène à la maison se croyant au collège, puis après il entra dans une sorte d’assoupissement et s’éteignit doucement vers 2 heures du matin le mercredi 18 mars 1923. Comment exprimer la douleur et les regrets qui suivent une telle perte… Je ne le tenterai point ; seuls ceux qui ont passé par la même épreuve peuvent en mesurer le déchirement. Ce que je puis dire, c’est que ma vie se partage en deux : le temps qui a précédé ce deuil, et celui qui a suivi… Vous aurez encore des joies, me disait une amie à qui je confiais ma morne tristesse, cela me paraissait impossible… « Il vous reste Pierre te Guy » me disait une autre ; et cette phrase, je m’en souviens, m’avait paru insensée ; les deux petits qui restaient ne pouvaient en aucune façon remplacer celui qui n’était plus. Pendant bien longtemps je considérai mes deux fils privés de leur aîné comme un corps sans tête. Pourtant grâce à tous les chers enfants qui me restaient, sans oublier l’absent, je repris peu à peu goût à la vie, mais les joies sans ombres ne pouvaient plus exister pour moi, elles n’avaient plus cette clarté et cette apparence de stabilité que goûtent en elles ceux qui n’ont pas profondément souffert… Des retours sur le passé et des appréhensions sur l’avenir ont été désormais la rançon de mes joies. Mes illusions s’étaient enfuies et, avec elles, ma prime jeunesse prolongée par mon bonheur plus que de coutume.
Cette mort su cruelle ne fut-elle pas pourtant une grâce de Dieu ? Gâtée par tant de jouissances de la vie, n’avais-je pas tendance à m’installer dans ce paradis sur terre et oublier un peu nos destinées futures ? Les voies de Dieux sont impénétrables. Dans ma vie heureuse je le priais pourtant avec ferveur et lui demandais de me secourir à l’heure de l’épreuve. Celle-ci venue, avec quelle ardeur je demandai à la Ste Vierge de m’épargner la peine qui avait été la sienne au calvaire. La parole du Christ au jardin de Gethsémani fut bien souvent sur mes lèvres, dans cette dernière nuit où je voyais mon petit Roger nous quitter. Lui parti, anéantie par la douleur, je sentais mon âme en froid, si je puis dire, avec Dieu, malgré ma volonté d’accepter le sacrifice qu’il m’imposait. Pourquoi avait-il paré cette enfant de toutes les grâces physiques, intellectuelles et morales pour me l’enlever ensuite en quelques jours ?... Sentant le besoin d’un secours surnaturel bien grand pour supporter cette épreuve, je parlai à mon mari d’un voyage à Lourdes. Il acquiesça à ma demande, et, à fin juillet, nous partîmes en auto avec Yvonne Denise et la petite amie de celle-ci Francine Rocher, une charmante enfant qui, elle aussi, devait mourir de façon foudroyante 14 mois plus tard. Je fus très frappée lors de ce voyage à Lourdes par la parole d’un prêtre qui semblait s’adresser à moi. Nous faisions partie d’aucun pèlerinage, mais nous nous mêlions au hasard des rencontres aux groupes de pèlerins alors à lourdes. Or une fois que je m’étais arrêtée aux piscines pour écouter un sermon en cours, le prédicateur qui parlait de l’éducation des enfants disait avec véhémence : « Songez mes frères que Dieu ne vous donne pas vos enfants, Il vous les prête, vous devez les élever pour Lui et les lui rendre quand Il vous les demande ». Et disant cela, il regardait dans ma direction absolument comme s’il parlait pour moi.
Je ne pus retenir mes larmes, mais je du reconnaître que cette parole était vraie et je renouvelai mon acceptation à la volonté de Dieu. Dans les moments de trop grande dépression, d’ailleurs, la pensée du bonheur de Roger, que son père me faisait entrevoir, était ma plus grande consolation… Monsieur l’Abbé Lalande, au moment de mon deuil m’avait dit : « Cet enfant, au ciel, sera un protecteur pour ses frères » et certes je crois qu’il les a gardés fidèlement car ils ont eu une jeunesse chaste que l’on rencontre peu dans nos temps modernes, et qui étonne même (à tord) certains membres de la famille.
Après cette épreuve morale si dure, se présenta la souffrance physique. Je commençais, en janvier 1926, une nouvelle grossesse qui me fatigua tant que le Docteur envisagea de me faire avorter. Je passai pendant 3 mois et demi environ par tous les maux de cœur, ou plutôt d’estomac qu’on peut imaginer. Je manquais totalement d’appétit et avais des nausées continuelles, un besoin constant de saliver qui nécessitait une cuvette à côté de moi dans le lit, que je dus garder du 18 mars, au retour de la messe anniversaire pour Roger, au 31 mai, (après avoir fait précédemment plusieurs mois de chaise longue). Pendant ces mois pénibles où j’eus aussi quantité de troubles nerveux, je croyais par moment devenir folle, à d’autre d’avoir un pied dans la tombe. Enfin, petit à petit, je me remis et passais sans incident le reste de cette grossesse. Au mois d’août ma pauvre belle-mère qui s’affaiblissait par degrés, se sentit, au matin du 3 août 1926, plus fatiguée. Le Docteur venu voir ne constata rien de particulièrement inquiétant, mais nous fit comprendre qu’elle était usée. Vers onze heures, elle fit encore avec sa petite fille Yvonne les comptes de maison et rien ne faisait prévoir une fin si proche. En effet le même soir, vers 23 heures, elle s’éteignit sans grandes souffrances apparentes, peu de temps après l’arrivée de Louise, alors à Montignac, mais sans Marthe qui était dans une petite station balnéaire de la Manche et, à qui son état ne permettait pas un voyage précipité.
Ce furent encore des jours pénibles qui ravivèrent bien des souvenirs tout proches et me laissèrent le regret d’une affection à laquelle j’attachais beaucoup de prix, ma belle-mère ayant toujours été pour moi pleine d’indulgence et ne m’ayant donné que des marques de cordial dévouement. En septembre, pour prendre un peu de repos avant l’évènement attendu, nous partîmes à St Palais où nous avions loué une villa « malgré tout », qui se nomme « les brisants » je crois à présent. De la terrasse dominant la mer on se serait cru sur le pont d’un bateau. Venus cherché là un peu de calme, la tragédie nous y suivit. La famille de Francine Rocher avait loué, non loin de nous, un petit chalet, et les enfants ne manquait pas de se rejoindre à toutes heures du jour. Vers le 16 Francine se plaignit d’un fort mal de tête, elle continua néanmoins à circuler et fit même l’excursion de Soulac alors qu’elle était fiévreuse. Mais son mal empira rapidement, elle fut emportée par une encéphalite dans la nuit du 21 au 22 septembre. Ce fut pour nous, les enfants, et surtout Denise, un gros chagrin ; j’aimais beaucoup cette jeune fille, douce et charmante, et la rapidité de sa disparition, les angoisses qui la précédèrent (qui eurent bien des rapports avec celles que nous avions traversées 18 mois plus tôt) firent de cette mort un choc bien pénible pour nous. Les vacances écourtées, nous reprîmes le chemin d’Angoulême pour assister aux obsèques de cette pauvre enfant. Les relations avec madame Rocher se resserrèrent à la suite de cet évènement tragique et elle me demanda, si j’avais une petite fille, de l’appeler Francine, ce que je lui promis. Pour moi j’attendais un garçon avec le secret espoir qu’il ressemblerait à son frère Roger. Le 27 octobre 1926 j’eus une déception, car ce fut une fille qui vint au monde, et je fus au moins 8 jours à surmonter ce dépit. Puis je me résonnais et compris que de toutes façons le nouveau né, eut-il ressemblé à son frère, j’aurais encore regretté celui qui n’était plus. Quelques jours plus tard Marthe avait son fils Philippe. La vie reprit son cours normal, mais vers février 1927, j’eus encore une forte émotion, Guy ayant été malade et la température étant montée jusqu’à 40,6 degrés. On ne voyait pas exactement la cause de cette fièvre, et j’étais payée pour craindre ces grippes qui ne se localisent pas. Enfin après quelques heures d’affolement, on s’aperçut que l’oreille de Guy coulait et une fois l’abcès ouvert, la fièvre tomba peu à peu. Mais cette grippe compliquée d’otite l’avait fatigué ; il dut aller à la campagne avec sa grand-mère Blanche et sa tante Amélie pour se remettre d’aplomb, ce que je déplorai à cause de ses études.
La saison des vacances arrivant, nous renonçâmes, je ne sais pourquoi cette année à la mer, et, après bien des recherches, trouvâmes à louer une aile d’un charmant château situé sur la route de Pranzac à la Rochefoucauld. Cette demeure placée sur une hauteur, on avait vu sur une prairie et la lisière de la forêt de la Braconne ; un grand parc boisé, enclos de mur, permettait aux enfants de s’ébattre sans danger ; j’y aurais passé de bien agréables moments sans des regrets encore cuisants et de nouvelles inquiétudes. Me trouvant à Angoulême auprès de Georges (qui faisait la navette d’Angoulême aux deffends), je vis arriver un matin ma cousine Amélie accompagnant Guy. Celui-ci souffrait beaucoup d’une jambe et de la hanche, il pouvait à peine marcher. Ce mal l’avait pris subitement. Le Docteur consulté ordonna du repos. Guy repartit aux deffends et quelques jours plus tard, le Docteur Trousset fit venir en consultation le chirurgien Barret, car on craignait de la coxalgie, sans en prononcer le nom. Après examen et dans le doute, on fit étendre Guy sur un brancard confectionné pour lui, le pied maintenu par un poids pour tendre la jambe et éviter la douleur ; presque aussitôt il fut soulagé, mais je le vis ainsi jusqu’à fin octobre, et je passai, les premières semaines surtout, dans l’angoisse me demandant s’il ne resterait pas infirme toute sa vie, écarté de toutes les joies légitimes auxquelles chacun aspire. On peut penser quelles étaient mes réflexions … grâce au ciel, on en fut quitte pour la peur. Guy reprit doucement sa vie normale, et jamais plus on eut d’inquiétude à ce sujet. Souffrit-il d’un rhumatisme aigu provoqué par un refroidissement ? (Il s’était mouillé un jour d’orage en revenant de la pêche) ; fit-il un saut malencontreux ? (Quelques jours avant son malaise il avait fait des acrobaties par-dessus une table), on ne sut jamais la raison de cet accident, mais le principal c’est qu’il n’eut pas de suites.
Après un peu de retard à la rentrée, Guy reprit ses études, et, grâce à sa vive intelligence, il eut vite fait de rattraper le temps perdu. S’il lisait cela à l’heure actuelle, il ne manquerait pas de me faire des reproches, car il est modestie même.
Pendant ces mois d’été 1927, Marcelle Huault, ma nièce, qui avait fait la connaissance d’un jeune homme de Montignac, depuis déjà quelque temps, fut demandée en mariage par celui-ci, et, après quelques petits malentendus, l’accord étant conclu, les fiançailles eurent lieu au mois d’octobre et le mariage en janvier 1928.
Ma chère maman qui, depuis quelques temps était assez fatiguée, avec des malaises douloureux, dut, sur le conseil de son Docteur, faire venir un professeur de Bordeaux pour l’examiner ; on craignait une tumeur de l’intestin ; après radiographie et examen, celui-ci confirma ses craintes et conseilla l’opération. Le Docteur Duroselle ne me cacha pas la gravité du mal, et, c’est bien angoissée que j’attendais le résultat de l’opération qui devait au dire du chirurgien, prolonger la malade, mais non la guérir définitivement ; c’est du moins ce qu’il ressortait de ma conversation avec lui. Quelle ne fut pas mon soulagement et ma joie, quand le Docteur Pouget, qui avait assisté à l’opération, me dit amicalement quand il m’aperçut dans la selle d’attente : « Vous savez nous avons eu une bonne surprise, ce n’est ce qu’on craignait, mais seulement un petit kyste qui, une fois enlevé, ne laissera aucune trace. » J’étais bien heureuse mais j’étais passée par de tristes moments. Maman se remit assez vite, et nous eûmes le bonheur de la garder encore 13 ans après cette alerte. Le temps de nos épreuves semblait enfin révolu, car de 1925 à 1928, nous avions eu peines sur peines.
En décembre 1928, la veille de Noël, Marcelle mit au monde son fils Michel, et maman tout à fait remise put assister sa petite-fille comme elle l’avait fait pour sa fille, et sa belle-fille.
La vie s’écoulait à nouveau dans sa simplicité habituelle entre les devoirs de la famille et de l’usine. En 1929, alors qu’André était déjà à l’usine depuis plusieurs années, son père et sa mère jugèrent bon de lui faire un peu changer d’air et l’envoyèrent à Paris où il trouva une place dans les établissements Martin, papier en gros. Pendant ce séjour à Paris, il fit la connaissance d’une famille dont le chez était propriétaire d’une imprimerie assez importante. André fut bien accueilli dans ce milieu qui lui fut sympathique, car il lui rappela sans doute un peu le nôtre. Monsieur et madame Latour avaient en effet 10 enfants dont ils avaient hélas perdu l’aîné, l’année de la mort de Roger. André remarqua bientôt particulièrement Suzanne, la plus âgée des neuf enfants restant, et au printemps de l’année 1930 il se fiança, puis se maria au mois d’octobre suivant. Ces fiançailles et ce mariage célébrés en grande pompe nous amenèrent tous à Paris ; c'est-à-dire ceux que leur jeune âge ou leurs études ne retenaient pas à la maison. Amélie se constitua mère de famille en l’occurrence. Aux fiançailles d’André Paul remarqua la sœur cadette de Suzanne, Denise, et le jour du mariage de son frère le 3 octobre 1930, demanda à ses parents l’autorisation de se déclarer. Denise était bien jeune puisqu’elle avait 16 ans et demi. Néanmoins l’autorisation ayant été donnée, les fiançailles eurent lieu à Paris à la Pentecôte de 1931et le mariage en juin de la même année à Argenlieu, où les Latour avaient une grande propriété. Suzanne n’y assista pas attendant un bébé au mois d’août. André avait eu avant cette naissance une pleurésie qui nous avait inquiétés, mais qui sembla ne pas avoir de suite. Le 13 août Geneviève sa fille vint au monde. Ce fut un beau bébé que sa mère éleva parfaitement au sein, mais non sans se dévouer beaucoup et se sacrifier complètement comme elle fit encore pour ceux qui suivirent.
Cependant, au mariage de Paul, en juin, Jean avait été très fatigué et cela n’avait pas été sans nous inquiéter ; en effet, il avait été avec ses parents au bord de la mer avant, et là il avait eu de fortes poussées de fièvre. Le Docteur consulté ne lui avait rien trouvé d’inquiétant ; pourtant durant le voyage de retour de Paris, en auto, il dut à plusieurs reprises stopper la fatigue le terrassant. L’auscultation ne donnait toujours rien d’alarmant et ce fut une douloureuse surprise quand, un jour, Jean eut une assez forte hémoptysie. Le Professeur spécialiste de Bordeaux, Dr Piéchaud, ordonna le repos complet, et ce furent des jours de grande angoisse. Quand Jean fut un peu remis, on l’emmena à Bordeaux où on lui fit un pneumo, et de là, il partit pour Combo où il resta plusieurs mois et retourna ensuite les mois d’hiver. Grâce au ciel sa santé se raffermit et il reprit peu à peu sa vie normale.
Avant l’hémoptysie de Jean, en septembre 1931, nous avions été à St Palais, à la villa Nelly, située au bord de la plage ; à ce moment ayant appris que la villa Bébé était à louer vide, à l’année, Georges décida de la louer et obtint de maman de ramener les meubles de Grand-père qui étaient encore au pavillon, 21 tue Ernest Renan à Issy les Moulineaux. Maman allait de moins en moins à Paris, où elle faisait gérer sa maison du 30 par un architecte ; de plus la maison avait été construite par mon grand-père sur un terrain appartenant à une communauté religieuse qui ne pouvait à cette époque s’en débarrasser, suivant la donation qui lui en avait été faite ; mais après le renouvellement du bail de 20 ans en 20 ans, le propriétaire avait obtenu la faculté de vendre, et le pavillon devait alors rester la propriété du nouvel acquéreur. Maman décida donc de faire venir ce mobilier de Paris, plutôt que de le transporter dans un appartement de sa maison du 30 de la même rue. Maman venant avec nous tous les ans au bord de la mer, et nous donnant une pension pour nous dédommager des frais de location, des villas et de la nourriture pour elle et sa bonne, il fut convenu que nous l’hébergerions pour rien et que nous assumerions les frais de transport des meubles. Nous fîmes donc arranger à notre goût la villa « Bébé », retapisser, repeindre les appartements de façon que le cadre vieillot s’harmonise bien avec les meubles d’acajou, datant de Louis-Philippe et Napoléon III. Nous étions, mes grandes filles et moi, assez satisfaites de notre installation, simple mais coquette, quand nous en prîmes possession en juillet 1932.
Mais qui aurait pu penser qu’à mon âge, j’allais, une fois encore, être maman. Durant notre séjour à St Palais, je dus me rendre à l’évidence, et, quoique sentant moins de malaises qu’habituellement, je reconnus bientôt les symptômes caractéristiques d’une grossesse, qui se précisèrent de plus en plus. Je restai avec maman une dizaine de jours au mois d’octobre, après la rentrée de Georges et des enfants à Angoulême, pour jouir des dernières journées ensoleillées et me fortifier le plus possible. Ces quelques jours de complet repos me firent du bien, mais j’avoue que lorsque la nuit tombait, et qu’il fallait vers 5 heures rentrer à la villa, cela manquait de gaieté. Je rejoignis donc Angoulême avec plaisir quoique bien reconnaissante à ma chère maman de tant de petits soins et de prévenances. Je ne voyais pas sans un peu de mélancolie arriver ce 8ème rejeton ; j’allais avoir 48 ans et Georges en avait 61 ; verrions-nous bien longtemps le petit qui allait naître ? Ma consolation était que mes grandes filles comme mes fils, et naturellement les plus jeunes, tout le monde semblait satisfait, ou tout au moins prêt à aimer et protéger le petit frère qui allait venir ; car c’était un frère naturellement qui était attendu, puisque j’avais 4 filles et qu’il ne me restait hélas que 2 garçons. Je fus servie à souhait cette fois, puisque le 4 avril 1933 naissait le petit François qui devint vite un superbe bébé. Ma sage-femme m’avait mise en garde pour le nourrir, attirant mon attention sur mon âge, et dés les premières semaines, les tétés furent complétées par le biberon lorsque la pesée dénonçait une insuffisance. De cette manière François eut bientôt des joues, des bras et des jambes à faire envie aux amours les plus dodus. Parlerai-je du dévouement d’Yvonne ? Elle fut pour celui-ci, plus encore que pour les deux dernières, une seconde mère, puisque hélas mes forces étaient de plus en plus précaires. Si Christiane et Francine semblaient m’avoir gardé la première place, dans leur cœur de bébé, je crois bien que François m’y aurait presque mise à la seconde, ou tout au moins avait autant de sourires pour sa grande sœur que pour moi. Je n’en étais pas jalouse, car il était bien juste qu’elle recueillît le fruit de ses petits soins.
Six mois avant la naissance de François, Denise Huault avait mis au monde son premier enfant, Alain ; 13 mois après elle avait Yves. François était à égale distance des deux. De son côté Suzanne eut en janvier 1933, c'est-à-dire 3 mois avant François, sa fille Elisabeth (Lise). Toute cette petite bande poussait de compagnie. Rien de bien marquant durant les années 34 et 35.
Cette dernière année pourtant, durant notre séjour au bord de la mer, Frédéric nous téléphona pour nous prévenir que la maison allait se vendre. Le propriétaire nous avait bien avisés de ses intentions, mais nous hésitions à engloutir des capitaux dans cette maison, n’en ayant pas d’ailleurs beaucoup, car l’usine absorbait par l’achat de matériel, à peu près au fur et à mesure, les disponibilités. Cependant ayant appris par le coup de téléphone de Frédéric que le prix demandé était avantageux, George partit à Angoulême ; mais hélas le temps de s’aboucher avec le vendeur, l’affaire était conclue. Nous l’avons ensuite regretté car les propriétés ont pris une valeur extraordinaire. L’actuel propriétaire demanderait paraît-il en ce moment 2.000.000 de cette maison qu’il a acheté 150.000francs. On m’a un peu reproché d’avoir empêché cet achat ; j’ai simplement fait, au moment où il en a été question, les remarques que Georges avait soulevées autrefois quand, jeune femme, je désirais me rendre propriétaire de notre logis. Cette vieille bicoque, disait-il, entraînera des grands frais de réparation ; un jour, ou plutôt une nuit, nous nous retrouverons avec notre lit dans la cuisine, etc…etc… De plus Georges m’avait fait envisager, si nous faisions cet achat, la vente d’une partie du terrain , l’extrémité du parc où il y avait de si beaux arbres et je préférais rester locataire avec tout le jardin que propriétaire en en perdant une partie. On avait aussi pensé à faire acheter l’immeuble par maman, mais Louise avait trouvé que ce serait encore une indivision plus tard et que celle de l’usine serait suffisante. Enfin je n’eus peut-être qu’à moitié tort, car en 1936, nos capitaux servir à acheter un important matériel (machine Bobst) qui contribua certainement à augmenter fortement le rapport de l’usine et nous plaça bien vis-à-vis de la concurrence. Si nous avions acheté la maison, sans doute aurions nous du renoncer à cet achat de matériel, au bon moment.
Notre pauvre parc avait subi en février 1935 une bourrasque comme je n’en avais jamais vu et comme on n’en avait pas le souvenir dans la région depuis plus de 50 ans. Nous nous étions trouvé sur le passage d’un cyclone et pendant plusieurs kilomètres dans la campagne on voyait une quantité innombrable d’arbres les racines en l’air. Je me souviendrai toujours de cette nuit affreuse, le vent sifflait, mugissait, grondait, la maison semblait ébranlée par d’énorme coup de bélier, on se sentait trembler sous les assauts de la tempête ; le vent s’engouffrait dans les cheminées et semblait devoir en arracher les rideaux dont les lames s’entrechoquaient comme des cymbales. J’ai eu pendant une heure ou deux vraiment peur. En entendant craquer les arbres du jardin, je pensais aux dégâts qu’il faudrait constater dés le lendemain matin… Quelle fut ma déception, je pourrais dire ma tristesse, quand je vis le plus beau des arbres du jardin renversé. C’était un orme immense 2 ou3 fois centenaire dont les branches majestueuses étaient elle-même aussi grosses que de beaux arbres. Treize autres de ses compagnons avaient subi le même sort, c’était lamentable. Je fis replanter de jeunes sujets, mais le parc ne repris jamais le bel aspect d’autrefois, lorsque la frondaison touffue cachait les maisons voisines, permettant de croire que l’on était en pleine campagne. Le 1er juillet 1935 naquit Nicole le troisième enfant de Paul et Denise. Rien d’autre de marquant jusqu’en 1936 dans notre famille.
La pauvre France, de plus en plus malmenée passait de gouvernement en gouvernement, et ce manque de stabilité n’était point fait, hélas, pour lui donner du prestige et contribuer à sa prospérité. Tombant de Charybde en Scylla, nous eûmes un gouvernement Blum et les socialistes tinrent du coup le haut du pavé. C’est alors que commencèrent les grèves et occupations d’usines, nouvelle forme de protestation des ouvriers. Cette innovation eut beaucoup de succès et fit tâche d’huile ; bientôt du nord au sud, il fut de mode de se croiser les bras et d’attendre que les alouettes rôties tombent du ciel ; les semaines de 40 heures ne suffisaient plus, il était question de les réduire encore, et d’augmenter les loisirs pour lesquels on avait institué un ministère. Nous ne voyions pas sans soucis cet état de chose, mois André, très optimiste, répondait de notre personnel ; nous avions en effet de vieux et vieilles ouvrières qui, pensions-nous, prêcheraient la sagesse. Mais hélas, un meilleur prédicateur vint de Paris, retourna tous ces pauvres gens comme une crêpe, et l’on sentit le mauvais esprit s’infiltrer peu à peu dans l’usine ; bientôt chez nous, comme ailleurs, les ouvriers, nouveaux moutons de Panurge suivirent têtes baissées le mauvais berger (sauf 6 ou 7). Je ne sais même plus pour quel motif puéril la grève fut décidée. On espéra un moment que l’occupation n’aurait pas lieu, mais, ne sachant résister aux mauvais conseils, les plus faibles suivirent les plus mauvaises têtes et nous fûmes logés à la même enseigne que nos confrères. Dans le fond les ouvriers n’étaient pas bien enchantés de passer leurs nuits sur les piles de papier, mais les principes, avec un grand P ne leur permettaient pas de céder. On sentit pourtant bien vite la lassitude, et 5 ou 6 jours plus tard, une délégation de 3 ouvriers vint nous demander de bien vouloir chercher avec eux un terrain d’entente. Je ne me souviens plus s’ils obtinrent un quelques satisfactions, je sais en tous cas que le règlement d’atelier fut plus sévère et que, durant quelques années, on se montra plus strict, les évènements ayant semblé prouver que toutes marques d’indulgence étaient considérées, à tord comme une preuve de faiblesse. L’avenir semblait bien incertain durant ce souffle de révolution, et il fallait faire preuve d’énergie virile pour l’envisager. Restant au bureau durant l’arrêt de l’usine, je garde un souvenir désagréable de ces chants du personnel, semblant narguer les patrons, le travail, et toutes les disciplines salutaires. Néanmoins tous eurent le bon goût de ne pas chanter de chansons trop subversives, comme cela a eu lieu ailleurs. Je me berce de l’illusion qu’un fond d’estime restait encore chez eux pour les vieux et jeunes patrons qui, tous les jours, les côtoyaient et leur donnaient après tout l’exemple du travail. Pierre était en effet à l’usine depuis octobre 1933 ; je le vois encore, un de ces jours de grève, passer comme une flèche par la fenêtre pour aller ouvrir la porte (au nez des ouvriers) aux dactylos qui continuaient le travail ; on le sentait décidé à tout, et personne ne souffla mot. De son côté André parla si net que le drapeau rouge ne fut pas arboré sur l’usine. Après ces jours de désillusion et d’écoeurement, la vie reprit encore une fois normalement.
Mais vers la fin de juillet 1937, André fut pris de la grippe crût-on à ce moment, cela dura, puis sembla vouloir s’éterniser ; le mieux et les forces ne revenaient pas vite. Enfin il fallut se rendre à l’évidence, André était pris du même mal que Jean, mais d’une façon plus sournoise qui aurait pu avoir de graves conséquences si on n’avait pas pris de suite les mesures nécessaires. Parti à Pau, il s’y soigna si consciencieusement, gardant le lit, suivant les prescription du Docteur, que, lorsque nous allâmes le voir, vers la Pentecôte, avant de nous rendre à Hendaye, nous lui trouvâmes une figure de pleine lune qui faisait bien augurer de sa guérison. On ne pouvait lui faire un pneumo, la pleurésie qu’il avait eue en 1931 y faisait obstacle ; on se contenta de lui faire une phrénie ; mais cette petite opération ne donna pas suffisamment d’amélioration au gré d’André, et il demanda qu’on lui fasse une thoraco. Celle-ci entreprise sur quelqu’un dont l’état général était bon, et qui avait des réserves, devait, lui avait-on dit, amener une guérison complète ; les docteurs la lui conseillaient, faisant remarquer qu’en général on usait de ce moyen en dernier ressort, et c’est ce qui semblait accréditer la thèse de l’inefficacité de ce traitement. Trois fois sur quatre, quand on l’employait, le malade était condamné à brève échéance et supportait, de ce fait, très mal une opération grave et douloureuse. André était dans une tout autre disposition, et l’opération faite en deux temps, je crois à 15 jours d’intervalle, donna d’excellents résultats. Après un an de convalescence André reprenait, en octobre 1936, son poste à l’usine, à la grande joie de tous. Pendant l’absence d’André, Pierre heureusement déjà bien au courrant des affaires, avait, avec son père, assumé la direction de l’usine. Nous avions, peu avant la grève, acheté une Bobst, nouvelle et très belle machine, destinée à imprimer et à fabriquer des boites en grandes séries. Pierre avait à cœur de lui trouver du travail, et, quand il fut un peu plus libre, au retour d’André, il entreprit de créer une nouvelle clientèle pour ces sortes d’affaires que les voyageurs étaient moins aptes à traiter. Il rayonna donc en auto, et j’allais souvent avec lui, ce qui était pour moi un grand plaisir. J’étais heureuse de jouir de son entrain, de constater sa joie quand il avait obtenu une bonne commande, ou des promesses pour l’avenir. Sa jeunesse, sa franchise, son physique aimable lui valaient partout un accueil sympathique et chaleureux, dont lui-même était étonné et charmé. J’avoue que mon orgueil maternel était dans la jubilation.
Mais dans l’année 1937 il y eut encore des évènements à signaler que j’ai passé sous silence ; Jacques et Monique Raoux se marièrent le même jour de juin, l’une avec Joseph Magnant, de Ruffec, et l’autre avec la demi-sœur de celui-ci, Jeanne Magnant. Le père de mes deux nouveaux neveux, jeune veuf durant la guerre de 1914, 1918, se remaria avec la nièce du grand savant Georges Claude ; celle-ci quitta Paris pour habiter Ruffec où son mari avait une scierie qu’il dirige encore avec ses fils, mais elle mourut peu de temps après en donnant le jour à sa fille. Les deux couples étaient charmants et les cortèges qui les accompagnaient du plus gracieux effet. L’un, dont les jeunes filles étaient vêtues d’organdi bleu uni, avec ceinture de velours et bouquets d’oeillet bordeaux, dont c’était la mode à l’époque, et l’autre d’organdi rose brodé de petites fleurs bleues et roses. Mais après cette petite fête de famille, Denise qui, depuis quelques temps était fatiguée, de décida à se faire opérer de l’appendicite ; elle souffrait de malaise assez fréquent de ce côté et l’appétit lui manquait. J’eus encore à m’inquiéter à ce moment, car l’opération terminée, le Docteur Duroselle et le Docteur Trousset me dirent que s’il n’y avait nullement à s’affoler, il était pourtant utile que Denise prenne au moins trois mois de repos. Je me demandais alors si les Docteurs me disaient bien la vérité, et s’ils ne me cachaient rien d’alarmant. J’étais à ce moment debout dans le couloir de la clinique, et je crois que si je n’avais pas été m’étendre je me serais trouvé mal, ce qui pourtant ne m’est jamais arrivé. Heureusement mes craintes furent vaines et, après une convalescence prolongée, Denise put, environ 8 demains après son opération, qui avait eu lieu le 5 juillet, venir nous retrouver à Plombières où nous étions Pierre, Guy et moi. Le premier ayant un besoin urgent de cette cure, Guy et moi avions suivi pour lui tenir compagnie, espérant y trouver aussi avantage pour notre santé. Quoique Plombières n’ait rien de bien réjouissant, nous y passâmes de très agréables moments ; mes fils étaient pour moi de véritables chevaliers servants ; les petits soucis quotidiens m’étaient épargnés par un séjour à l’hôtel, et je me laissais gagner par la gaîté plus ou moins exubérante de mes fils, qui était pour moi comme un bain de jouvence. Après celui réel du matin, et le repos qui le suivait, la lecture des lettres d’Angoulême, impatiemment attendues, et la correspondance journalière, nous allions faire quelques courtes promenades et boire notre verre d’au à la source ; c’était l’occasion de quelques remarques malicieuses, mais sans méchanceté, sur les baigneurs mes frères, sur la façon de chacun d’absorber son verre ; les uns avalaient cela d’un trait, comme une purge, et debout, comme pressés d’aller prendre un train ; les autres, assis autour de petites tables, semblaient déguster le plus délicieux des apéritifs. Quant à moi je dus subir plus d’une fois les taquineries de Pierre qui ne comprenait pas que je dusse m’y reprendre à plusieurs fois pour avaler une si petite quantité d’eau. Nous étions certainement des malades de fantaisie, car une fois de plus, le Docteur m’avait rassuré complètement pour Pierre, dont les malaises sont presque toujours d’ordre nerveux, mais pour qui le séjour à Plombières devait avoir un salutaire effet. Pour le moment c’était le plus joyeux des compagnons, dont la gaîté trouvait écho auprès de Guy, plus calme, mais si égal de caractère, et dont les fines réparties lui donnaient la réplique. Mon bonheur était de les voir tout les deux si unis, et si empressés ensemble de me faire la vie douce. Nous faisions, après la sieste du tantôt, de plus longues promenades où leurs bras étaient d’un secours apprécié pour grimper presque toujours dans ce pays de montagne. Parfois, un peu plus bas nous nous postions dans un jardin fréquenté et, tandis que je travaillais, Pierre et Guy lisaient ou rêvaient. Denise, une huitaine de jours avant la fin de la cure, vint nous rejoindre ; encore dolente de son opération, elle éteignit un peu notre joie, trouvant le pays affreux et triste, et les gents tous plus vilains les uns que les autres. Le temps en cette fin de juillet commençait d’ailleurs à être moins beau, nous fîmes ensemble pourtant l’excursion de Gérardmer où le lac me parut assez noir et mélancolique par un temps couvert, et nous continuâmes jusqu’au Hoenneck. Là les brumes nous attendaient enveloppant tout le paysage d’une gaze opaque. Le vent était vif sur le sommet et peu agréable, mais pourtant il avait l’avantage de déchirer parfois ce rideau qui nous cachait le panorama, et c’était alors dans échevellement des nuées, ou dans une trouée nette, l’apparition de vallées lointaines et ensoleillées, du plus joli effet. La veille de notre départ pour Paris et Angoulême, Denise prit le chemin de l’Alsace où elle allait rejoindre Marthe Pouget, une amie, chez sa grand-mère ; elle y passa 2 ou 3 jours avant de se rendre à Annecy où une autre de ses compagnes, Monique Payot, séjournait avec ses parents. Le séjour au bord du lac lui fit grand bien, et elle revint engraissée et toute ragaillardie nous retrouver à St Palais.
Je ne voyais pas sans mélancolie arriver le mois d’octobre ; Guy, qui avait passé à 21 ans sa licence de droit, devait rentrer au régiment. J’ai su plus tard que lui-même appréhendait cette épreuve, et qu’il avait beaucoup prié pour la supporter vaillamment. Il faut dire que Guy, sorti à 17 ans de St Paul, après avoir passé sans accroc ses deux bachots, nous nous demandions ce que nous devions lui faire entreprendre ; certains, devant ses succès et ses aptitudes mathématiques, préconisaient polytechnique ou centrale ; mais le Supérieur de St Paul nous fit remarquer que s’il était en effet très doué pour les sciences, il avait d’autre part peu de disposition pour le Français, et que les jeunes gens se dirigeant vers ces écoles ayant tous les mêmes aptitudes scientifiques, il risquait de se trouver handicapé par sa médiocrité pour le Français et les langues. D’autre part le sachant très sérieux, consciencieux et travailleur, je craignais qu’il fournit un trop grand effort pour arriver et risquât de compromettre sa santé…. Après bien des hésitations, on décida de lui faire préparer les examens de la banque de France pour être plus tard directeur dans les succursales, situation qui présentait bien des avantages. Le Directeur de la Banque de France à Angoulême nous conseilla de faire obtenir à Guy une licence de droit, ce qui le mettrait en bonne posture et lui serait utile. De plus il était sage de lui faire affronter les examens pour la Banque plus tard, car les concurrents avaient souvent jusqu’à 23 ou 24 ans et de ce fait l’esprit plus mûri. Guy s’attela donc à cette nouvelle besogne, mais seul à la maison, préférant ne pas nous quitter pour aller en faculté à Bordeaux. Nous-même craignions de le voir partir, sachant qu’il était assez difficile pour la nourriture, n’avait pas un appétit formidable, et risquait de ne pas s’alimenter suffisamment Ce changement d’étude, sans guide aucun, donna une désillusion à Guy qui échoua à sa première année. J’étais ennuyée naturellement craignant de faire fausse route en l’occurrence ; cependant un des professeurs de la faculté nous conseilla les cours par correspondance et, guidé par un jeune étudiant aspirant au doctorat, il passa les trois années suivantes sans difficulté les examens requis, et obtint même chaque fois des mentions.
Entre temps, Georges, en bon industriel, ruminait de fonder pour Guy une maison filiale de Dupuy et Cie qui, sans concurrencer celle-ci, pourrait tirer avantage de ses relations commerciales, etc, etc… On était venu proposer à Dupuy et Cie, précédemment, la vente de cellophane et le façonnage de tous articles en cette matière ; la maison ayant déjà suffisamment de soucis avec ses nombreuses fabrications, ne s’était pas intéressé à cette offre. Georges la repris donc à son compte, et commença à mettre sur pied une petite affaire qui, en progressant, serait intéressante quand Guy serait en mesure de s’en occuper, c’est à dire, une fois ses examens terminés, puisqu’il les avait entrepris, (on n’a jamais trop de cordes à son arc) et son service militaire fini. Pour le moment il y partait, je le vois encore à la fenêtre du compartiment, presque un enfant encore par l’expression de ses yeux si bleus, qu’il détournait un peu, pour ne pas y laisser lire, peut-être, son appréhension. Le Docteur Trousset, par hasard à la gare, plaisantait de notre émotion, sans doute visible ; ne dirait-on pas qu’il part pour le Kamtchatka nous disait-il en riant. Il n’allait en effet qu’à Montargis, mais combien de fois devions nous le revoir durant les 6 années qui se sont écoulées depuis ? Il revint en effet 3 ou 4 fois pendant l’année 1938, mais au printemps et surtout à l’été de celle-ci, il était grandement question de la guerre ; nous étions à St Palais quand, en septembre, les choses s’envenimèrent encore ; plusieurs classes avaient été mobilisées et l’on s’attendait d’une heure à l’autre à l’annonce de la déclaration de guerre. Nous avions devancé notre retour à Angoulême devant l’imminence de ce danger. Ayant appris par une lettre de Guy qu’il avait quitté Angers avec son régiment du génie et qu’il était à Tours, je décidai de m’y rendre avant qu’il ne soit trop tard. Maman voulut absolument m’y suivre. Nous arrivâmes le 21 vers 6 heures du soir à Tours. Guy avait pu venir nous attendre à la gare à la suite de notre dépêche lui annonçant notre arrivée. Nous allâmes avec lui dîner au restaurant et restâmes jusqu’à 9 heures en sa compagnie. C’est avec une profonde émotion, que je dissimulais de mon mieux, que je quittais Guy me disant que c’était peut-être la dernière fois que je le voyais ; je sentais que maman, elle aussi, dissimulait des pensées qui n’étaient certainement pas couleur de rose. Nous regardâmes Guy traverser la cour de la caserne, jusqu’à ce qu’il eut disparu, et reprîmes tristement le chemin de la gare. En route, nous nous arrêtâmes devant un magasin de poste de TSF où l’on diffusait les dernières nouvelles. Tout un groupe était là, anxieux, écoutant un discours de Chamberlain, et cherchant à y découvrir ce que l’on pouvait en augurer pour la suite des évènements. Arrivées à la gare, il nous fallut attendre au buffet l’heure de notre train pour Angoulême, (1 heure ou 2 du matin). La veillée me parut longue et triste. Déjà des réfugiés du Nord et de l’Est avaient fui le danger possible, et c’était navrant de voir de pauvres petits enfants dépaysés, installés inconfortablement dans les salles d’attente. Ce voyage pourtant m’avait redonné un peu de courage ; j’avais en effet vu Guy si calme, si visiblement prêt à affronter les évènements, que j’en étais revenue toute réconfortée. Après les angoisses terribles des jours précédents, où mon imagination s’affolait, je sentais comme une détente de mes nerfs, un soulagement physique en même temps que moral ; mais j’appréhendais l’incident qui enlèverait cette paix reconquise et si douce. Dés le matin du 27, les bonnes nouvelles semblèrent vouloir, au contraire me confirmer dans mes heureuses dispositions ; le message de Roosevelt donnait l’espoir de voir les choses s’arranger ; mais hélas, presque sitôt après, Frédéric venant à la maison me dit que la déclaration de guerre allait être faite avant midi. D’où venaient tous ces bruits étaient-ils bien fondés ? Je ne sais, mais je sentis de nouveau l’angoisse m’envahir. Je devais aller à Chavagnes pour parler à la bonne mère, je ne sais à quel sujet ; on parla naturellement des évènements et je lui fis part de ma terrible appréhension. Elle comprit bien mon inquiétude maternelle, mais me dit que l’âge de mes fils était un âge critique , qu’ils étaient exposés à bien des dangers pouvant compromettre leur salut , et que , si le Bon Dieu les prenait, il faudrait accepter sa volonté. Je trouvais certainement ces théories très belles et m’évertuais à les faire miennes, tout en montant en ville où j’avais une course à faire, mais involontairement, je pensais à la montée du calvaire et aux mérites de la Ste Vierge. Arrivée chez Mr Chabasse, le tailleur, on parla à nouveaux des inquiétudes générales, mais quelle ne fut pas ma stupéfaction, quand il m’assura que tout allait s’arranger, qu’une entrevue était décidée entre Hitler, Daladier, Chamberlain et Mussolini ; celui-ci aurait servi d’intermédiaire entre l’Allemagne, la France et l’Angleterre. Je ne puis dire quel fut mon soulagement, il fut immense. Pourtant cet arrangement de Munich semblait bien pour la France une dérobade ; il m’était pénible de voir qu’on abandonnait cette pauvre Tchécoslovaquie à son triste sort. Au moment de l’invasion de l’Autriche par l’Allemagne, au printemps précédent, déjà on avait craint la guerre. Guy était à ce moment à Nancy et son père l’avait vu à Strasbourg où il avait été pour l’achat d’une machine, et où il lui avait donné rendez-vous ; mais à ce moment l’angoisse avait été de moins longue durée. Peu de temps après le départ de Guy, le 8 novembre 1937, se place la naissance de Marie-Claude, le 4ème enfant de Paul. Vers le mois de mai 1938, Christiane qui se plaignait depuis quelque temps d’être fatiguée, eut une crise de rhumatismes aigus, et le Docteur fut assez inquiet, quand après avoir ri de nos alarmes il constata qu’il y avait une complication du côté du cœur, non décelée tout d’abord. Je m’ennuyais beaucoup pendant quelques semaines, sachant que Berthe, la soeur de Georges, qui était morte à 20 ans, avait eu des rhumatismes de ce genre. Enfin grâce à l’administration de salicylate par voie buccale et piqûres intra veineuses, on arriva à juguler le mal et le cœur heureusement ne donna plus d’inquiétude. Néanmoins, pendant de longs mois, on traita Christiane en convalescence, ce qui ne l’amusa pas beaucoup. J’avais eu bien peur hélas de la voir condamnée à une vie d’infirme et je trouve que ces précautions rachetèrent à bon compte sa santé. En juin 1938, Monique Magnant avait son premier fils : Jean-Marie, et, quelques mois plus tard, Jeanne eut le sien : Yves Raoux. Cette même année, vers le mois de septembre, Jean eut un gros accident, du fait de son pneumo. On entretenait celui-ci depuis 1931et des accidents de ce genre, parait-il, se produisent quelques fois, quand le traitement se prolonge longtemps. Jean avait été faire sa piqûre chez le Docteur, et il eut alors une syncope très sérieuse dont il revint au bout de quelques instants, mais qui le laissa paralysé pendant 36 à 48 heures. Le Docteur fut d’abord très inquiet, mais il nous dit que lorsque le malade avait résisté, au bout d’une heure environ, il n’y avait plus lieu de s’alarmer ; il nous garantit que la paralysie disparaîtrait progressivement, ce qui eut lieu en effet. Mais Jean l’avait échappé belle, car certains cas sont, paraît-il, mortels.
C’était bien pénible de le voir quand il revint à la maison en ambulance de chez la Docteur ; il était vraiment défiguré par cette paralysie qui lui tirait le visage d’un côté ; il ne pouvait articuler un son, et avait peine à avaler le liquide qu’on lui donnait. Je garderai toujours le souvenir de ses yeux angoissés, semblant demander s’il resterait toujours ainsi. Heureusement tout rentra dans l’ordre assez vite et depuis le pneumo fut abandonné sans que Jean en souffrit. Quelques mois avant Jean avait avoué à ses parents qu’il désirait se marier avec Nono (Jeanne) la troisième fille de Monsieur et Madame Latour. Celle-ci qui, au mariage de sa sœur Denise, avait environ 13 ans, avait décrété que Jean serait pour elle, puisque ses soeurs avaient épousé André et Paul. A 20 ans elle n’avait pas changé d’avis et Frédéric fit alors les observations les plus sages aux deux amoureux, leur conseillant d’attendre au moins deux ans pour que la santé de Jean soit tout à fait consolidée. Ils acceptèrent, mais au bout d’un an ou 18 mois, las d’attendre, ils décidèrent de se marier en avril 1939. Le mariage eut lieu tout à fait dans l’intimité à Paris, les jeunes gens préférant éviter tous les gros frais du mariage solennel et s’installer confortablement. Bien des exemples de cette sorte avaient déjà été donnés ; sentaient-ils venir le cataclysme qui allait fondre sur le monde ? Les inquiétudes politiques toujours grandes incitaient-elles peu de gens à la réjouissance ? Je ne sais, toujours est-il que Jean et Nono se marièrent sans que nous allions à Paris, ce qui ne nous empêcha pas de bien prier pour les jeunes époux.
L’été arrivant nous nous rendîmes comme d’habitude, après les enfants, à St Palais. Dés le mois d’août, les vacances furent empoisonnées par cette crainte de la guerre qui s’aggravait de jour en jour. Dans cette atmosphère énervante d’orage, la foudre éclata un jour et ce fut la consternation générale. Guy était venu en permission de Montargis à St Palis au 15 août et c’est encore avec beaucoup de mélancolie que je l’avais vu partir, cette fois sentant combien la paix était précaire. Ayant emporté un poste de TSF à St Palais, nous étions suspendus aux émissions sentant d’heure en heure que le conflit s’approchait. Peu à peu on mobilisait toutes les classes. André Lafargue et sa femme, qui étaient en congés en France, passèrent vers le 29 à St Palais, venant nous faire leurs adieux afin de rejoindre au plutôt Alger où André était magistrat ; bien leur en prit car ils purent avoir le dernier bateau avant la déclaration de guerre. Dés le 31 août nous avions décidé de reprendre le chemin d’Angoulême ; le 1er septembre Pierre fit les deux voyages en auto coup sur coup pour ramener toute la famille à la maison ; nous craignions de nous retrouver bloqués comme en 1914, quoique l’auto nous donna plus de facilités ; mais qui sait si la circulation ne serait pas arrêtée pensait-on. Dans ces moments toutes les craintes vous assaillent, quoiqu’on fasse pour paraître calme. Ma pauvre maman, qui voyait pour la 3ème fois la guerre, fut comme toujours énergique et sans lamentations ; mais comme elle devait souffrir à la pensée des chères vies qui allaient être exposées. Tout d’abord nous pensions à Guy qui, en service actif, allait être un des premiers à partir, à Denise qui, infirmière de la Croix Rouge, avait signé un engagement pour le front en cas de guerre. Pierre n’avait pas fait de service militaire ; au moment du conseil de révision, son poids n’était pas en rapport avec sa taille. Le Major avait hésité à l’ajourner, puis, les sursis étant nombreux, il lui dit : « Allez-vous en chez vous, on ne vous rappellera pas. »
FIN DU 1er CAHI
Suite
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||